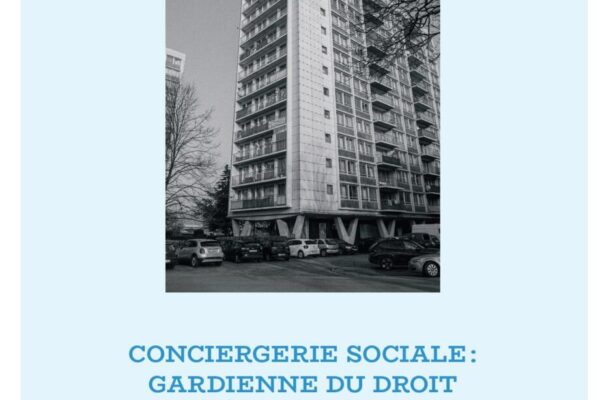La réforme radicale du temps de travail n’aura pas lieu comme prévu. Dans les dernières moutures de la fameuse «loi Peeters», le gouvernement recule. L’annualisation du temps de travail, mesure au cœur des discordes, est largement amendée. Dans d’autres domaines tout aussi polémiques, comme celui du recours massif aux heures supplémentaires, le gouvernement est inflexible et les critiques restent vives.
Le 29 septembre, 45.000 à 70.000 personnes défilaient contre la loi Peeters. Quelques mois plus tôt, ils étaient 100.000 à battre le pavé contre ce texte qui répond au nom bizarroïde de «loi sur le travail maniable et faisable». Malgré la légère décrue du nombre de manifestants, la loi continue de faire parler d’elle, de générer des pétitions et des communiqués colériques.
Si ce texte attise tant de passions, c’est qu’il promettait des bouleversements dans l’organisation du temps de travail. Annualisation généralisée, possibilité de travailler jusqu’à 45 heures, voire 50 heures par semaine, court-circuitage des syndicats, gros volume d’heures sups étaient au menu de la loi Peeters.
Les communiqués officiels, eux, mettaient en avant l’équilibre supposé d’un texte «moderne» qui aurait permis aux entreprises «de travailler de manière plus efficace», via davantage de flexibilité, tout en assurant aux «gens de mieux concilier le travail et la vie de famille». Quant à la Fédération des entreprises belges (FEB), elle soufflait le chaud et le froid, accueillant avec bienveillance certaines mesures, tout en regrettant leur manque d’ambition.
Face à la colère des syndicats et à la mobilisation populaire, Kris Peeters a dû revoir sa copie. Il l’a fait très discrètement. Dans la dernière mouture du texte, approuvée au conseil des ministres le 28 octobre dernier, le gouvernement fait des concessions. Il tente de donner un peu de tout à tout le monde. À tel point que l’avocat Renaud Dethy, du cabinet Claeys & Engels, spécialisé en droit social et ressources humaines, trouve que «l’avant-projet de loi est plutôt illisible. Le gouvernement a fait un patchwork avec un ensemble de mesures sans ligne de conduite».
Un patchwork difficile à comprendre et dont la philosophie générale, dénoncée par les syndicats – flexibilité, affaiblissement de la négociation collective – est adoucie par rapport aux textes d’avril et de juillet, sans pour autant disparaître. Focus sur deux mesures qui fâchent. L’annualisation du temps de travail et l’augmentation du volume d’heures supplémentaires.
Annualisation: le recul gouvernemental
L’annualisation du temps de travail, c’était LA grande réforme de Kris Peeters. Celle qui marquait une ambition de rupture par rapport au droit du travail existant. Et celle qui cristallisait une bonne partie de la défiance syndicale.
Dans les versions d’avril et de juillet de la loi Peeters, l’annualisation était inscrite comme principe général dans la loi, s’appliquant à tous. La conséquence en était simple. Toute entreprise qui décidait d’adopter ce système pouvait le faire à tout moment, sans passer par la concertation syndicale.
On ne touchait pas à la durée légale hebdomadaire de travail: 38 heures, même si celle-ci devenait indicative. Le calcul de cette durée hebdomadaire moyenne aurait pu se faire sur une année. Conséquence: pendant de longues périodes, les travailleurs auraient pu prester jusqu’à 45 heures par semaine au maximum, ou neuf heures par jour. Pendant d’autres périodes, le travailleur aurait vu sa cadence réduite pour compenser les excès des périodes plus intenses. Un régime de sursalaire était prévu dans certaines variantes du texte pour les heures prestées au-delà de la quarantième, au grand dam de la FEB.
Aujourd’hui, l’annualisation du temps de travail, telle que proposée en avril et en juillet, a presque disparu. Elle entre dans la loi par la petite porte, en modifiant les dispositions existantes de la loi travail de 1971 sur la «petite flexibilité».
La petite flexibilité permet d’ores et déjà de déroger à la durée «normale» de travail, sans paiement de sursalaire. Il est donc possible de prévoir une «période de référence», allant de trois mois à un an, au sein de laquelle des semaines de travail fluctuent de plus ou moins cinq heures, dans des limites assez claires: 45 heures maximum par semaine et neuf heures par jour. Ce dispositif doit être adopté par les partenaires sociaux via une convention collective de travail et, en cas d’absence de délégations syndicales, via le règlement de travail.
Avec la dernière proposition de «loi Peeters», la période de référence pour la petite flexibilité ne serait plus que d’un an. C’est le seul changement de la loi Peeters (dans sa version actuelle, qui pourrait changer) sur l’annualisation du temps de travail. Les entreprises qui opteront pour la petite flexibilité ne pourront donc le faire que dans le cadre d’une période d’un an, dans le cadre de conventions collectives ou du règlement de travail.
Cette concession de Kris Peeters sème la confusion chez les syndicats. À la CGSLB, le syndicat libéral, on pense toujours que cette mesure «est regrettable car il n’est pas opportun d’imposer des choses qui peuvent déjà être négociées et justement, aujourd’hui, la période de référence de la petite flexibilité peut être négociée jusqu’à un an». Toutefois, Arne Geluykens, chef du service études de la CGSLB, a bien conscience de l’avoir échappé belle: «Nous sommes heureux que cela soit le seul impact. Il n’y aura pas d’annualisation généralisée, c’est un point gagné.»
Un sentiment partagé à la Centrale nationale des employés (CNE-CSC), où Sébastien Robeet, coordinateur du service études, admet que «la dernière version du texte est plus acceptable car elle laisse une place à la négociation collective», nous dit-il. Côté employeurs, Marie-Noëlle Vanderhoven, première conseillère au centre de compétences emploi et sécurité sociale de la FEB, se dit «déçue» par le dernier projet de loi Peeters: «La loi Peeters n’a jamais été très loin en matière d’annualisation, mais aujourd’hui il n’y a rien car l’annualisation s’intègre dans un dispositif qui existe déjà.»
Seul Marc Goblet, secrétaire général de la FGTB, poursuit contre vents et marées sa charge avec la même virulence: «En annualisant selon les mêmes principes que la petite flexibilité, les employés vont quand même travailler plus longtemps sur une plus longue période.» Et puis, ajoute-t-il, les entreprises pourront appliquer l’annualisation «même sans accord avec les travailleurs», en se contentant de l’inscrire au règlement de travail sans passer par une convention collective. Vrai. Mais cette possibilité existe déjà et, dans la réalité, la petite flexibilité est généralement négociée entre partenaires sociaux.
D’ailleurs, même au cabinet Peeters, on concède que l’annualisation telle que prévu dans le dernier texte de loi ne changera pas grand-chose à la pratique actuelle.
Le compte-épargne temps, pas épargné par les syndicats
La loi Peeters prévoit la mise en place d’un «compte-épargne temps». L’idée est très simple: le travailleur pourra épargner du temps pour l’utiliser plus tard dans sa carrière, «pour souffler». Ce temps épargné peut porter sur certaines heures supplémentaires et sur des jours de congé extralégaux.
Les syndicats ne sont pas vraiment ravis de cette disposition. «Ce compte-épargne temps pourra offrir un peu d’autonomie dans l’organisation de la vie privée des travailleurs, pense Sébastien Robeet de la CNE. Mais c’est un pis-aller. Avant, il existait un crédit-temps assumé par la collectivité. Avec ce système, on assiste à une individualisation du crédit-temps.»
Et puis l’application concrète du compte-épargne temps s’annonce complexe. Ce compte devrait être mis en place au sein d’une entreprise ou d’un secteur. Mais quid de la portabilité? Comment faire valoir un jour de congé d’une valeur «X» qui correspond à un emploi «X» une certaine année à un jour de congé dix ans plus tard, dans un emploi «Y», où le jour de travail vaudra davantage?
Sera-t-il possible de faire valoir son compte dans d’autres secteurs? Et comment éviter que le «bagage» du compte-épargne ne devienne un frein à l’embauche en cas de changement d’employeur? Beaucoup de questions encore sans réponse.
À fond les heures sups
Un trait marquant de la loi Peeters est la volonté d’augmenter le quota d’heures supplémentaires disponibles. C’était l’une des revendications phares des entreprises.
Dans la loi actuelle, on ne peut prester que 78 heures au-delà de la moyenne de 38 heures par semaine sur une période de référence d’un trimestre. C’est ce qu’on appelle la «limite interne».
Cette durée peut monter jusqu’à 91 heures si la période de référence est un an. Et si les partenaires sociaux parviennent à trouver un accord, la «limite interne» peut être augmentée jusqu’à 143 heures, en général, cela correspond à une période de référence d’un an. Avec la nouvelle loi Peeters, 143 heures par trimestre deviendrait le socle de base commun à tout le monde du travail belge. Les partenaires sociaux pourront même négocier un relèvement de la limite jusqu’à 360 heures, sur une période d’un an.
Et ce n’est pas tout. Kris Peeters a proposé de créer un quota de 100 heures supplémentaires «volontaires», dont 25 échapperaient au calcul de la limite interne. Certes, ces heures seraient, bien logiquement, payées avec un supplément salarial de 50%. Mais elles se négocieraient à l’échelle de l’entreprise, en lien direct avec le salarié concerné. Donc sans l’intervention des syndicats. «C’est la seule disposition qui nous semble favorable», affirme Marie-Noëlle Vanderhoven de la FEB.
Une disposition «scandaleuse», rebondit Marc Goblet qui, sur ce coup-là, exprime un avis en phase avec celui de ses partenaires syndicaux. «On déplace la négociation du collectif vers l’individuel, c’est une de nos plus grandes craintes et cela pourra créer des tensions entre travailleurs», s’inquiète Arne Geluykens.
Pour Renaud Dethy, ce choix de créer un quota d’heures supplémentaires volontaires «pose un problème philosophique. À quel moment le travailleur est-il assez armé pour décider de sa propre flexibilité? Selon moi, cette mesure répond à une exigence du marché du travail car aujourd’hui le mécanisme des heures supplémentaires est très contraignant. Mais cela n’empêche pas qu’il faut des garde-fous pour éviter que des employés soient obligés de donner leur accord.» Pour les syndicats, ce nouveau mécanisme peut constituer un «outil de pression» sur les salariés. «J’ai des doutes sur les capacités des travailleurs les plus faibles à refuser ces heures», déclare Sébastien Robeet.
Et si l’on met bout à bout l’annualisation du temps de travail (même dans sa dernière version), le relèvement de la limite interne et le quota d’heures supplémentaires volontaires, le risque de voir voler en éclats la durée hebdomadaire du temps de travail devient bien réel. C’est ce que pense Gérard Valenduc, professeur à l’Université catholique de Louvain et à l’Université de Namur: «Ce qui m’inquiète le plus dans la loi Peeters, c’est cette tentative d’effacer la référence de la durée hebdomadaire légale de travail de 38 heures, sans l’éliminer totalement. On crée une plage floue qui dilue la référence de l’horaire légal hebdomadaire, sachant que, dans les faits, comme je l’ai indiqué dans une note statistique pour la Fondation Travail-Université, le temps de travail réel est déjà de 39 heures par semaine.»
Plus minus conto: encore plus de flexibilité
Le plus minus conto est un système dérogatoire à la législation sur le droit du travail. Il n’existe aujourd’hui que dans l’industrie automobile. Il autorise des fluctuations de la durée du travail sur une période de référence de six ans. C’est donc sur six ans que la durée moyenne hebdomadaire légale de 38 heures de travail doit être calculée. Cela implique pour les ouvriers de devoir faire face à des semaines très longues sur de longues périodes qui seront compensées par du repos étalé sur d’autres longues périodes dans l’intervalle de six ans. Ce système est aujourd’hui pratiqué au sein de l’usine Audi à Forest. C’est même cette disposition qui lui a évité la fermeture, nous dit-on.
Le projet de loi Peeters prévoit d’ouvrir le recours au plus minus conto à tous les secteurs concernés par la concurrence internationale, moyennant un accord des syndicats.
Partager le travail?
Au-delà de cet «effacement» progressif de la durée légale du temps de travail, le choix d’augmenter considérablement le quota d’heures supplémentaires disponibles pose une question fondamentale. Une question que Marc Goblet prend à son compte: «Mais pourquoi augmenter les quotas d’heures supplémentaires plutôt que de donner du travail aux plus jeunes dans un contexte de chômage et de pauvreté accrue.» De manière très simple, Marie-Noëlle Vanderhoven explique que, selon elle, et donc selon la FEB, «le mythe des heures supplémentaires qui empêcherait les embauches, je n’y crois pas. Car le recours aux heures supplémentaires est justifié par des besoins ponctuels. Lorsque ceux-ci deviennent structurels, une entreprise préférera toujours embaucher».
Cela n’empêche nullement des acteurs universitaires, comme Gérard Valenduc, de pousser la réflexion un cran plus loin: «La priorité devrait plutôt être de redistribuer les heures supplémentaires pour créer des emplois. Mais l’embauche compensatoire, ce n’est pas quelque chose de simple, à tout le moins sans réduction du temps de travail.» Car c’est bien le débat alternatif à la loi Peeters que veulent relancer certains syndicats, en alliance avec des associations – comme le collectif Roosevelt – et des universitaires: celle de la réduction du temps de travail. Après Écolo, c’est au tour du Parti socialiste d’avoir adhéré à l’idée d’une réduction collective du temps de travail.
Même si l’idée ne risque pas de séduire par magie le gouvernement Michel, celle-ci est à nouveau discutée sérieusement. En attendant, le projet de loi Peeters poursuit son bonhomme de chemin. Examiné par le Conseil d’État et le Conseil national du travail, il sera débattu ces prochains mois au Parlement.
Horaires flottants
Les «horaires flottants» sont aujourd’hui une pratique répandue dans de nombreuses entreprises. Une pratique tolérée par l’inspection sociale mais pas encadrée légalement. La loi Peeters vient corriger ce vide juridique et adapter la loi à la pratique.
Le dossier «Loi Peeters: gifle pour les travailleurs?», Alter Echos n°434, novembre 2016
«Un pacte pour l’emploi et la formation en Wallonie», Alter Echos n °427, juillet 2016, Par Julien Winkel