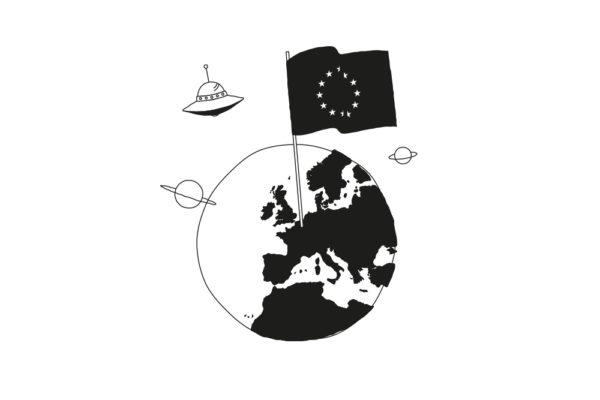Bart Vanhercke est directeur de l’Observatoire social européen. Et il l’affirme haut et fort: l’Europe sociale existe. Il ne nie pas les dérives austéritaires des institutions européennes. Mais les projets sociaux de l’Union, un temps à l’arrêt, pourraient être relancés grâce au «socle des droits sociaux» proposé par la Commission.
Alter Échos: L’Union européenne est souvent critiquée pour son manque de caractère social. L’Europe sociale existe-t-elle?
Bart Vanhercke: Indiscutablement, l’Europe sociale existe. L’Union européenne a adopté une série d’instruments sociaux depuis ses origines. Il existe des directives sociales, un Fonds social européen, un dialogue social européen. Est-ce que cette dimension de l’Europe est suffisamment développée? Bien sûr que non! L’Europe sociale est bien moins développée que l’Union économique. Depuis 1957, l’Union européenne s’est construite sur l’idée d’un marché unique. Les pères fondateurs pensaient que l’harmonisation sociale suivrait automatiquement cette intégration économique. Ça n’a pas été le cas. Certes, les divergences sociales entre États membres ont diminué jusqu’à la crise de 2008, mais elles sont ensuite reparties à la hausse.
AÉ: Vous parlez d’une batterie de législations… Pouvez-vous nous dire lesquelles?
BV: Il existe des directives sur les conditions de travail, sur le travail en intérim, sur la santé au travail qui sont incorporées dans les lois de tous les États membres. Et ces textes ne sont pas des législations «a minima» qui ne changeraient des choses que dans les pays de l’Est, comme on l’entend souvent. À chaque fois, la Belgique a dû modifier son arsenal législatif, généralement dans le sens d’une meilleure protection des travailleurs ET il y a bien sûr toutes les directives en matière d’égalité entre hommes et femmes. Là, on parle du corpus de législation sociale, mais, même dans le domaine dit du «marché intérieur», pourtant pas toujours bien vu à gauche, il existe des textes qui font avancer le droit social. Je pense à la directive «machines». Pour des raisons de concurrence, l’Union a harmonisé des critères de sécurité des machines-outils, avec un impact réel, et positif, sur le nombre d’accidents du travail et d’accidents domestiques.
AÉ: Vous évoquez les répercussions positives de directives européennes sur le droit social belge. Un exemple?
BV: L’une des dernières directives sociales, celle de 2003, concerne le temps de travail. Grâce à ce texte, tout travailleur bénéficie d’un congé annuel d’au moins quatre semaines avec maintien du salaire. Dans notre pays, le droit aux congés dépendait des prestations effectuées dans le courant de l’année précédente. Le gouvernement belge a dû adapter sa législation: les travailleurs qui n’ont pas un droit complet aux congés (ceux qui, par exemple, n’ont pas travaillé l’année précédente) bénéficient, grâce à la directive, de vacances au prorata du nombre de jours de travail prestés dans l’année en cours.
AÉ: Pensez-vous qu’il existe un modèle social européen en voie de disparition?
BV: Ce qui est sûr, c’est qu’il existe, en Europe, quelque chose d’atypique qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Un modèle social, des valeurs, qui sont partagés. C’est le modèle d’une économie sociale de marché. On y trouve des systèmes de sécurité sociale qui couvrent une série de risques. Ce sont des systèmes négociés avec des partenaires sociaux. On pense aux assurances chômage, aux pensions, à l’assurance maladie. On a d’un côté une convergence de vues et de l’autre des disparités énormes entre États membres.
AÉ: Mais ce modèle est remis en cause…
BV: Oui, il subit d’importantes pressions. Mais ce modèle n’a pas disparu. Beaucoup de réformes ont poussé dans le sens d’une réduction des droits, mais en même temps on a toujours des systèmes de protection sociale assez robustes, qui sont des amortisseurs au risque de pauvreté.
AÉ: Comment expliquez-vous que cette Europe sociale soit si peu connue?
BV: Dans son récent discours sur l’état de l’Union, le 13 septembre dernier, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, a eu cette phrase qui, je pense, illustre bien la problématique: «Le chômage est au plus bas depuis neuf ans. La Commission européenne ne peut pas s’en attribuer seule tout le mérite. Cela dit, je suis sûr que, si 8 millions d’emplois avaient été détruits, pour beaucoup c’eût été notre faute.» Lorsqu’une mesure est mal vue, les États membres, qui ont pourtant participé à la décision, disent que c’est la faute de l’Europe. Lorsque c’est plus positif, ils n’hésitent pas à s’en attribuer les mérites. C’est une attitude dangereuse, car cela contribue à la perception négative de l’Union européenne. Les effets sont là. Dans le dernier eurobaromètre, 42% de la population a confiance en l’Union européenne. C’est peu. Et c’est en partie à cause de l’ambivalence des États. C’est aussi une responsabilité de la presse qui n’évoque que rarement l’Union européenne, sauf pour insister sur les politiques d’austérité, les programmes d’ajustement budgétaire et le dumping social.
AÉ: Mais cette Europe «austéritaire» existe aussi…
BV: Oui, il existe une idéologie, une forme d’obsession de la part de certains États membres et au sein de la Commission. C’est comme si l’austérité et la réduction des déficits étaient les seuls remèdes à la crise. Comme si personne n’était capable d’imaginer autre chose. Je suis bien sûr critique à ce sujet. Par exemple, lorsque je vois qu’on laisse très peu de marge de manœuvre dans l’interprétation des 3% de déficit que les États sont censés ne pas dépasser. Pourtant, d’autres voies existent. La banque centrale belge a proposé une mesure alternative: exclure du calcul des déficits les dépenses relatives à l’investissement social, par exemple les dépenses d’éducation, de formation. Les réactions négatives ont fusé de toutes parts.
AÉ: Le cas de la Grèce n’est-il pas emblématique de cette idéologie?
BV: Que l’on parle de la Grèce ou même de l’Espagne, il est évident que les plans d’austérité, les trajectoires d’ajustement budgétaire les ont poussés encore plus dans leurs crises respectives. Ces mesures ont même eu un impact sur les taux de mortalité, sur l’accès à la santé et ont eu des effets récessifs. Le taux de chômage des jeunes reste extrêmement haut en Grèce. Les États ne voyaient pas d’autre solution. Ils étaient tétanisés, ils avaient peur d’une implosion de l’Union européenne. Certains économistes néo-libéraux et certains think tanks ont utilisé ce créneau pour influencer l’agenda, pour pousser «leurs» solutions.
AÉ: A-t-on un peu appris depuis lors?
BV: On sent un peu plus d’ouverture. La Commission interprète de manière plus souple le pacte de stabilité et de croissance, ils laissent une marge de manœuvre. Mais ce sont surtout les discours qui changent. Attendons de voir si les pratiques suivent.
AÉ: Quel a été l’impact de l’élargissement de l’Union européenne sur cette Europe sociale?
BV: D’un côté, l’élargissement a eu un impact très positif sur ces nouveaux États membres. Ils ont dû intégrer l’acquis social européen sur la santé et la sécurité au travail. Ils ont dû faire un saut qualitatif impressionnant. Mais ils sont encore très loin des standards européens. Certains pays changent leur législation mais sont à la traîne dans l’application. D’un autre côté, c’est clair que depuis 2004 toute la machinerie législative sociale s’est ralentie. C’est pour cette raison que l’Union européenne a inventé des mécanismes plus souples pour avancer, de la «soft law», comme des mécanismes ouverts de coordination, par exemple en matière de lutte contre la pauvreté. C’est, en 2001, la présidence belge qui avait mis cela sur les rails.
AÉ: Le détachement des travailleurs n’est-il pas symptomatique de ces différences Est/Ouest?
BV: Oui, car le détachement tel qu’il est appliqué devient une forme de concurrence déloyale entre travailleurs. Mais est-ce une marque de l’Europe ou de ses États membres? La commissaire belge, Marianne Thyssen, semble en avoir pris conscience et a proposé de réformer la directive afin de réduire cette concurrence. Les États membres ne sont pas d’accord entre eux. Il y aurait pourtant des choses à faire pour contrôler les responsables dans les chaînes de sous-traitance en cascade, souvent à l’origine des abus de détachement, ou pour lutter contre le système des entreprises boîtes aux lettres (créées uniquement pour permettre le détachement, NDLR). Mais la Roumanie ou la Pologne vont estimer que cela leur fait perdre un avantage concurrentiel. Chacun poursuit ses intérêts propres plutôt qu’un projet commun.
AÉ: Le Brexit va-t-il changer les rapports de force entre États?
BV: Le Brexit peut changer les choses, car le Royaume-Uni bloquait de nombreuses initiatives, et certainement celles dans le domaine social. Les autres États membres hostiles aux projets sociaux de l’Union européenne, comme les Pays-Bas ou la Hongrie, ne pourront plus se cacher derrière le Royaume-Uni. Aujourd’hui, la Commission européenne lance un socle européen des droits sociaux avec 20 principes clés, des objectifs concrets et des initiatives législatives. Je pense que l’exécutif européen n’aurait jamais pu lancer une telle initiative sans le Brexit. Cela ouvre une fenêtre d’opportunités.
AÉ: Ce socle européen des droits sociaux a été présenté par la Commission en avril dernier. L’Union européenne organise le 17 novembre prochain un sommet social. Mais des voix s’expriment pour critiquer le manque d’ambition de ces initiatives. Qu’en pensez-vous?
BV: Pour la première fois en 10 ans, la Commission essaye de se doter d’un agenda social. C’est en soi une très bonne nouvelle. Alors, bien sûr, les objectifs fixés ne sont pas assez ambitieux au regard de la réalité de terrain. Le taux de risque de pauvreté est de 24% en Europe, de plus de 40% en Bulgarie. En Grèce, 39% des jeunes étaient au chômage en 2016. Face à cette réalité, les objectifs poursuivis par l’Union européenne semblent faibles. Mais j’essaye d’être optimiste. Je vois que la Commission a proposé une directive sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, qui, si elle était adoptée, augmenterait la durée des congés parentaux et les montants de leur compensation par l’État. C’est ambitieux. À côté de ça, on voit une liste de bonnes intentions, certes. Mais c’est un peu plus que ça. Les partenaires sociaux vont être consultés sur le thème de la «protection sociale pour tous». La Commission estime que les différences entre travailleurs dans un même État membre et entre États membres sont trop importantes. Cette consultation va concerner les «travailleurs atypiques». On pense aux travailleurs à temps partiel, aux indépendants, aux travailleurs de l’économie collaborative. L’idée est de combler ces trous dans la protection de ces travailleurs, dans le domaine de l’assurance maladie, du chômage, des congés, des pensions. Les partenaires sociaux doivent se prononcer sur l’opportunité d’une directive ou d’une initiative européenne à ce sujet. Ce n’est pas rien.
AÉ: Sur quel autre aspect la Commission était-elle attendue avec ce «socle»?
BV: Beaucoup avaient espéré que la Commission propose une directive sur le revenu minimum en Europe. C’est évoqué dans les 20 principes, dans les objectifs à atteindre, mais sans proposition concrète de législation. Je comprends les critiques. Mais si le 17 novembre à Göteborg les États membres gardent 80% de ce qui est proposé, cela serait déjà très positif. Car les principes du socle devraient infuser dans toutes les politiques européennes. Dans l’orientation des fonds structurels, dans les programmes opérationnels des États membres, dans les rapports pays par pays que publie la Commission européenne, dans les initiatives de dialogue social qui seront enclenchées. Le socle pourrait, je l’espère, devenir le cadre de référence, un véritable levier. On voit déjà que les choses changent. Dans ses recommandations aux États membres, la Commission a intégré depuis peu la prise en compte des inégalités sociales. Si l’opportunité d’avancer sur des chantiers sociaux n’est pas saisie, le pourcentage de mécontents de l’Union européenne sera bien plus grand que les 42% actuels.
En savoir plus
«Médecins du monde pointe une nouvelle fois les faiblesses de l’accès aux soins en Europe», Alter Échos n°432, Marinette Mormont, 15 novembre 2016.