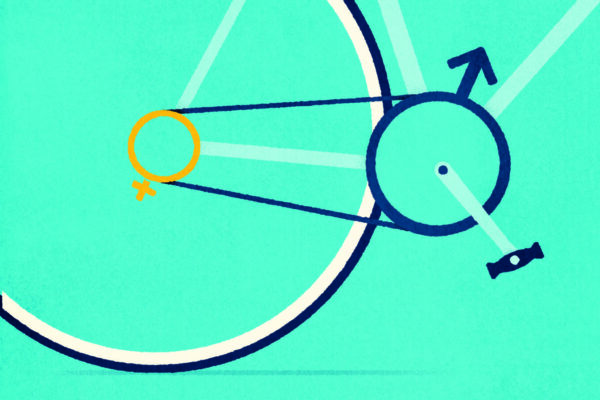Sylvie Pinchart: «À l’extérieur, ma parole est souvent remise en question»
Sylvie Pinchart: «À l’extérieur, ma parole est souvent remise en question»
Alter Échos: Quel est votre parcours?
Sylvie Pinchart: Je suis devenue directrice, un peu par hasard, lors d’un suivi de réunion, dans un café. J’étais à l’époque au Conseil supérieur de l’Éducation permanente pour les Femmes prévoyantes socialistes (FPS) et la directrice de l’époque m’a dit qu’ils cherchaient quelqu’un pour reprendre son poste, quelqu’un qui viendrait des organisations syndicales ou mutualistes. Je connaissais le projet de Lire et Écrire, étant déjà dans le CA de l’association dans ma région.
AÉ: Avez-vous pu facilement y trouver votre place?
S.P.: J’ai postulé et été engagée. Le fait d’être une femme n’a joué ni en ma faveur ni en ma défaveur. Lire et Écrire est un mouvement assez récent, plus proche de la culture syndicale et des organisations qui n’ont pas nécessairement réfléchi à une réflexion de genre et sont donc davantage dans la culture du rapport de forces. On le voit dans la structure pyramidale de l’association. On a du mal à avoir un CA équilibré entre hommes et femmes. Il y a chez nous 320 travailleurs, dont une majorité de femmes. On va vers une répartition plus équilibrée dans les fonctions d’encadrement, mais pas au niveau des directions et des directions adjointes. Dans ces structures, il y a même plus d’hommes aujourd’hui qu’il y a dix ans. La question clé est celle du leadership. Être leader ou pas leader… Or, par rapport à cette question, je préfère me demander comment on avance ensemble et sur quoi on peut être d’accord. La responsabilité, je ne la porte pas seule, je la partage avec mes dix autres collègues de direction.
On va vers une répartition plus équilibrée dans les fonctions d’encadrement, mais pas au niveau des directions et des directions adjointes. Dans ces structures, il y a même plus d’hommes aujourd’hui qu’il y a dix ans.
AÉ: Quels obstacles identifiez-vous au fait d’être une femme dans un mouvement qui n’a pas, dites-vous, de réflexion de genre?
S.P.: Ma parole est souvent remise en question. Sa légitimité aussi. Ma réflexion vient du terrain, de la confrontation avec celui-ci et notamment des milieux populaires. Dans mes contacts externes, les critiques peuvent être musclées. Je n’aime pas trop la confrontation, même si je n’ai pas de problème quand elle se situe au niveau des idées. Un jour, à un colloque, je me suis fait tacler par un prof d’université. J’étais invitée à m’exprimer sur l’évaluation des politiques publiques. Le professeur m’a interrompue en me demandant si j’avais lu le livre de je ne sais plus qui et m’a lancé: «Cela vous aiderait beaucoup.» Cette remarque, je l’ai subie parce que j’étais une femme non issue du monde universitaire.
AÉ: La conciliation entre vie familiale et professionnelle est souvent un défi. Comment cela s’est-il passé pour vous et y êtes-vous attentive?
S.P.: Je fais partie d’une génération charnière. J’ai travaillé avec des femmes de la génération «d’avant» qui ont tout donné, sans compter, celle qui a construit le féminisme. C’est une génération qui n’a pas forcément compris la mienne, notamment sur cet enjeu. La génération qui émerge, par contre, est beaucoup plus attentive aux conditions de travail, à la conciliation avec la vie privée. La difficulté pour une fonction d’encadrement comme la mienne, c’est de trouver les points d’équilibre entre les besoins individuels et légitimes du personnel et ceux de l’organisation du travail et du public avec lequel on travaille. Les fonctions d’encadrement sont de plus en plus lourdes et nous avons de moins en moins de candidats, et surtout de candidates. Chez les hommes, la volonté d’accorder plus de place à la vie privée reste quelque chose de marginal. Je le constate dans mon équipe où, pour les jeunes femmes, les choix de carrière restent très marqués par la répartition traditionnelle des rôles. Elles font plus de temps partiels alors que c’est très compliqué pour une organisation comme la nôtre de fonctionner avec des temps partiels.
 Sarah de Liamchine: pouvoir se dégager du syndrome de l’imposteur
Sarah de Liamchine: pouvoir se dégager du syndrome de l’imposteur
Alter Échos: Votre parcours?
Sarah de Liamchine: Je suis codirectrice de PAC depuis 2019. La codirection est un modèle que j’ai mis en place dès mon arrivée. J’ai de jeunes enfants, je ne voulais pas laisser une partie de mes responsabilités à un ou une adjointe. Au CA, ils n’ont pas beaucoup résisté, ils étaient surtout étonnés que quelqu’un veuille partager le pouvoir.
AÉ: Les obstacles principaux?
S.d.L: C’est d’abord qui je suis. Une femme, jeune, pas totalement blanche. Il faut pouvoir prouver qu’on est légitime. Au PAC, j’avais déjà occupé la fonction d’adjointe à la secrétaire générale, cela n’a donc pas posé de problème à ce niveau-là. La difficulté, c’est à l’extérieur et surtout de sortir du schéma de «la femme de service», de pouvoir dire que ce n’est pas parce que je suis une femme qu’on m’a invitée, mais parce que je représente une institution. Chez Solidaris, j’étais moins connue et j’ai senti davantage qu’on attendait que je fasse mes preuves. Ce sentiment a été renforcé par le fait que, comme beaucoup de femmes, j’ai le syndrome de l’imposteur. Il faut essayer de se dégager de cette dynamique, celle de devoir faire ses preuves plus que les autres parce qu’on est une femme. Sinon on entre dans une spirale qui engendre de la souffrance.
On m’a aussi beaucoup demandé comment je m’en sortais. Quand les gens découvrent que j’ai trois enfants de moins de 10 ans, on me demande systématiquement comment je gère ça. C’est une question que l’on ne pose pas à un homme. Avec le temps, j’ai construit ma réponse: mon compagnon prend sa part et, si les gens insistent, je leur dis: «Propose-moi de l’aide au lieu de me demander de me justifier dans mon organisation privée.»
Quand les gens découvrent que j’ai trois enfants de moins de 10 ans, on me demande systématiquement comment je gère ça. C’est une question que l’on ne pose pas à un homme.
Il est clair, qu’avec le mandat chez Solidaris en plus, je ne suis pas toujours très présente à la maison et ce n’est pas de gaieté de cœur. Mais quand on me rappelle cela sans cesse, ça vient réactiver une interrogation, à savoir si on a fait le bon choix. La nouvelle génération est plus attentive à cette conciliation avec le milieu du travail. Pareil chez les hommes. Je perçois davantage chez eux cette envie, une fois parent, de jouer leur rôle de père. Et ces hommes-là, on va les féliciter…
AÉ: Les femmes au pouvoir dans les associations ont-elles une manière différente de gérer les relations humaines?
S.d.L: Comme féministe, je devrais dire non (rire). Mais ce qui est sûr, c’est que comme beaucoup de femmes, j’ai été élevée à prendre soin des autres. Et donc quand on est dans une fonction de direction, cela se retrouve dans la manière de gérer. Un élément fondamental pour moi, c’est la question du respect des travailleurs et travailleuses. J’estime que, plus on a de responsabilités, plus on doit être attentif à la personne la plus éloignée de nous et à ce qu’elle vit. C’est sans doute encore plus vrai quand on est socialiste et femme.
La place des femmes à la tête des organisations progresse. Chez Solidaris, il y a une volonté affirmée de féminiser les instances de direction. C’est aussi une question de représentation. Dans les structures associatives, il y a toujours eu énormément de femmes. Il faut que les personnes qui travaillent au quotidien dans cette institution se reconnaissent dans les personnes qui l’incarnent.
AÉ: Vous avez évoqué les remises en question de votre légitimité. Cela se manifestait comment?
S.d.L.: PAC est un mouvement qui existe depuis plus de 50 ans, créé par le Parti socialiste et qui reste proche du PS en termes politiques. Le fait que j’amène le combat féministe et la question décoloniale a amené des remarques. On m’a demandé si j’étais socialiste ou féministe. C’est une question d’une bêtise incroyable. Heureusement, j’étais portée par tout un travail de terrain. Concrètement, la remise en cause se manifestait par les techniques classiques: couper la parole, hausser le ton… Des techniques d’hommes. Comme femme, on est aussi élevée à s’effacer. Se mettre en avant reste compliqué. Ce qui m’a beaucoup frappée, c’est que je n’ai pas eu nécessairement plus de soutien de la part des femmes que des hommes dans mon parcours. Le patriarcat a réussi à créer une rivalité entre les femmes. Au lieu de se dire qu’il n’y a quasiment pas de places pour les femmes dans certains endroits et qu’il faut y aller, on s’attaque aux femmes qui se battent pour y arriver. Cela m’est insupportable. Quand je partirai, je veux, a minima, qu’il y ait autant de femmes qui aient été portées à un certain niveau de responsabilités que quand je suis arrivée. Ouvrir la porte, c’est bien, mais faire en sorte qu’elle reste ouverte, c’est mieux.
 Ariane Dierickx: «Le féminisme est toujours vu comme un militantisme, pas comme une expertise»
Ariane Dierickx: «Le féminisme est toujours vu comme un militantisme, pas comme une expertise»
Alter Échos: Avant de devenir directrice de L’Îlot, vous étiez…
Ariane Dierickx: J’ai eu un parcours dans l’associatif presque depuis le début de ma carrière professionnelle. J’ai commencé comme chercheuse à l’université dans le domaine des inégalités hommes-femmes. Je suis devenue directrice d’Amazone. C’était important, mais ce n’était pas le travail de terrain que je cherchais, avec les personnes qui vivent les inégalités. J’avais besoin d’être dans l’action directe. J’ai vu passer une annonce, j’ai postulé et je n’ai jamais regretté ce choix.
AÉ: Vos premiers constats?
A.D.: J’ai senti que les questions d’égalité hommes-femmes n’avaient pas lieu d’être. Ce n’est pas propre à l’Îlot, mais au secteur du sans-abrisme en général. Le «social» n’est pas plus que le reste de la société, ouvert aux questions liées aux droits des femmes. Même aujourd’hui, ce n’est pas évident. Quand je suis arrivée à la tête de l’Îlot, j’étais la première femme à la tête d’une organisation fondée par un homme très charismatique et qui l’a portée pendant des décennies. J’étais la bienvenue au CA, mais c’était plus compliqué sur le terrain. J’ai bien senti que je devais faire mes preuves. J’avais l’étiquette de féministe et j’ai senti que je devais mettre celle-ci de côté en prouvant d’abord ma légitimité sur le terrain.
AÉ: Et comment avez-vous pu changer l’association?
A.D.: Chez Amazone, j’avais appris à travailler avec le monde politique. Ce n’était pas du tout une pratique de L’Îlot, ni même du secteur qui avait une vision caritative du travail social avant d’être dans le paradigme du droit des personnes. On me disait: «Nous, on ne fait pas de politique.» On vivait comme une fatalité le fait que les sans-abri tournent dans le secteur parce qu’il n’y a pas de porte de sortie. À mon arrivée, c’était l’époque des subsides doublés à l’approche de l’hiver. J’ai détourné ce subside pour créer la première cellule qui trouve du logement. J’ai créé progressivement le réflexe de travailler en réseau, sur des thématiques transversales pour tous les publics qu’on accompagnait. Cette logique de travailler avec les partenaires a porté ses fruits, en rendant le secteur plus fort face au monde politique.
AÉ: Comment gérez-vous la question de la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, pour vous et pour le personnel?
A.D.: Très tôt dans ma vie professionnelle, en ayant de très jeunes enfants, j’ai été confrontée à cette question. Je connais donc les difficultés d’une vie familiale avec un engagement professionnel fort. L’Îlot est un secteur pénible parce qu’il fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. J’ai cherché à réinventer la manière de travailler en mettant en place une gouvernance partagée. Cela m’a pris cinq ans. Aujourd’hui, on est dans un modèle très horizontal avec des responsables de terrain qui sont dans un mode collaboratif très poussé. Avoir des conditions de travail permettant d’avoir une vie de famille, tout en répondant aux exigences de disponibilité de l’organisation, cela a un coût, celui d’engager plus de personnes qu’il ne le faut.
Cette question du sans-abrisme féminin est très «touchy». Je venais d’un secteur où je savais que la pauvreté est essentiellement féminine, mais parler des femmes dans le sans-abrisme, c’est comme si je parlais chinois.
On met des moyens supplémentaires avec des étudiants pendant les vacances, on remplace les travailleurs dès le premier jour de maladie… Ce sont des choix onéreux, mais qui nous paraissent indispensables pour créer chez les travailleurs le sentiment d’être respectés. Nous avons aussi créé un groupe de travail qui interroge la place de la femme dans l’organisation et les relations hommes-femmes au sein de celle-ci.
AÉ: De la sorte, vous avez pu concrétiser votre engagement féministe…
A.D.: Quand j’ai commencé à L’Îlot, il n’y avait que des directeurs de terrain. Toutes les décisions stratégiques se faisaient uniquement entre hommes. J’ai progressivement féminisé le CA, créé de nouveaux services au sein desquels, chaque fois, j’ai veillé, à compétences égales, à engager une femme. Cela a été compliqué à faire passer, mais, aujourd’hui, nous sommes dans une organisation composée pour moitié de travailleuses et qui accompagne un public qui est aussi féminin. Cette question du sans-abrisme féminin est très «touchy». Je venais d’un secteur où je savais que la pauvreté est essentiellement féminine, mais parler des femmes dans le sans-abrisme, c’est comme si je parlais chinois. Les femmes ne sont pas dans la rue, mais cachées, en grande précarité et en mal-logement. J’avais de la peine à convaincre mon auditoire, tant à L’Îlot que dans le secteur, où il n’y a toujours pas de culture féministe. Le féminisme est toujours vu comme un militantisme, pas comme une expertise. L’Îlot voudrait embarquer le secteur dans ces questions, celles de la place des femmes dans les postes de direction et du public féminin des sans-abri.