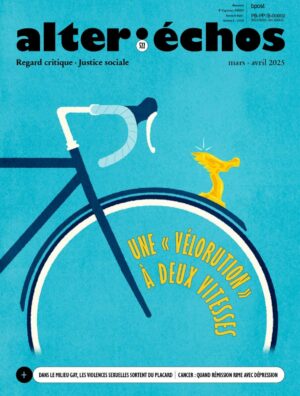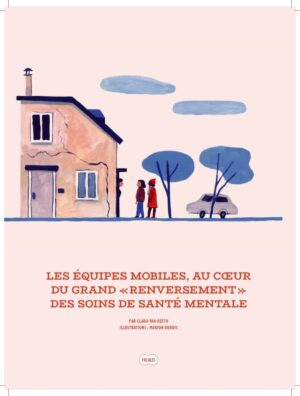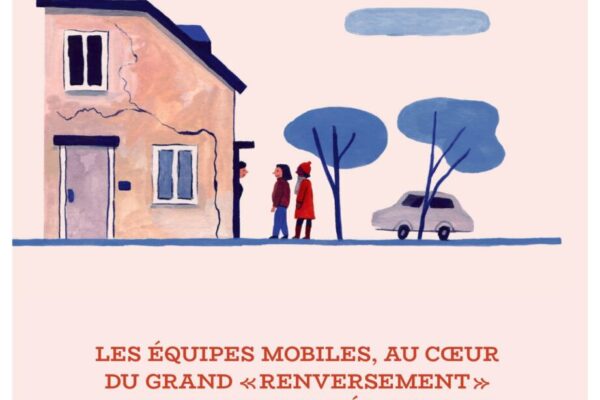Traditionalisme, c’est le mot qui vient d’abord à l’esprit à la lecture de l’analyse menée par l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) qui s’est penché sur la question des familles monoparentales et recomposées, en fonction de la manière dont est organisée la garde des enfants.
Au niveau de la fréquence des différents types de garde, François Ghesquiere, chargé de recherche à l’IWEPS, observe en effet un certain «traditionalisme», qui s’éloigne d’une représentation mettant en avant des parcours familiaux et conjugaux faits de ruptures et de recompositions. «Il y a quand même une évolution: il y a plus de familles monoparentales qu’avant, et elles sont moins stigmatisées que par le passé, explique-t-il. Mais c’est une évolution en demi-teinte: s’il y a plus de familles monoparentales, on n’est pas non plus dans la fin du couple, de la famille.»
Dans les données analysées par l’IWEPS, la famille traditionnelle résiste, et est même majoritaire: en effet, environ trois quarts des enfants vivent encore avec leurs deux parents (soit environ 1.800.000 enfants en Belgique, dont 500.000 en Wallonie).
«Surtout, les couples plus aisés ‘réussissent’ mieux leurs familles: quand on regarde le niveau d’éducation et le diplôme des parents, les enfants avec des parents plus diplômés vivent moins en situation de monoparentalité.»
Une affaire de femmes
Parmi les enfants de parents séparés, François Ghesquiere constate que la situation des enfants de parents séparés est assez diversifiée, même si la garde confiée à la mère reste largement majoritaire. «On observe là aussi un certain ‘traditionalisme’, lié à une forte inégalité de genre. La situation la plus commune est celle d’enfants qui vivent la totalité du temps avec leur mère.» Statistiquement, cette situation est vécue par deux enfants de parents séparés sur cinq, soit 10% de la totalité des enfants en Belgique (soit environ 230.000 enfants en Belgique, dont 100.000 en Wallonie). Un enfant sur six vit la plupart du temps chez la mère, mais en passant une partie des vacances et des week-ends chez leur père (soit environ 90.000 enfants en Belgique, dont 40.000 en Wallonie).
«On observe là aussi un certain ‘traditionalisme’, lié à une forte inégalité de genre. La situation la plus commune est celle d’enfants qui vivent la totalité du temps avec leur mère.»
François Ghesquiere, IWEPS
Dans l’ensemble, les modes de garde après une séparation s’éloignent assez nettement de l’objectif de la loi de 2006 qui visait à privilégier l’hébergement égalitaire, relève l’IWEPS.
La garde partagée égalitaire est en effet bien plus rare: elle n’est vécue que par un enfant de parents séparés sur cinq, soit 5% de la totalité des enfants en Belgique (soit environ 120.000 enfants en Belgique, dont 40.000 en Wallonie).
«L’impression qui sort de ces chiffres est que lors d’une séparation, s’il y a un intérêt pour l’enfant de garder un lien avec le père, on privilégie la garde partagée; par contre, si la situation fait que ce n’est pas possible, pas souhaitable pour l’enfant de maintenir ce lien avec son géniteur, on est dans un modèle de garde majoritairement avec la mère.»
Un risque inégal
Autre intérêt de l’étude de l’IWEPS: le lien entre les différents modes de garde et le niveau de vie des familles.
«Dans l’étude, on constate que si la séparation conduit à une paupérisation plus importante chez tout le monde, le risque de faire face à une séparation n’est pas égal chez tout le monde. Ce risque n’est pas réparti de façon équivalente entre les classes sociales, et les milieux les plus précaires ont plus de risques de faire face à une séparation. En outre, la manière dont la séparation se vit n’est pas la même entre les classes les plus populaires et les classes aisées.»
Ainsi, les familles en garde partagée égalitaire ont en moyenne un niveau de vie proche des enfants de parents non séparés.
Par contre, les enfants qui vivent tout le temps avec leur mère font face à beaucoup plus de difficultés. À titre d’exemple, parmi les enfants de parents non séparés et ceux en garde partagée égalitaire, moins de 15% n’ont pas les moyens de partir en vacances. Ce pourcentage s’élève à 20% chez les enfants vivant la plupart du temps chez leur mère et monte jusqu’à 50% pour ceux qui vivent uniquement chez leur mère.
«Dans l’étude, on constate que si la séparation conduit à une paupérisation plus importante chez tout le monde, le risque de faire face à une séparation n’est pas égal chez tout le monde. Ce risque n’est pas réparti de façon équivalente entre les classes sociales, et les milieux les plus précaires ont plus de risques de faire face à une séparation.»
François Ghesquiere, IWEPS
«Cependant, rappelle François Ghesquiere, on ne peut toutefois pas attribuer la totalité de ces différences de niveaux de vie à la séparation comme à la manière dont elle s’est déroulée.» En effet, les profils des parents dans les différentes situations ne sont pas les mêmes. «Les mères qui se retrouvent constamment seules avec leurs enfants sont en moyenne moins diplômées que celles qui partagent la garde de leurs enfants avec leur ex-conjoint, dont les niveaux de diplômes sont similaires à ceux des mères non séparées.»
Par exemple, alors que la moitié des mères non séparées ou qui ont une garde partagée égalitaire de leurs enfants ont un diplôme de l’enseignement supérieur, seul un quart des mères qui ont la totalité de la charge de leurs enfants ont un tel diplôme.
«On retrouve aussi des différences de statut d’emploi», ajoute François Ghesquiere. Les mères ayant la garde partagée égalitaire travaillent pour plus de 80% d’entre elles et en majorité à temps plein, tandis que les mères ayant la majorité de la garde des enfants sont 70% à travailler et privilégient le temps partiel (40%). Et celles qui les ont la totalité du temps sont plus fréquemment allocataires sociales que les autres. «Même si la majorité de ces dernières travaillent tout en s’occupant de leurs enfants.»
Un manque de soutien
«On remarque aussi, poursuit François Ghesquiere, qu’une minorité seulement de ces mères seules bénéficient du soutien financier de leur ex-conjoint.»
Ainsi, seul un enfant sur trois dans ce type de garde vit dans un ménage bénéficiant d’une pension alimentaire, contre près de deux sur trois pour ceux qui vivent en majorité chez leur mère, mais ont encore des contacts réguliers avec leur père.
«Il y a toute une série de situations où les pères ne sont vraiment plus là, que ce soit financièrement ou temporellement. C’est vraiment marquant. Cette faiblesse de l’aide financière reçue par les mères les plus démunies devrait amener à repenser et renforcer le soutien à ces femmes qui se retrouvent à assumer toutes seules l’éducation et les frais liés aux enfants.»
Pour cela, l’IWEPS avance deux pistes: d’une part, en exigeant plus de soutien de la part des pères, même quand ils n’ont plus de contacts avec leurs enfants à travers par exemple un renforcement du SECAL, ce service du SPF Finances qui intervient pour récupérer les pensions alimentaires impayées, ou à travers des sanctions pénales effectives et plus importantes en cas d’abandon de famille; d’autre part, l’État et la Sécurité sociale pourraient soutenir plus fortement ces familles «à travers des mesures d’aides spécifiques aux familles monoparentales, mais aussi par des aides plus universelles envers les enfants, qui, si elles sont moins ciblées, ont l’avantage de limiter le non-recours au droit qu’on peut imaginer fréquent dans ces situations».