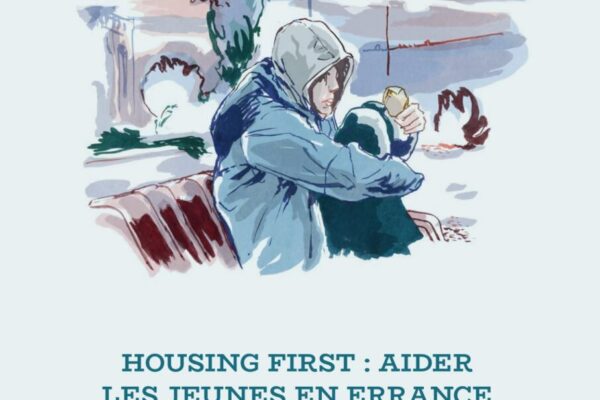«Nous, on n’a que deux préoccupations dans la vie: survivre un jour de plus dans les rues de Charleroi et trouver notre prochain fix.» Nadia, issue d’une famille défavorisée de Charleroi et Arnaud, à peine sorti de l’Université, sont deux jeunes squatteurs en proie à leur addiction à l’héroïne. Les deux protagonistes du roman 24 heures héro ont pris vie dans la tête de Saphir Essiaf (travailleur social à la cellule sdf du CPAS de Charleroi) et Philippe Dylewski (écrivain et formateur) à la suite d’un travail de documentation dans le milieu des squats et de la drogue à Charleroi. Interview.
Alter Échos: Comment vous est venu le sujet particulier de ce roman?
Philippe Dylewski: Après avoir travaillé avec trois maisons d’édition, j’ai voulu monter ma propre maison d’édition dont le thème consiste à raconter des histoires extraordinaires qui arrivent à des gens ordinaires. Quand j’ai expliqué cela à Saphir, que je connais depuis vingt ans, il m’a proposé d’aller visiter les squats de Charleroi. Le sujet était tout choisi.
Saphir Essiaf: Je suis travailleur social. La motivation, pour moi, c’était d’aller plus loin. Ce travail d’enquête sur le terrain est différent du travail pour lequel je suis mandaté. C’était l’occasion pour moi d’enfiler une autre casquette. Au départ il s’agissait surtout expérimenter autre chose. On voulait suivre des gars et à travers leurs yeux, vivre leur vie. Créer une aventure avec deux héros. C’est peut-être aussi une forme d’exutoire, parce que je fais un boulot parfois lourd à porter. Coucher les choses sur papier, c’était sans doute une manière de comprendre pourquoi ça fait dix ans que je bat le pavé…
A. É.: Philippe Dylewski, c’était une problématique que vous connaissiez auparavant?
P. D.: Non, mis à part le fait que j’habite à Charleroi… J’avais un regard tout neuf. Je ne vous dis pas le choc que j’ai ressenti la première fois que je suis rentré dans un squat… J’ai parfois voulu comparer ça à des zones de guerre, mais ce n’est pas la même chose. Le niveau de destruction est comparable. Le reste, non. Dans une zone de guerre, les gens tout ce qu’ils veulent c’est reconstruire. Pas ici…
A. É.: Saphir Essiaf, vous travaillez dans le secteur depuis quinze ans, comment percevez-vous les évolutions de la problématique à Charleroi?
S. E.: Il y a des mutations: le public est de plus en plus jeune, de plus en plus en errance, de plus en plus fragile psychologiquement, de plus en plus violent. Et les produits sont de plus en plus destructeurs. Il y a quinze ans, c’était encore la fin de la période du vieux clochard grisonnant. Ce profil-là n’existe plus.
A. É.: Quelle sont les parts de fiction et de réalité dans le livre?
P. D.: C’est une compilation d’histoires vraies. Les personnages, Arnaud et Nadia, ont été créés à partir d’une dizaine de pièces rapportées. Au départ il n’y avait qu’un personnage, celui d’Arnaud. Saphir trouvait qu’il fallait y ajouter un personnage féminin. Je n’étais pas très chaud. Parce que écrire dans la tête d’un toxicomane, ce n’est déjà pas facile, alors écrire dans la tête d’une toxicomane… Finalement c’était une bonne idée parce que la toxicomanie féminine et masculine, ce sont deux réalités très différentes. Et des femmes, il y en a beaucoup plus qu’avant.
A. É.: Les deux héros ont aussi des histoires familiales très différentes et ne pas sont issus des mêmes milieux socio-économique. Vous avez voulu montrer la diversité des profils?
P. D.: Oui, cela démystifie le phantasme de l’arrivée dans la came. Le mythe de la pauvre fille ou du pauvre mec qui vient du quart-monde et à qui on a mis une seringue entre les orteils dès le petit déjeuner. Ça existe, mais en fait, il y a de tout.
A. É.: Comment vous y êtes-vous pris pour documenter ce travail?
P. D.: On a fait des tours dans les squats, ça c’est pour les éléments de décor. Mais dans les squats, on ne rencontre pas vraiment les gens. L’image que la plupart des gens ont des squats, les squats des années septante où on joue de la guitare et où tout le monde rigole, ça n’existe pas. Même l’image véhiculée par un film comme Trainspotting, ça donne une vision un peu romantique de la came. Car dans les squats, il n’y a pas de bande de copains. Les gens, on les a rencontrés dans la rue, en se baladant dans la ville, en nous asseyant et en prenant un verre avec eux. Cela s’est fait assez facilement. Ils étaient tous très contents de nous raconter leur histoire. Pour les détails techniques sur la manière de consommer, nous avons aussi discuté des professionnels qui travaillent dans le secteur.
S. E.: Quand on a fait les enquêtes les gars étaient pleinement participants et pleinement collaborants. Ce n’est pas comme si on avait fait un truc pour eux mais sans eux…
A. É.: Quel était l’objectif poursuivi derrière ce livre?
P. D.: À la base, on voulait juste écrire un bouquin et puis passer au suivant. Mais écrire ça, ce n’est pas exactement pareil que ce j’avais fait par le passé. Les personnages m’ont poursuivi. On s’est dit que cela avait peut-être un sens d’en faire autre chose. Ce que j’ai vu a cassé toutes mes croyances. Donc le premier objectif est de changer l’image qu’ont les gens de ces personnes: ce sont des gens. Quand vous croisez des toxicomanes dans la rue, qui chient dans une poubelle, qui sont morts mais qui marchent encore, c’est difficile d’avoir beaucoup d’empathie. Et ça, cela a changé.
A. É.: Aujourd’hui, vous proposez des animations sur le sujet…
P. D.: On a commencé à être contactés par des politiques, des institutionnels, des écoles pour des animations. L’idée est de sortir des affirmations mensongères de certaines grandes campagnes de prévention: faire croire que si on touche à un produit une fois, on devient dépendant. Si un jeune est en contact avec quelqu’un qui consomme, il se rend bien compte que ce n’est pas vrai. Deuxième chose, la prévention ne met pas toujours l’accent sur un facteur qui est déterminant: quel est le cadre de la première consommation? Tout le monde sait que toute première consommation ne se fait que dans un contexte amical. La vraie difficulté, c’est que c’est extrêmement compliqué de dire non dans ce contexte-là. On se sert du livre pour parler de ça. Les jeunes ne peuvent pas s’identifier aux personnages parce qu’ils en sont trop éloignés. Mais ils peuvent commencer à se poser des questions. Une des questions de l’animation est: comment les personnages en sont-ils arrivé là ? Et le seul point commun, c’est qu’ils ont commencé.
A. É.: Votre objectif est donc de dissuader à la consommation? Il y a beaucoup de personnes qui consomment de façon gérée, récréative. Votre message est qu’il ne faut jamais rien essayer?
P. D.: Nous ne voulons pas dissuader la consommation, mais le démarrage. Une fois que vous êtes dans la consommation, c’est un autre registre. La plupart des consommations ne vont pas poser de problème, effectivement. Mais le message est différent en fonction de l’âge du public. Le public que nous visons sont les jeunes de 15 à 18 ans et là, oui, c’est le message qu’on veut faire passer. Le message dépend de la maturité du public.
S. E.: Il y a un proverbe arabe qui dit: «Un peu ça réchauffe, beaucoup ça brûle.» Une bière, ça se déguste avec sagesse. La consommation, c’est la même chose. Il faut se poser la question du «pourquoi?» et du «comment?». Il faut savoir aussi que quand on consomme, dès le départ, le produit est coupé, transformé. Rien que ça, ça donne à réfléchir. Vouloir consommer, c’est une chose, mais vouloir consommer un produit qui n’est pas consommable, c’en est une autre.

24 heures héro, Fièvre jaune, Saphir Essiaf, Philippe Dylewski, 2016.
Disponible sur www.fievrejaune.be