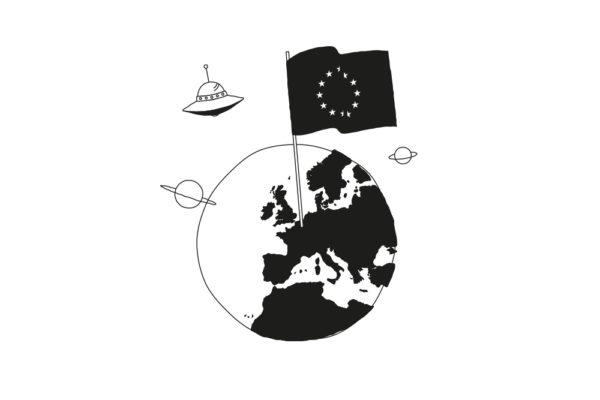Face à l’essor de la «nouvelle économie», la Commission européenne veut veiller à protéger les travailleurs des plateformes et à garantir leurs droits sociaux. Le but: faire rimer progrès technologique et avancées sociales.
Des sushis, des bagels ou un énorme poulet à l’ananas… Ou alors, un bon burger bien gras? Et pourquoi pas une pizza? Celle-ci sera livrée en 12 minutes seulement. Après tout, il est déjà 22 heures, la journée a été longue, l’estomac crie famine et, dehors, la pluie tombe à verse. Alors oui, pizza ce sera. Quattro formaggi, supplément huile piquante, merci. Même pas besoin de dégainer une carte de paiement, l’application l’a enregistrée depuis longtemps.
Dans le vaste univers de la «foodtech», que ce soit avec Uber Eats, Deliveroo ou autre Frichti, le cérémoniel, côté consommateur, est toujours le même: choix méticuleux du plat, attente impatiente de sa livraison, réception de la notification «votre commande est prête», coup de sonnette, déballage anxieux d’un grand sac en carton («Est-ce qu’ils ont pensé à l’huile?!»), dégustation, digestion.
Mais qu’en est-il du livreur, maillon central de cette chaîne, qui permet un déroulé des opérations réussi mais qui n’a souvent droit qu’à un bref «merci» avant que la porte d’entrée ne se referme sur lui? La nouvelle Commission européenne, qui est entrée en fonction le 1er décembre, veut tenter de mieux garantir les droits de ces milliers de «riders» européens, de même que ceux de l’ensemble des «travailleurs des plateformes numériques», toujours plus nombreux sur le Vieux Continent.
Payés à aller le plus vite possible
Des chauffeurs d’Heetch aux traducteurs de Upwork en passant par les coursiers de Stuart, dans l’UE, cinq millions de personnes travailleraient par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, selon les chiffres d’un rapport du Parlement européen publié en octobre 2019. Tout cela dans des conditions parfois très difficiles.
Jérôme Pimot se définit comme un «militant anti-ubérisation». Il a d’abord travaillé pour Tok tok tok, une plateforme de livraison de repas française (fermée depuis), puis pour sa concurrente belge Take eat easy (fermée aussi), puis pour l’entreprise britannique Deliveroo, avant de cofonder le Collectif des livreurs autonomes parisiens (CLAP). L’«ubérisation» qu’il dénonce, il la définit comme un «abus de plateformisation, un trop-plein d’applications qui crée des travailleurs pauvres exclus du salariat et dont on peut faire varier le tarif en fonction de l’offre et de la demande».
Deliveroo, par exemple, n’a eu de cesse de modifier ses tarifs: le paiement à l’heure n’a pas perduré longtemps; il a rapidement été remplacé par une tarification à la course. Pour les livreurs, une lutte incessante contre la montre commence alors: plus ils livrent, plus ils gagnent d’argent. Quitte à se mettre en danger. «Nous sommes payés à aller le plus vite possible. Si on n’a pas fait un gros chiffre d’affaires, c’est de notre faute. Et après on s’étonne qu’on grille des feux rouges et qu’on tombe comme des mouches», soupire Jérôme Pimot. Lui-même a été victime de deux accidents.
L’été dernier, la plateforme a commencé à payer les courses en fonction du temps estimé de livraison, supprimant le prix plancher qui était de mise jusqu’alors pour les livraisons dites «courtes». Dans de nombreuses villes, des manifestations ont été organisées dans la foulée. Côté UberEats, le recours aux «bonus» est fréquent: en cas de forte demande par exemple, pour inciter les livreurs à enfourcher leur vélo ou grimper sur leur scooter, quelques euros supplémentaires leur sont promis, en plus du prix de base de la course.
Comment une situation pareille est-elle possible? C’est du côté du statut de ces travailleurs «atypiques» qu’il faut chercher une explication. Ils ne sont pas des salariés, mais des indépendants qui ne sont jamais «engagés» à proprement parler par les plateformes (qui se gardent d’ailleurs bien d’utiliser des termes comme «contrat», «recrutement» ou «salaire» et recourent plus volontiers aux notions de «partenariat», d’«activation» ou de «chiffre d’affaires»). Résultat des courses: d’une part, leur accès à la protection sociale est très limité, et d’autre part, ils n’ont pas le droit de s’organiser comme des employés «classiques». Face à cette situation, Jérôme Pimot estime que le fait de revoir les règles du jeu pour les travailleurs des plateformes est «une nécessité, une urgence sociale et sociétale».
« L’ubérisation qu’il dénonce, il la définit comme un «abus de plateformisation, un trop-plein d’applications qui crée des travailleurs pauvres» »
Au travail
De manière générale, l’ambition de la Commission européenne est donc d’améliorer les conditions de travail de ces «nouveaux» travailleurs, en œuvrant prioritairement sur les volets «protection sociale» et droit d’organisation à la manière des syndicats. La nouvelle présidente Ursula von der Leyen a demandé à la Danoise Margarethe Vestager – qui a conservé le portefeuille de la Concurrence (qu’elle détient depuis 2014) et est devenue vice-présidente de l’exécutif européen – de se pencher sur le sujet. Dans sa lettre de mission, l’Allemande lui souffle l’idée de se servir du futur «Digital Services Act», un texte qui s’annonce phare dans le domaine du numérique, pour arriver à ses fins. À Bruxelles, les juristes de la direction générale «Connect» sont déjà à pied d’œuvre.
Au volet des négociations collectives, Margrethe Vestager a, pendant son audition au Parlement le 8 octobre, laissé entendre que les travailleurs des plateformes devraient être autorisés à former des syndicats. «Les indépendants sont considérés comme des entreprises. L’UE considère que, s’ils s’associent pour négocier, la juste concurrence est faussée», détaille Franca Salis-Madinier, qui planche depuis longtemps sur la «gig economy» («l’économie des petits boulots», NDLR) et l’emploi pour le compte du Comité économique et social européen (CESE), un organe de l’UE qui permet notamment aux organisations de la société civile de se faire entendre. Selon elle, «l’argument est tiré par les cheveux: si un indépendant dépend d’une plateforme pour travailler, il est loin d’être, à lui seul, une entreprise autonome…»
Ainsi, dès 2015, un avis du CESE disposait qu’«afin de lutter contre l’augmentation des inégalités de revenus qui découle en partie de la numérisation, il y a lieu de promouvoir la négociation collective à tous les niveaux, et notamment dans les secteurs et les entreprises concernés par la numérisation. Il sera ainsi possible de garantir que les nouvelles formes d’organisation du travail liées à la numérisation améliorent la qualité des emplois au lieu de la détériorer».
Margrethe Vestager, commissaire européenne, a laissé entendre que les travailleurs des plateformes devraient être autorisés à former des syndicats
Revoir totalement le droit de la concurrence serait un chantier d’envergure, qui prendrait des années. En revanche, instaurer des exceptions aux règles actuelles semble plus réaliste, et ce afin de contourner l’interprétation de la législation selon laquelle une entente entre travailleurs des plateformes (faussement qualifiés d’indépendants) constituerait un cartel.
Notons que, pour Franca Salis-Madinier, il existe aussi d’autres axes de travail. «Dans cette nouvelle économie, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Il faut distinguer ceux qui louent de temps en temps un logement sur Airbnb, car ils ont un appartement en plus du leur, de ceux qui comptent sur les plateformes pour vivre», estime-t-elle. Pour ces derniers, souvent en situation précaire, elle a esquissé des pistes de solution qui, elle l’espère, trouveront écho au sein de la nouvelle Commission – la seule institution à même de proposer une législation. «La Commission pourrait revoir la définition des travailleurs, même ceux des plateformes, en disant que dès lors que leurs revenus proviennent d’une situation de subordination prouvée, alors ils sont salariés et ont accès aux droits qui en découlent», expose Franca Salis-Madinier. Elle liste, pêle-mêle, la sécurité sociale, la retraite, l’assurance maladie ou la formation.
Les aspects sociaux à la trappe
Reste que la tâche sera peut-être compliquée. Au Parlement européen, Pervenche Berès, ex-eurodéputée socialiste qui a pris sa retraite en mai, a bien conscience du casse-tête qui découle des nouvelles formes de travail. Des mois durant, elle a élaboré un rapport, au nom du Parti socialiste européen, sur «les droits des travailleurs et le progrès social dans l’économie numérique». Et selon elle, pour l’heure, l’UE a été bien trop timide.
Elle se souvient: «En 2014, les problèmes concernant les travailleurs des plateformes étaient déjà bien identifiés. C’est l’époque où l’on négociait le Socle européen des droits sociaux. Quelle foutaise, ce truc! On a redéveloppé du ‘blabla’, réaffirmé de grands principes, et résultat, on n’a plus eu le temps de mettre sur pied une véritable législation.»
Pervenche Berès compte plus sur le Luxembourgeois Nicolas Schmit, commissaire désigné à l’Emploi (et socialiste comme elle) que sur la libérale Margrethe Vestager pour prendre le sujet à bras-le-corps. Responsable du marché intérieur, Thierry Breton, ex-patron du groupe informatique Atos, participera aussi aux travaux. «Mais ce ne sera pas facile, concède Pervenche Berès. En Europe, il y a une fascination pour le numérique et l’idée que le continent doit rattraper son retard en la matière tourne à l’obsession. Résultat: les aspects sociaux passent à la trappe.»
Poussées par la loi d’orientation des mobilités (LOM) tricolore, quinze plateformes ont annoncé mi-novembre se doter d’une «charte de bonnes pratiques» censée améliorer conditions de travail et rémunérations. Le «Digital Services Act» devrait contribuer à faire avancer les plateformes, petites ou grandes, dans la même direction. L’exécutif européen promet de mettre ce texte sur la table avant fin 2020.
À découvrir sur le web: L’Europe sociale sera ou ne sera plus
Le 26 mai dernier, tous les électeurs d’Europe étaient appelés aux urnes. Les élections européennes ne passionnent pas les foules, ni même les partis politiques. Dommage, parce que les députés européens ne sont pas des hommes de paille. Leur pouvoir de décision est aussi fort que celui des États et, au-delà des grands enjeux médiatisés – migrants, crise de la dette grecque, Brexit –, l’Union européenne prend des décisions dans des domaines très variés, dont des enjeux sociaux et, surtout, environnementaux. Cette Europe sociale a souvent bien du mal à s’imposer à l’agenda européen. La crise financière et les années d’austérité sont passées par là. Et le dialogue social, longtemps bloqué à l’échelle européenne, cherche un second souffle. Mais tout n’est peut-être pas perdu…