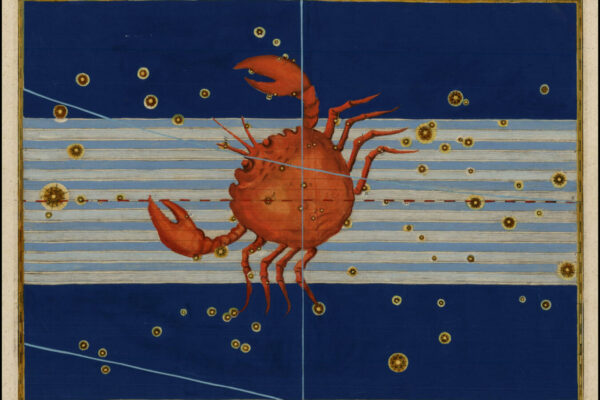Alter Échos: À quand remonte la conscience que le travail peut être à l’origine de cancers?
Anne Marchand: Fin XIXe, début XXe, on commence à identifier des cancers liés au travail, comme les cancers de la vessie causés par les colorants de synthèse, des cancers de la peau et du sang en lien avec les rayonnements ionisants, et des cancers de la peau en lien avec des produits dérivés de la houille, du charbon et du pétrole, dans la filiation du «cancer du petit ramoneur», découvert par Percival Pott en 1775. Ce chirurgien anglais a eu l’idée d’interroger sur leur travail des hommes qu’on pensait atteints de la syphilis et a découvert qu’ils avaient tous été petits ramoneurs dès l’âge de 5 ans parfois. La corde maintenue dans l’aine mettait la suie en contact avec la peau, d’où le développement de cancers du scrotum, la peau des testicules. Avant 1940, en France, quatre cancers étaient déjà reconnus comme indemnisables en tant que maladies professionnelles. Mais après la guerre, c’est la question du tabac qui va prendre le pas sur la question de l’origine professionnelle du cancer. Dans les années 70, de nouvelles mobilisations sociales remettent les dangers cancérogènes sur le devant de la scène, notamment les fumées de soudage, l’amiante, etc.
AÉ: Vous identifiez ensuite un nouveau recul sur les dangers cancérogènes au travail.
AM: En période de crise économique, les préoccupations sur la santé au travail passent souvent en dernier, y compris dans les mobilisations sociales. Parce que le travail, c’est aussi un revenu… c’est donc aussi la santé. Aujourd’hui, les approches holistiques de la santé nées dans les années 70 se sont effacées au profit de visions plus conservatrices: celui qui sait, c’est le médecin, et ce que le médecin interroge, ce sont les comportements «déviants», puisque toutes les campagnes de santé publique sont organisées autour des comportements dits «individuels», ce qui sociologiquement est un non-sens: on ne décide pas un jour de fumer tout seul dans son coin.
«Celui qui sait, c’est le médecin et ce que le médecin interroge, ce sont les comportements ‘déviants’.»
Ce qui brouille un peu plus les pistes, c’est le cloisonnement des espaces de santé, avec une distinction entre santé publique, santé au travail et aujourd’hui santé environnementale. Or, il ne faudrait pas oublier que beaucoup de pollutions environnementales trouvent leur source au sein des espaces de travail… C’est une manière de diluer les responsabilités.
AÉ: Vous avez mené votre enquête auprès de deux cents salariés et retraités atteints d’un cancer, au sein du Giscop93 (Groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine professionnelle), un dispositif de recherche-action. Comment s’y prend-on pour attester l’origine professionnelle d’un cancer?
AM: Le Giscop93 est ancré sur le territoire de la Seine–Saint-Denis qui fut longtemps et densément industriel. Plusieurs acteurs avaient constaté un taux de surmortalité par cancer très important. L’idée fut alors de se doter d’un outil pour estimer la part du travail dans cette épidémie de cancers, notamment en retraçant les parcours professionnels.
« Beaucoup de pollutions environnementales trouvent leur source au sein des espaces de travail. »
Comme les cancers surviennent au-delà d’un temps de latence très important et qu’il n’existe pas de traçabilité institutionnelle des cancérogènes, un collectif d’experts est ensuite chargé d’identifier des expositions qui ont été le plus souvent méconnues par les salariés eux-mêmes. Quand un ancien métallurgiste dit par exemple qu’il utilisait des gants en cuir pour saisir des louches de métal en fusion, ces experts savent qu’à l’époque, les gants n’étaient pas qu’en cuir et contenaient de l’amiante.
AÉ: Le cancer est considéré comme une maladie multifactorielle, ce qui complique la reconnaissance.
AM: Certaines maladies sont considérées comme des maladies «signatures» d’une exposition à l’amiante, comme le mésothéliome ou cancer de la plèvre. Mais, pour les autres cancers, c’est impossible de distinguer une cause de l’autre. Dans le cas du cancer broncho-pulmonaire chez des travailleurs des fours à coke, les substances incriminées peuvent par exemple être les mêmes que celles contenues dans la cigarette, notamment les hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP).
Lors de l’élaboration d’un tableau visant à indemniser cette maladie, les débats ont cyniquement porté sur la correspondance entre l’intensité des fumées des fours et la consommation de tabac. C’est oublier que, dans l’espace de travail, les salariés sont subordonnés juridiquement à un employeur et que celui-ci a comme obligation de préserver leur santé et leur sécurité.
AÉ: En Belgique, la Fondation contre le cancer estime que la part des cancers professionnels sur l’ensemble des cancers est de 4 %, soit 1.850 nouveaux cas par an. Comment comprendre un tel pourcentage?
AM: On retrouve la même proportion à l’échelle internationale. La construction de ce pourcentage est rarement mise en question, à tel point que celui-ci fait un peu figure de dogme. Pourtant, à y regarder de près, c’est le résultat de probabilités construites au tout début des années 80 sur un petit nombre de cancers et un petit nombre de cancérogènes, qui n’ont jamais été réévaluées.
« On ne tombe pas seul dans la tragédie. »
Par ailleurs, on ne vit pas dans un bocal: tous ces cancérogènes ne font pas que s’additionner; ils entrent en synergie les uns avec les autres. Or, ces synergies n’ont pas encore été très étudiées: au contraire, longtemps les études épidémiologiques essayaient justement d’éviter les biais, c’est-à-dire s’efforçaient d’identifier une population d’étude exposée à une seule substance.
AÉ: Parallèlement, il existe une sous-reconnaissance des cancers en maladies professionnelles: en Belgique, si l’estimation basse est de 1.850 cas par an, Fedris (Agence fédérale des risques professionnels) n’en reconnaît que 100 chaque année. Vous constatez en France ce même type d’écart. Comment l’expliquer?
AM: Il y a plusieurs facteurs en cause. D’abord, les gens ignorent souvent avoir été exposés à des cancérogènes et ne peuvent donc faire le lien entre leur maladie et leur travail. Je me souviens, par exemple, d’un cadre commercial qui avait eu un parcours professionnel assez ascendant: son pneumologue avait trouvé des fibres d’amiante dans ses poumons, fait assez rare, car elles ne se voient pas toujours. Il ne comprenait pas. Mais en faisant des recherches sur Internet, il a fini par comprendre. Jeune, il avait d’abord été vitrier-mastiqueur. Il pétrissait à mains nues du mastic dans lequel il mettait un durcisseur, une poudre verte qui était en fait de l’amiante…
«Ce qui renforce la difficulté, c’est le recours à tout propos et souvent à contresens de la notion de résilience.»
À chaque fois qu’il allait en radiothérapie, il repassait devant les barres de HLM où il avait posé ces vitres en se désolant que d’autres gens soient encore exposés à ce mastic probablement en train de se dégrader.
AÉ: Ce non-recours au droit témoigne aussi d’une réticence à se reconnaître comme victime. Comme on le constate dans les violences sexistes et sexuelles, le qualificatif de «victime» est très répulsif, comme si on parlait d’un trait de personnalité alors qu’il s’agit d’une notion juridique.
AM: Ce parallèle est intéressant: «victime» est en effet une notion très équivoque, comme dans l’expression «Ne fais pas ta victime». Or, avant même le stigmate social, se percevoir soi-même comme victime est tout sauf évident. Cela nécessite de reconnaître que quelqu’un ou quelque chose est responsable de la situation dans laquelle on est, qu’on ne tombe pas seul dans la tragédie, que ce n’est pas une fatalité. Comprendre la notion de préjudice n’est pas simple non plus. Un patient qui constate que, depuis son cancer, il ne peut plus aller au marché parce qu’il est essoufflé aura tendance à se dire «c’est normal puisque je suis malade» alors que cela peut être considéré comme un préjudice lié à l’amiante. Ce qui renforce cette difficulté, c’est le recours à tout propos et souvent à contresens de la notion de résilience selon laquelle «OK, tu es victime, mais bouge-toi» ou encore «après l’épreuve, on est plus fort».
AÉ: En matière de maladies professionnelles, puisque la seule réparation possible est financière, certains malades et leurs familles craignent de passer pour des «profiteurs».
AM: La loi de réparation des maladies professionnelles a fait basculer tout ce qui était de l’ordre des maux du travail du droit commun vers un droit assurantiel. C’est pourquoi le terme «victime» est absent dans ce contexte de responsabilité sans faute pour les employeurs. On ne propose donc aux personnes qu’un horizon indemnitaire, ce qui est aussi l’un des freins à la reconnaissance, car, pour beaucoup de gens, ça n’a pas de sens. Certaines veuves disent: «Je ne toucherai jamais à cet argent.» Et puis il y a le regard extérieur: entendre quelqu’un leur dire «vous faites ça pour l’argent», c’est très difficile, surtout quand on s’est construit sur l’idée qu’on ne doit rien à personne, qu’on n’a jamais demandé d’aide sociale.
AÉ: Or sans reconnaissance, pas de prévention des risques…
AM: Effectivement. Je me souviens d’une femme qui me disait «j’ai honte»: elle ne voulait pas déclarer son mésothéliome en maladie professionnelle, mais elle y avait été obligée par son fils. Quatre anciennes collègues de sa mère étaient déjà décédées et il estimait qu’elle avait ce devoir, pour elles, «pour les autres».
«La sous-traitance est devenue dans les faits une sous-traitance des risques.»
Mais à côté, il y avait son mari, qui était contre, car il avait l’impression que, si elle déclarait, alors lui ne servirait plus à rien, que c’était à lui de l’aider dans cette épreuve… Une situation assez emblématique des dilemmes moraux rencontrés.
AÉ: Dans un monde du travail dominé par l’incertitude, quel avenir pour la reconnaissance des maladies professionnelles?
AM: Aujourd’hui, l’un des grands obstacles à la reconnaissance est la sous-traitance, qui est devenue dans les faits une sous-traitance des risques: les entreprises externalisent les activités les plus exposantes comme la maintenance, l’entretien. Donc les personnes qui sont dans ces activités sont aussi dans les formes d’emploi les moins protectrices: l’intérim, l’auto-entrepreneuriat, le CDD à temps partiel. Elles sont donc non seulement les moins protégées, mais si le cancer survient, on sera aussi moins à même de faire le lien avec le travail. La vraie question au final, c’est de savoir si on a encore envie de travailler avec des produits toxiques pour fabriquer des choses qui vont intoxiquer les consommateurs et finalement pourrir l’environnement…