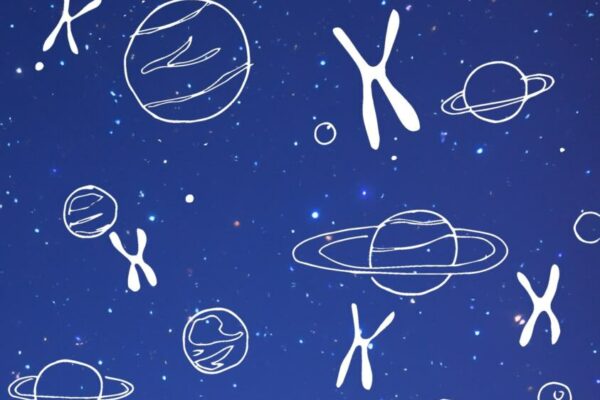Durant quatre ans, Benjamin Wilputte, jeune cinéaste carolo, a récolté divers témoignages sur l’assistance sexuelle avant de se lancer dans la réalisation de Touché, un court-métrage, docu-fiction, qui met en scène Margaux. La jeune femme témoigne de son parcours en tant qu’assistante sexuelle aux personnes en situation de handicap, des problématiques liées au sujet et de la légitimité d’une telle profession… Si les personnages sont fictifs, les dialogues sont des condensés de témoignages authentiques sur la pratique, telle qu’elle se vit en Belgique, alors que le pays n’a toujours pas de législation en la matière.
Alter Échos : Dans votre court-métrage, Touché, vous abordez la problématique de l’assistance sexuelle. Comment est né le projet et pourquoi ce sujet ?
Benjamin Wilputte : Je n’ai pas de lien personnel avec la thématique. Dans mon entourage, personne ne vit en situation de handicap. Par hasard, je suis tombé un jour sur le témoignage d’un père de famille suisse, qui expliquait, qu’une à deux fois par mois, sa femme lui permettait d’aider des personnes en situation de handicap à découvrir des zones érogènes de leur corps, à redécouvrir le plaisir. Je dois avouer que je ne connaissais pas la thématique. Je me suis renseigné sur la problématique en Belgique et me suis rendu compte que c’était un sujet tabou. La société a déjà du mal à reconnaître une identité sexuelle chez les personnes en situation de handicap. Alors l’assistance sexuelle, n’en parlons pas. A la fin du film, Margaux, l’assistante sexuelle, précise que le jour où la société considérera les personnes handicapées comme étant des individus ayant un besoin et des désirs sexuels, elle aura fait un fameux pas en avant.
A.É. : En parlant d’avancée, le comité consultatif de bio-éthique conseillait en janvier dernier aux autorités d’instaurer un cadre législatif, afin que l’institution où réside la personne handicapée ou l’association de l’assistant sexuel ne puissent être poursuivies pour incitation à la prostitution. Les assistants devraient également être formés, comme c’est déjà le cas en Suisse… C’est un pas important, selon vous ?
B.W. : En effet. C’est intéressant d’avoir un cadre légal qui reconnaisse la profession et la pratique. Cette reconnaissance permettra aux assistants sexuels d’avoir une même formation comme en Suisse. Ils pourront exercer leurs soins avec le même bagage. Les formations restent encore basiques ici, pas aussi poussées qu’en Suisse. Mais les lignes bougent depuis quelques années déjà. En Flandre (et en Wallonie également, ndlr), l’asbl Aditi, coordonnée par des orthopédagogues, des psychologues et des psychothérapeutes, propose depuis plusieurs années un service d’assistance sexuelle aux personnes handicapées qui en font expressément la demande. L’asbl travaille avec près de 80 personnes formées pour être assistants sexuels. La formation dure généralement dix-huit mois, même si l’accompagnement est continu à travers des séminaires. Il y a des entretiens pour établir si la personne est stable psychologiquement, si sa situation familiale l’est également, etc. Cet encadrement permet de partir sur de bonnes bases pour rendre possibles des contacts physiques autres que ceux liés aux soins et à la vie familiale. Il y a souvent la crainte qu’il y ait un attachement sentimental entre les deux personnes, mais grâce aux formations, tout est fait pour que le bénéficiaire ne s’attache pas sentimentalement à l’assistant sexuel, qu’il n’y ait pas d’attente, ni de déception amoureuses. D’où l’importance d’un cadre. De même dans les institutions, les choses changent aussi. Certaines ont encore beaucoup de mal à reconnaître que les personnes en situation de handicap ont du désir. D’autres font déjà appel à des assistants sexuels, sans que cela soit officiel, ne serait-ce que pour conserver la confidentialité des personnes. Un cadre légal permettra aux institutions de régulariser la situation. Mais cela ne se limite pas à une seule question d’organisation. Souvent les familles sont réticentes à l’assistance sexuelle : elles ne considèrent pas que l’un de ses membres vivant en institution ait ces besoins, ce désir. Un cadre législatif permettra de mettre la lumière sur la problématique et d’apporter des réponses là où il y a des interrogations.
A.É. : Vous évoquez les freins au sein des institutions, ceux parmi les familles. Le tabou qu’il y a autour de la sexualité des personnes en situation de handicap… Il y a une autre critique au sujet de l’assistance sexuelle, c’est le lien fait par certains avec la prostitution…
B.W. : Le rapport avec une prostituée et un assistant sexuel n’est pas le même. Dans l’assistance sexuelle, la connaissance de l’autre est primordiale. Il s’agit d’abord d’un choix des deux côtés. Si un bénéficiaire demande à rencontrer un assistant sexuel, il se peut que cela ne convienne pas. On n’impose pas un assistant sexuel. Il y a le respect de l’attirance, du premier contact, des premières impressions. Avant qu’il y ait un contact charnel entre les deux, il se passe souvent plusieurs séances. Chacun va apprendre à se connaître, et ce temps est nécessaire pour aider les bénéficiaires à découvrir leurs attentes, et pour permettre à l’assistant sexuel de répondre au mieux à ces besoins. Assistant sexuel ne signifie pas qu’il y a forcément un contact physique, charnel. Il peut très bien aider un couple qui vit en institution à se retrouver dans sa relation, en les accompagnant pour adopter certaines positions. Il y a une connaissance de l’autre plus approfondie dans un échange entre un assistant et un bénéficiaire, qu’avec une prostituée. En outre, il y a ce respect réciproque qui n’existe pas quand on fait appel à une travailleuse du sexe, même si ce recours existe aussi en institution. Ceci dit, certaines d’entre elles, notamment d’anciennes prostituées, deviennent assistants sexuels parce qu’elles sont dans une recherche de don de soi, avec l’envie d’être là pour quelqu’un d’autre.
Propos recueillis par Pierre Jassogne
Le film est visible sur YouTube
En savoir plus
Assistance sexuelle: les ébats mettent en émoi, par Manon Legrand, Alter Échos, décembre 2018.