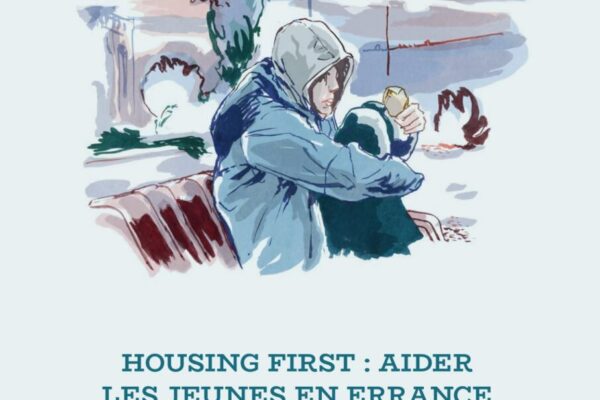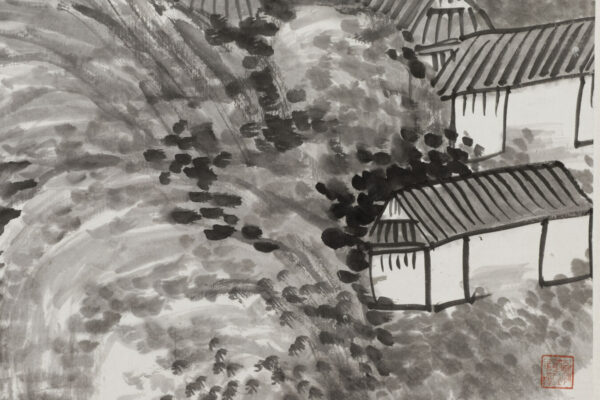L’occupation temporaire de bâtiments vides a le vent en poupe. Historiquement issue du milieu contestataire du squat, elle est devenue un secteur d’activités à part entière, où entrent en concurrence collectifs, associations et entreprises.
Dans cet hôtel bruxellois fermé depuis plus d’un an et demi, la vie a repris ses droits. Il y a sept mois, les membres d’un collectif qui veut rester anonyme ont investi les espaces communs et se sont réparti la vingtaine de chambres. Certaines d’entre elles abritent aussi régulièrement des personnes sans papiers, tantôt un sans-abri à la rue, tantôt un étudiant fraîchement expulsé de son logement par son propriétaire.
Juste après leur intrusion dans les lieux, les occupants signalent leur présence à la police, à la commune et au voisinage. De fil en aiguille, ils rencontrent les échevins du logement et de l’urbanisme de la commune. Mais, mis à part une mise en demeure pour expulsion reçue il y a trois mois, toujours aucun contact avec le propriétaire. «Avec ou sans convention d’occupation, nous aimerions pouvoir rester ici jusqu’au début des travaux», explique l’un des occupants.
Le collectif est entré dans cet hôtel bruxellois «à l’ancienne». Autrement dit, sans accord préalable du propriétaire. L’occupation – précaire, temporaire, transitoire, selon la philosophie qui la sous-tend – se veut aujourd’hui plus légaliste. À l’heure où l’occupation illégale d’un bâtiment est criminalisée dans le cadre de la «loi anti-squat» votée en 2017, les conventions d’occupation, négociées avant d’investir les lieux, sont devenues monnaie courante et certains propriétaires, publics ou privés, font appel eux-mêmes à des occupants.
Logement pour tous vs logement précaire
La formule a été médiatisée dans les années 2000 grâce aux actions de l’asbl Woningen123Logements (anciennement 321 Logements). Après avoir occupé l’hôtel Tagawa pendant quatre ans, elle négocie en 2007 une convention d’occupation avec la Région wallonne, propriétaire d’un immeuble de bureaux situé rue Royale. Un groupe d’anciens squatteurs et de sans-abri y séjourneront pendant plus de dix ans. À la base du mouvement: la nécessité de se loger et d’échapper à la rue pour certains, la volonté de mettre en œuvre un idéal politique, celui d’une vie communautaire et autogérée, pour d’autres. Et enfin, la dénonciation de la vacance immobilière.
Les logements vides sont traditionnellement estimés à 15.000 ou 30.000 à Bruxelles. Un chiffre employé depuis plus de quinze ans et à prendre plus qu’avec des pincettes. Le chiffre de 30.000 logements vides est cité dans le plan régional de développement durable de 2002, et se base sur un recensement datant de 1991. Quant aux 15.000, ils ont été estimés sur la base du nombre de compteurs d’eau dont la consommation est inférieure à 5 m2 par an et sont issus du rapport d’activité 2003 de l’Intercommunale bruxelloise de distribution d’eau. Dans les faits, le nombre de logements vacants semble impossible à estimer, à l’exception des logements publics.
Aujourd’hui, 2.700 logements sociaux sont vides pour cause de rénovation. Ceux-ci sont au cœur de projets menés par la Fédération bruxelloise de l’union pour le logement (Fébul) depuis 2006. Cette association passe des accords avec les sociétés immobilières de service public (SISP) de Forest, Evere et Ixelles afin de loger des personnes qui peinent à trouver un toit sur le marché privé ou des publics plus «alternatifs» qui souhaitent expérimenter un autre mode de vie.
Les conventions avec le secteur public (SISP et agences immobilières sociales) sont prévues par le Code du logement bruxellois depuis 2012. Pourtant, n’ayant pas toujours bonne presse ni auprès de la Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) ni auprès des SISP, elles ne sont pas légion. Elles occasionnent une surcharge de travail, suscitent des craintes liées à la sécurité des bâtiments (les SISP pourraient être tenues responsables en cas d’accident) et posent des questions d’ordre éthique: «Comment justifier aux candidats locataires qui attendent depuis des années que d’autres personnes ont accès à un logement dans ce cadre? Comment dire à ceux qui ont dû vider les lieux pour que le logement soit rénové qu’il est occupé par d’autres, alors qu’il est dans le même état que quand ils y habitaient? Plus fondamentalement, notre mission de service public est-elle remplie alors que des petites conventions sont signées sur le côté pour seulement quelques mois d’habitation?», explique Cécile Coddens, du service d’études de la SLRB.
«Comment justifier aux candidats locataires qui attendent depuis des années que d’autres personnes ont accès à un logement dans ce cadre?» Cécile Coddens, SLRB
Autre risque? Que l’occupation temporaire signe le développement d’un sous-secteur du logement, abritant des citoyens de «seconde zone» et échappant au droit du logement, un peu à l’instar de ce que l’on observe sur le marché de l’emploi où des sociétés comme Uber contournent les flous juridiques pour se jouer des droits sociaux. «On part du principe que, s’il y a des squats, c’est qu’il y a des besoins de logement non satisfaits. Mais on est bien conscient de l’ambivalence de l’occupation temporaire, explique Damien Delaunois, de la Fébul. On défend l’occupation temporaire comme un moyen pragmatique. Parallèlement il faut que les pouvoirs publics boostent la construction et la rénovation de logements sociaux, mettent en place un encadrement des loyers et aient une attitude plus ferme par rapport à la vacance immobilière. L’occupation temporaire n’est pas une solution structurelle.»
Le privé à la botte du propriétaire
L’épouvantail d’une «ubérisation du logement» est agité avec d’autant plus de vigueur que le secteur privé lucratif a rapidement pris le train en marche. Ces entreprises, qualifiées d’«anti-squat» (ex.: Camelot), ont fleuri aux Pays-Bas dans les années nonante avant d’essaimer dans le reste de l’Europe. Concrètement, elles proposent, d’un côté, à des propriétaires d’externaliser la gestion de lieux vacants afin d’éviter qu’ils ne soient endommagés et, de l’autre, à des personnes en recherche de logement d’occuper ces espaces pour des sommes inférieures au marché locatif classique.
Une étude sur ces entreprises menée aux Pays-Bas en 20161 dresse un relevé affligeant de leurs pratiques: critères de sélection des résidents, violations de la vie privée (visites d’inspection inopinées par exemple), règles et interdictions frisant l’absurdité (interdiction d’accès à des tiers), expulsions subites, augmentations des frais en cours de convention, problèmes de maintenance et soucis de santé liés à l’état des lieux, exigences de fournir un service de gardiennage du bâtiment.
C’est après «avoir visionné un reportage sur ce qui se passait aux Pays-Bas» que Dries Vanneste, directeur d’Entrakt, a créé sa petite entreprise en 2009, raconte Marion Rubellin, l’une des six salariés de la SPRL. Les contrats qu’Entrakt fait signer aux occupants comportent les interdictions de répondre à des interviews et de s’opposer à la demande de permis pour le projet final. L’entreprise est aussi pointée du doigt pour des hausses de prix en cours d’occupation ou pour le fait que le dépôt d’une garantie locative s’opère sur son propre compte bancaire et non sur un compte bloqué. C’est ce qui ressort d’une interview croisée de Dries Vanneste et de Pepijn Kennis, de la vzw Toestand, dans le journal Bruzz2. À ces critiques, le directeur d’Entrakt rétorque: «Notre rôle est de veiller à ce que tout se passe bien et à ce que nous ne causions aucun problème aux propriétaires, aux voisins, aux politiques, etc. […] Nous voulons garder le contrôle sur eux.» Quant au fait de louer des biens à des occupants en dehors du champ du droit du logement, il répond du tac au tac: «Ils n’ont pas cette protection sociale non plus avec vous (vous: l’associatif, NDLR).»
Le débat n’a pas l’air d’affoler les pouvoirs publics puisque ces derniers n’ont pas hésité à conclure des conventions avec Entrakt. En Flandre, le gouvernement a agréé l’entreprise en décembre 2018 comme gestionnaire de logements sociaux locatifs vacants en attente de rénovation3. À Bruxelles, des conventions ont été signées pour l’occupation de bâtiments publics par des espaces artistiques, professionnels et commerciaux.
Occupations vitrines
Le projet le plus emblématique d’Entrakt est sans doute Citygate, dans le quartier de Cureghem à Anderlecht. Les 22.000 mètres carrés de cette ancienne usine pharmaceutique appartiennent à Citydev et sont occupés par des artistes, des artisans, un skatepark (présent sur le site auparavant), une salle d’escalade et une salle «événementielle». «Un bar doit aussi être construit afin d’attirer un public plus régulier à des activités événementielles et culturelles», précise Marion Rubellin.
«Les acteurs publics, face aux sollicitations des entreprises privées, instrumentalisent l’occupation temporaire dans l’aménagement urbain (…)»Thomas Dawance, chercheur, VUB
Le projet «d’envergure, exemplaire au niveau de la mixité sociale et fonctionnelle», selon Citydev, témoigne-t-il d’une stratégie des pouvoirs publics d’utiliser l’occupation temporaire dans une perspective de développement urbain? C’est l’analyse que fait Thomas Dawance, sociologue et architecte, et chercheur à la VUB: «Depuis quelques années, les acteurs publics, face aux sollicitations des entreprises privées, instrumentalisent l’occupation temporaire dans l’aménagement urbain car ils prennent conscience qu’il y a un intérêt en termes d’image dans un contexte où toutes les villes sont mises en concurrence», décrypte-t-il4.
Côté associatif, on fustige ces projets qui s’adressent à un public de jeunes «hipsters branchés», participent à une gentrification douce des quartiers et relèguent à l’arrière-plan la question du logement. «Notre spécificité par rapport à des associations est que nous sommes capables d’investir plus au démarrage du projet, argumente Marion Rubellin. Par contre, c’est vrai qu’on ne gère pas le lien social entre les occupants, il se fait tout seul.» Quant aux liens avec le quartier, ils se réduisent à l’organisation de balades urbaines au cours desquelles les habitants sont conviés à visiter le site.
Vers une institutionnalisation?
La marchandisation de l’occupation temporaire en fait grimper plus d’un au plafond. Elle a poussé plusieurs associations (Communa, Toestand, la Fébul, le Bral, Woningen123Logements et la SAW-B) à se regrouper pour lancer la campagne de «La 20e commune» et rédiger un plaidoyer afin d’appuyer la dynamique d’une occupation temporaire à finalité sociale qui passerait par la création d’un «label». Objectif: pousser les pouvoirs publics à faire appel exclusivement aux porteurs de projets non lucratifs et inciter les propriétaires privés à faire de même.
«On défend l’occupation temporaire comme un moyen pragmatique.» Damien Delaunois, Fébul
L’asbl Communa est l’une des initiatrices du mouvement. L’association est née en 2012 du souhait de cinq jeunes étudiants de l’ULB de «vivre de manière différente, mais dans la légalité». Elle s’est peu à peu imposée dans le paysage de l’occupation temporaire. Devenue populaire auprès des propriétaires publics et privés pour ses bonnes pratiques de négociation et de gestion des lieux – tout en leur évitant d’avoir à payer taxes et amendes sur les lieux inoccupés –, l’asbl occupe aujourd’hui neuf sites et vient d’obtenir, dans le cadre d’un gros appel à projets, la gestion du bâtiment du Tri postal au cœur du quartier de la gare du Midi. Avec, à la clef, un subside de 100.000 euros.
«Au cœur de notre philosophie? Le droit à la ville pour tous. On voudrait que tout ce qu’on voit dans le film Demain puisse se passer aujourd’hui, en créant des écosystèmes plus humains et plus solidaires», explique Antoine Dutrieu, chez Communa depuis fin 2016. «Il y a eu cette idée, à un moment, de ne plus occuper des logements que pour notre intérêt personnel, mais aussi d’en faire profiter d’autres parce qu’on avait acquis une certaine expertise, poursuit-il. Aujourd’hui on est 14. On a commencé à se générer un salaire.» Cette professionnalisation fait grincer des dents à certains et a provoqué une scission dans le groupe. Fabian Duquesne s’est détourné de Communa il y a quelques années et dénonce leurs pratiques qu’il qualifie «du même genre que celles d’Entrakt ou de Camelot, avec un discours social derrière».
Aujourd’hui membre du collectif La Clef, Fabian est un habitué des caisses de déménagement: il passe d’occupation en occupation depuis une dizaine d’années. Depuis le deuxième étage d’une petite maison ouvrière de la Cité Volta à Ixelles, où il habite grâce à une convention signée entre la Fébul et la SISP BinHôme, il scrute ces évolutions avec un ressentiment non feint: «L’État a décidé de sortir le bâton de la répression et de voter une loi de criminalisation du squat. Il favorise en parallèle un marché du bâtiment vide à travers la carotte de la convention d’occupation. On a désormais affaire à deux publics distincts, d’une part les vilains squatteurs et de l’autre les gentils à qui on demande de bien respecter toutes les règles.»
Une métamorphose qu’Antoine, de Communa, ne conteste pas. «La fin du squat? Oui c’est possible que ça arrive, même si on va m’assassiner d’avoir dit ça. Mais ce n’est pas forcément un mal. Les squatteurs seront toujours une source d’inspiration, mais on veut faire bénéficier de ces espaces vides à plus grande échelle.»
Payer pour squatter
Les «frais de participation» des habitants dépendent de l’ampleur des travaux à réaliser pour rendre le bâtiment «occupable», ainsi que de la durée de l’occupation. À titre de comparaison, le loyer moyen d’un logement social est de 311 euros par mois sans les charges.
- Hôtel X: la participation est libre, souvent entre 70 et 200 euros. Rien n’est exigé aux personnes sans revenus.
- Fébul: la participation couvre un remboursement des travaux, une provision pour les charges et une épargne remboursée au terme de l’occupation (qui peut servir pour une future garantie locative par exemple). Elle peut tourner autour de 130-150 euros.
- Communa: la participation couvre la rénovation, une partie des salaires de Communa (20% du budget de l’asbl). Les apports sont «libres», mais tournent autour de 2 euros le m2 pour du logement, 3 à 5 euros le m2 pour des activités. Peu de gens occupent un espace gratuitement, mais c’est faisable en échange de travaux manuels.
- Entreprises privées lucratives: «Les prix varient selon la surface et l’état de l’espace», explique Marion Rubellin (Entrakt), sans en dire plus. 400 euros par mois pour un atelier de 90 m2 chez Entrakt, 300 à 350 euros pour certains logements, selon des sources indirectes.
- «Le développement des agences anti-squats: stratégies d’implantation et impacts sur le droit des individus à se loger décemment. Résultats d’une mission exploratoire au Bond Precaire Woonvormen», partenariat entre le Bond Precaire Woonvormen et les associations de droit au logement, Aurélie Baloche, novembre 2015-avril 2016.
- «De strijd om leegstaand Brussel: privé en vzw gaan in debat», Bruzz, 14/6/2019, disponible en ligne.
- Source: https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/erkenning_bvba_entrakt_als_beheerder_van_sociale_huurwoningen.pdf
- Interview de Thomas Dawance (VUB) dans le cadre d’un colloque de Metrolab.brussels, 9 avril 2019, disponible sur Youtube.
En savoir plus
«Loi anti-squat: quand le fédéral criminalise le droit au logement», Alter Échos n° 452, octobre 2017, Francois Corbiau.
«Propriétaires cherchent squatteurs», Focales n° 43, avril 2018, Léo Potier.