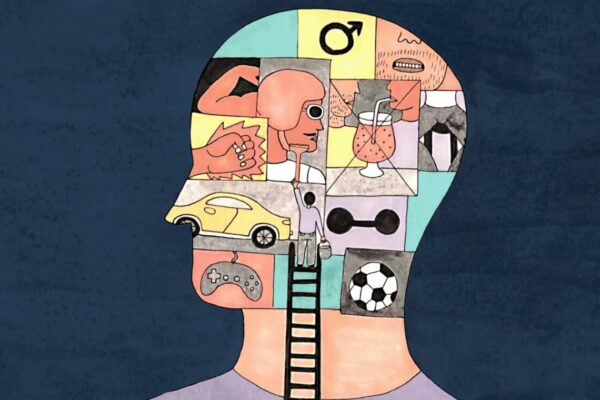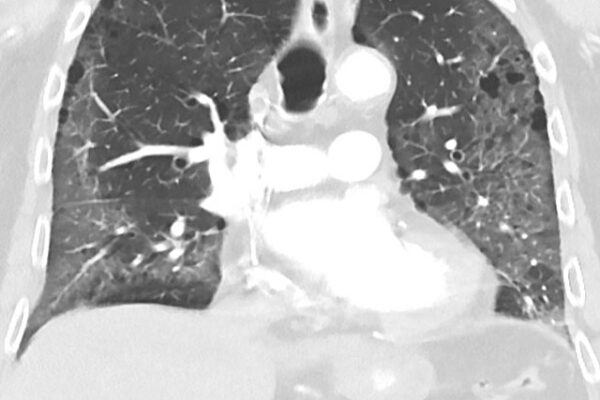Le réalisateur belge Jérôme le Maire a suivi pendant près de trois ans l’unité chirurgicale de l’hôpital Saint-Louis, l’un des plus grand hôpitaux de Paris. Inspiré du livre coup de poing Global Burn-out, du philosophe belge Pascal Chabot (1), le documentaire Burning Out (Dans le ventre de l’hôpital) retrace l’agonie du personnel soignant engagé dans une course à l’efficience qui détricote à la vitesse de l’éclair tout lien social et fait perdre aux soignant.e.s le sens et l’amour de leur profession. Jérôme Le Maire, cinéaste de l’intime, nous convie à observer au plus près la détresse absolue de ces chirurgiens, anesthésistes, infirmiers, aides soignants mais aussi cadres et gestionnaires. Son documentaire ébauche aussi leurs fragiles tentatives pour maîtriser l’incendie.
Le réalisateur belge Jérôme le Maire a suivi pendant près de trois ans l’unité chirurgicale de l’hôpital Saint-Louis, l’un des plus grand hôpitaux de Paris. Inspiré du livre coup de poing Global Burn-out, du philosophe belge Pascal Chabot (1), le documentaire Burning Out (Dans le ventre de l’hôpital) retrace l’agonie du personnel soignant engagé dans une course à l’efficience qui détricote à la vitesse de l’éclair tout lien social et fait perdre aux soignant.e.s le sens et l’amour de leur profession. Jérôme Le Maire, cinéaste de l’intime, nous convie à observer au plus près la détresse absolue de ces chirurgiens, anesthésistes, infirmiers, aides soignants mais aussi cadres et gestionnaires. Son documentaire ébauche aussi leurs fragiles tentatives pour maîtriser l’incendie.
Alter Échos: Pourquoi le livre de Pascal Chabot vous a touché et vous a inspiré ce documentaire?
Jérôme le Maire: J’ai aimé ce livre car il avait une approche peu courante du burn-out. Dans son ouvrage, Pascal Chabot ne l’appréhende pas comme la maladie d’un individu mais plutôt comme la maladie d’un système. Selon lui, le burn-out serait le trouble de notre société. Cette façon d’envisager le burn-out implique que tout un chacun se sent soudain responsable par rapport à cette maladie. C’est trop facile de dire que la personne est faible, de remettre ça sur des problèmes personnels. Quand on analyse le burn-out comme la pathologie d’un système, comme un trouble miroir de notre société, on se dit qu’on peut tous et toutes infléchir le processus et l’épidémie. Cette façon de concevoir le burn-out me parlait et m’incluait. Elle m’a dès lors donné l’idée de faire un film dans l’idée que le spectateur lui-même serait aussi inclus dans cette problématique.
Alter Échos: Le burn-out touche particulièrement le monde soignant, qu’on a pourtant du mal à imaginer «malade». Quelles sont les raisons qui vous ont amené à choisir le terrain de l’hôpital pour appréhender cette «maladie du système»?
Jérôme le Maire: En effet, les soignants, comme les enseignants d’ailleurs, font partie des personnes les plus à risques concernant les troubles psychosociaux. Le burn-out est cette «maladie du don de soi», qui touche ces personnes qui ont une grande estime de leur boulot et qui ne veulent pas le lâcher… jusqu’à craquer. Mais en fait, ce choix de l’hôpital Saint-Louis relève du hasard. Quant je suis rentré en contact avec Pascal Chabot, il m’a d’abord fait rencontrer des soignants, des managers, etc. Un jour, il a été invité à l’hôpital Saint Louis par Marie-Christine, l’anesthésiste (personnage phare du documentaire, NDLR). En sortant d’une de ses gardes, elle avait découvert le livre de Pascal et lui avait demandé de venir parler de son livre au sein du bloc opératoire. En palpant l’atmosphère lors de cette visite, je me suis dit qu’il se passait quelque chose d’important dans ce lieu. De plus, Marie-Christine s’est rapidement révélé être un personnage particulier, qui voulait changer le système. Elle est ce qu’on appelle dans le jargon, une toxique handler (ceux qui absorbent les toxines, les souffrances, les angoisses en vue d’agir vers une situation plus apaisée, NDLR). Elle impulse une belle dynamique dans une situation de crise ; un personnage idéal pour moi, qui ne voulais pas faire un film sur un état de fait, une problématique fixe, mais plutôt voir ce qui se met en place pour en sortir.
C’est trop facile de dire que la personne est faible, de remettre ça sur des problèmes personnels. Quand on analyse le burn-out comme la pathologie d’un sytème, comme un trouble miroir de notre société, on se dit qu’on peut tous et toutes infléchir le processus et l’épidémie.
Alter Échos: Vous filmez le burn-out en cours, le processus de «burnoutisation». D’habitude, on entend parler du burn-out à travers la voix de ceux qui s’en sont sortis…
Jérôme le Maire: J’avais envie de trouver un système burn-outé. A partir du moment où l’on porte les lunettes systémiques, on voit d’autres choses. On peut donc prévoir les choses et comprendre que ce système est en train de virer au burn-out.
Alter Échos: Formellement, vous avez opté pour le cinéma direct… Pour être au plus près de cet humain en souffrance?
Jérôme le Maire: Je fais du cinéma de l’intime, je tourne seul et dois être à 1m80 maximum de la personne si je veux avoir un dialogue audible, si je veux pouvoir sentir presque physiquement ce qui leur arrive. J’ai réussi à être dans l’intimité de chacun, même si cela a pris beaucoup de temps (un an et demi de travail sans sortir la caméra). En posant ma caméra en ces lieux, je suis devenu le dépositaire de la souffrance d’une personne qui sait que je suis le dépositaire de la souffrance d’une autre personne. J’ai vraiment la conviction que le fait d’avoir travaillé de cette manière-là a fait en sorte que les personnes se sont liées les unes avec les autres. À partir du moment où les soignants acceptent de témoigner en toute humilité et dans toute leur fragilité, devant la caméra qu’ils savent reliée à d’autres personnes, c’est le signe d’un système en voie de guérison.
Alter Échos: D’où la volonté de ne pas masquer votre présence, de laisser entendre vos interventions?
Jérôme le Maire: Je n’ai pas voulu cacher que la dynamique a été accélérée par ma présence. Inévitablement, une personne étrangère qui entre dans un huis clos, dans un système hermétique, crée un appel d’air et active l’incendie. J’ai demandé à pouvoir focaliser ma caméra sur le burn-out, forcément, les langues se sont déliées et les réactions ont fusé. Je voulais faire apparaître les ficelles de fabrication du film, qui témoignent que le lien humain n’est pas rompu, mais qu’en plus, il faut le travailler et qu’il s’agit de la responsabilité de chacun.
Alter Échos: Le temps du tournage était aussi celui d’un audit sur la qualité de vie au travail commandé par la direction. On comprend dans le documentaire que vous n’y croyez pas vraiment, je me trompe?
Jérôme le Maire: Ils ont commandité l’audit dans la foulée de l’acceptation du tournage. Pour moi, cela n’est pas un hasard. J’étais en effet très étonné d’avoir eu les autorisations de tournage alors que je voulais traiter de l’environnement pathogène de l’hôpital. Je pense que mon approche du burn-out, de façon systémique comme évoqué plus haut, a aidé à convaincre la direction à me donner les autorisations. Je leur ai bien dit que l’idée n’était pas d’opposer les méchants actionnaires aux gentils travailleurs, mais bien de montrer comment ce système, à l’image de notre système, devient pathogène pour les membres qui le composent. Je m’étais engagé à montrer aussi les efforts fournis pour se prémunir de ce genre de maladie. Très rapidement, je me suis rendu compte que l’audit coûtait très cher et donc, devait être rentable. À partir du moment où vous rentrez dans ce calcul, la qualité du travail, qui est une science molle et ne donne pas de résultat tangible, est passée à la trappe. Rentabilité, efficience sont devenus les principes phare de l’audit. Or, la qualité de vie au travail découle pas de l’argent qui rentre dans les caisses de l’hôpital. Le maître mot de mon film est de dire que l’humain est au centre. Finalement, les employés créent une boîte à questions et suggestions, ça paraît dérisoire, mais ça signifie qu’ils se réapproprient leur métier, qu’ils recréent du lien. C’est un mouvement de vie qui survient dans un univers pathogène!
Très rapidement, je me suis rendu compte que l’audit coûtait très cher et donc, devait être rentable. À partir du moment où vous rentrez dans ce calcul, la qualité du travail, qui est une science molle et ne donne pas de résultat tangible, est passée à la trappe.
Alter Échos: Vous ne voulez pas opposer les méchants actionnaires aux gentils travailleurs, dites-vous… Difficile toutefois de nier la pression financière et la logique de marché qui menace aujourd’hui les hôpitaux. C’est aussi cela que vous voulez dénoncer avec ce documentaire?
Jérôme le Maire: Oui, mais pas au nom des méchants actionnaires. C’est dramatique de se dire que l’hôpital public en est venu à intégrer les règles du privé et à considérer les patients comme des marchandises. Ca n’est pas pour ça qu’il y a un méchant dans l’histoire. À chaque niveau, les membres du personnel de l’hôpital sont dépassés par un leurre qu’ils n’atteindront jamais. Ils ne savent pas arrêter la course et se reposer la question: «Qu’est-ce qu’il en est de nous travailleurs?» Les membres du collectif ne demandent qu’une chose: réinvestir leur lieu de travail, renouer avec les uns et les autres, se reconnecter.
Alter Échos: Il y a eu plusieurs suicides pour épuisement professionnel ces derniers mois dans les hôpitaux français. Y avez-vous été confronté durant le tournage?
Jérôme le Maire: C’est un hasard mais je n’étais pas là quand il y en a eu. Et ça tombe plutôt bien. Je pense que le film est assez fort comme ça. Si j’ai évité au maximum de personnaliser les patients – on ne les voit presque jamais pour qu’on reste focus sur la douleur des soignants – on n’arrête pas de penser aux conséquences de cet environnement de travail pathogène sur les patients. Si j’en rajoutais et montrais les erreurs médicales ou les défenestrations de chirurgiens, le film serait devenu impossible à regarder. Mais il est évident que ce film fait écho à l’actualité qu’on connaît, et notamment à cette vague de suicides dans les hôpitaux.
Alter Échos: Ce bloc opératoire est aussi traversé de clivages professionnels. Comment avez- vous géré ces questions de hiérarchies et de conflits entre corps de métiers, parallèlement avec votre propos sur le mal-être généralisé?
Jérôme le Maire: Mon idée était qu’on considère tous ces gens comme étant égaux. Je voulais que le chef chirurgien soit au même niveau que l’aide soignante.
Alter Échos: Ils sont tous dans la même galère en effet. Mais vous ne pouvez pas faire fi des hiérarchies. Je pense à cette scène de conflit entre le chirurgien et une l’infirmière en pleine opération.
Jérôme le Maire: Cette scène ne veut pas insister les clivages de classe ou de genre qui traversent l’unité. Elle montre que tous les travailleurs sont dans une telle souffrance qu’ils en arrivent à s’aboyer l’un sur l’autre au-dessus de la table d’opération d’un patient… C’est évident qu’on ne peut pas éviter ces clivages et ces hiérarchies, très fortes. Mais malgré tout, j’essaye de faire ressortir en premier leur incapacité de dialoguer. En tant que premier spectateur de cette scène, j’étais moi-même incapable de dire qui avait raison ou tort. Si ce n’était qu’un problème de «classe sociale», je pense que j’aurais été capable de trancher et donner raison à l’un et tort à l’autre. Or ici, on est dans un entre-deux… Ils sont tous les deux épuisés.
Alter Échos: Est-ce que ce film vous a donné envie d’analyser le burn-out dans un autre milieu?
Jérôme le Maire: Pas du tout. Sur le plan personnel, c’était une expérience très éprouvante. J’ai ressenti la boule dans l’estomac en me rendant à l’hôpital… Mais surtout, j’ai l’impression d’avoir fait le tour du sujet du « burn-out dans notre système ». Le bloc opératoire fait figure de micro-système. Il raconte d’autres milieux, c’est l’avis de nombreuses personnes qui l’ont vu, que ce soit d’autres soignants ou d’autres milieux professionnels.
(1) Pascal Chabot, Global burn-out, Paris, Presses universitaires de France, coll. «Perspectives critiques», 2013, 145 p.
En savoir plus
Au cinéma Galeries et au cinéscope à LLN à partir du 3 mai.
Le 16/05 au Quai 10 à Charleroi
Le 23/05 au Plaza à Mons
Le 12/06 aux Grignioux à Liège
Possibilité aussi d’organiser des projections proches de chez vous ou de votre lieu de travail.
En savoir plus sur www.burning-out-film.com