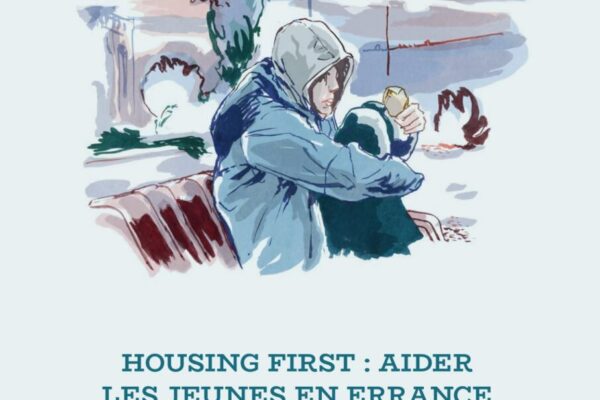Relire les articles que j’ai écrits il y a 30 ans pour Le Soir laisse une curieuse impression. Comme celle de revoir un film que l’on sait avoir vu mais dont les séquences ne correspondent plus au souvenir qu’on en a gardé.
Premier étonnement: le vocabulaire. On parlait comme ça en 91? «Un immigré», «un Marocain»… On se souvient alors que, oui, il y a 30 ans, les jeunes étaient encore vraiment d’origine étrangère. Les journalistes ne savaient d’ailleurs pas trop par quels termes les désigner. Les Flamands parlaient «d’allochtones», un mot qui accentuait encore leur «étrangéïté» et qui n’a jamais pris du côté francophone.
Mais il n’y a pas que les mots. Ceux qui parlent, les interlocuteurs de l’époque apparaissent bien vieillots. En 91, le consulat du Maroc s’invitait encore presque naturellement parmi les acteurs incontournables pour les pouvoirs publics. La police, les autorités communales étaient LA source évidente. Les associations de jeunes, pour les jeunes, elles, n’étaient nulle part, faute de poids et de représentativité. Les parents (les «immigrés marocains»), eux, étaient bien présents sur le terrain. Ils venaient d’ailleurs spontanément à notre rencontre.
Ces jeunes, je les ai rencontrés, quasi tous les jours, sur la place Saint-Antoine, mais aussi à Molenbeek, à Schaerbeek, avec les quelques rares travailleurs sociaux en qui ils avaient confiance. Mais ils sont si peu présents tant dans Le Soir que dans les autres médias.
Et les jeunes eux-mêmes? Ceux qui caillassaient les voitures de police comme ils l’avaient vu faire à la télé française? Dans les articles, on parle d’eux mais eux ne parlent pas ou si peu. Et c’est là que mes souvenirs ne correspondent plus à ce que je lis dans les articles. Ces jeunes, je les ai rencontrés, quasi tous les jours, sur la place Saint-Antoine, mais aussi à Molenbeek, à Schaerbeek, avec les quelques rares travailleurs sociaux en qui ils avaient confiance. Mais ils sont si peu présents tant dans Le Soir que dans les autres médias. Parce que «ça ne se faisait pas»? Parce que la «bonne» info se voulait distante, factuelle ou recueillie de préférence auprès des sources officielles? Je me souviens comme il fallait se battre au sein de la rédaction pour relayer les paroles du «terrain». Mes «vieux» collègues (pour moi!) ne semblaient pas percevoir le fossé grandissant entre les médias et les habitants des quartiers défavorisés. En 91, pour la première fois, des émeutiers s’en étaient pris aux symboles du monde médiatique comme les caméras de télévision de VTM. Mais, en même temps, l’excitation «de passer à la télé» était si forte! Les médias, on ne les rejetait pas mais la méfiance commençait déjà à poindre.
Dernier étonnement. L’ampleur donnée aux événements. Les émeutes étaient un «sujet», mais parmi d’autres. Comme le début de la guerre civile en Yougoslavie ou l’arrivée du TGV à Bruxelles. Et même si, au Soir, le courrier des lecteurs débordait, même si ces émeutes étaient tout de même une première (ou presque) dans un pays traditionnellement «calme», on n’en faisait pas les gros titres tous les jours. On n’ose pas imaginer les milliers de publications sur Facebook, les éditions spéciales du JT, les «dossiers» de plusieurs pages, les interviews d’experts et surtout les micros-trottoirs des jeunes, des habitants qui déferleraient aujourd’hui.
Un point commun tout de même. Il a fallu insister pour continuer à «couvrir» le sujet quand les violences ont cessé. Affronter les sourcils qui se levaient quand on proposait un papier plus politique. «Encore Forest?» Oui, encore Forest. Une info chasse l’autre. Cela n’a pas changé.