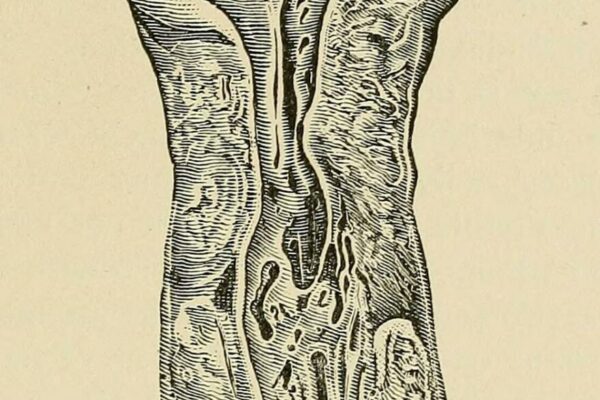Pour Pablo, le premier confinement a fait office de déclic: il a saisi la balle au bond pour venir à bout de son addiction, le chemsex (chemical + sex). La cinquantaine bien tapée, Pablo a pris des drogues lors de relations sexuelles pendant près de quinze ans. Si sa consommation s’est révélée inégale dans le temps et limitée aux week-ends, elle a fini par rythmer sa vie, laissant se volatiliser toute autre envie. Il y a quelques années, son train-train «boulot-conso-dodo» l’a poursuivi lors de son emménagement à Bruxelles, faisant voler en éclats toutes les promesses qu’il s’était faites: «Je consommais puis j’essayais de récupérer un maximum pour le retour au boulot. Après sept ou huit ans, j’ai commencé à voir cela comme un problème», résume-t-il.
Pablo a bien tenté de se faire aider. Ses premières tentatives chez des psychologues se soldent par un échec: «Allez-y, il y a huit ans, pour trouver à Bruxelles un psy qui avait entendu parler de chemsex, quelqu’un que cela ne mettait pas mal à l’aise.» Il se tourne vers le secteur «assuétudes» où il essuie autant de refus que de demandes d’accompagnement adressées. Son problème n’est «pas assez grave» – Pablo n’est pas un usager quotidien –, n’«entre pas dans les cases» – il ne colle pas au profil du toxicomane –, voire ne serait peut-être finalement pas un problème – pourquoi faire toute une affaire de ce lien entre produits et sexe? Pablo passe par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel – l’incompréhension, la déception, la colère – puis se persuade, tout bien considéré, que sa consommation n’est pas si incontrôlable. Avant de se raviser et de constater qu’il n’est pas le seul dans ce bourbier. «Je suis assez âgé pour avoir vécu la montée du VIH/sida. Au début, tous les milieux gay disaient que c’était ‘un petit problème’. Ici il y a quelque chose de cet ordre-là qui m’a frappé quand j’ai commencé à en parler sur Facebook ou avec d’autres hommes avec qui j’avais eu des rapports sous conso.» Car Pablo les repère ou les côtoie, ceux qui comme lui s’adonnent à ces plaisirs qui virent parfois au mauvais délire. Alors, puisque aucun service ne semble se préoccuper de cette addiction un peu particulière, Pablo et quelques autres prennent leur bâton de pèlerin et vont frapper aux portes d’associations LGBTQI+: ils souhaitent être pris au sérieux, se constituer une liste de psys susceptibles de les aider et ouvrir le débat sur ce phénomène, dévastateur pour certains, et qui va grandissant. C’est ainsi que voient le jour, en 2016, les groupes de parole et de soutien «Let’s talk about chemsex», animés par Pablo et ses pairs dans les locaux de la Rainbow House.
«À la fin du premier confinement, les demandes d’aide se sont accrues. On recevait quasi un appel par jour. Je n’imagine pas les dégâts que ça va faire.» Samy Soussi, asbl Ex Aequo
Un phénomène difficile à mesurer
L’association de produits psychoactifs – légaux ou illégaux – avec l’activité sexuelle à des fins de désinhibition, d’augmentation du désir et du plaisir, ou encore d’une amélioration des performances, remonte à la nuit des temps. Si le phénomène ne se limite pas à la sphère des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) et n’est pas toujours problématique, il a fini par retenir l’attention des milieux associatifs qui travaillent avec ce public. Favorisé par le développement des applications de rencontres géolocalisées et l’accessibilité toujours plus grande de produits sur Internet – notamment les nouveaux produits de synthèse, NPS –, il a explosé il y a une grosse vingtaine d’années aux États-Unis, avant de se disséminer dans les capitales européennes, puis d’atteindre à la dérobée bourgades et campagnes. Mais le flou des définitions du chemsex, le fait qu’il se développe toujours davantage dans la sphère privée et la difficulté à l’identifier – quelqu’un qui arrive aux urgences suite à une overdose ne spécifie pas le cadre dans lequel elle s’est produite – ne conduisent pas à une appréciation aisée de son étendue.
En juin dernier, deux ans après le décès de son époux Christophe Michel, âgé de 31 ans, à la suite d’une overdose au cours d’une session de chemsex, le militant dans la lutte contre le sida et dans le combat pour la légalisation de l’euthanasie et homme politique français Jean-Luc Romero (conseiller régional d’Île-de-France, maire adjoint de Paris 12e) publie l’ouvrage Plus vivant que jamais! Comment survivre à l’inacceptable?1 Une manière de faire son deuil bien sûr, mais aussi de tirer la sonnette d’alarme. S’appuyant sur un article qui compare, à New York, l’épidémie de sida chez les gays dans les années quatre-vingt à l’épidémie de chemsex aujourd’hui («Gay Men Are Dying From a Crisis We’re Not Talking About», New York Times, 22/1/2020), il évoque le tabou qui règne autour de cette question et qu’il entend briser: «Je n’ai jamais entendu un ministre de la Santé parler de drogues de synthèse ni de chemsex. Comme toujours, cela part des États-Unis, puis cela arrive en Europe: dans cinq ou six ans, cela concernera tous les publics. C’est un tabou chez les pouvoirs publics, mais aussi chez ceux qui le pratiquent, ceux-ci ont une difficulté à mettre des mots sur l’engrenage dans lequel ils se sont mis.» S’il est difficile d’évaluer l’importance de ces pratiques, «il suffit d’aller sur les applis de rencontre gay: un tiers des profils proposent du chemsex», explique-t-il. Selon lui, 50% des personnes qui consultent le service PrEPeur (qui distribue le traitement préexposition au VIH) de l’hôpital Saint-Louis à Paris font du chemsex et, parmi elles, deux ou trois personnes disparaissent chaque mois par suicide ou par décès. «Si on se base sur les chiffres de la police, on parle de 20 ou 30 morts par an à Paris, mais ce n’est pas révélateur de ce qui se passe aujourd’hui. Je pense que c’est un phénomène énorme» (lisez son interview complète sur www.alterechos.be).
«C’est un tabou chez les pouvoirs publics, mais aussi chez ceux qui le pratiquent, ceux-ci ont une difficulté à mettre des mots sur l’engrenage dans lequel ils se sont mis.» Jean-Luc Roméro, homme politique français
«À Bruxelles, les premières demandes de suivi étiquetées ‘chemsex’ remontent à 2013, se remémore Maurizio Ferrara, psychologue à l’asbl Infordrogues. Au départ, cela concernait toute une série de patients expats avec des fonctions et des salaires importants. C’était un problème particulier: des personnes qui travaillaient à Bruxelles et qui avaient commencé cette activité chemsex auparavant à Londres, Madrid, Rome.» Et de préciser: «Maintenant, cela concerne tout type de personnes.» Selon le lieu et les personnes interrogées, entre 5 et 20% de la population gay pratiqueraient le chemsex (au sens l’intention de consommer à des fins sexuelles, avec une ritualisation et une temporalité de cette consommation pour en potentialiser les effets), estime Sandrine Detandt, professeure de psychologie à l’ULB et chercheuse à l’Observatoire du sida et des sexualités (Université Saint-Louis), où elle clôture une recherche sur ces pratiques: «Le fait de nommer ce phénomène a certainement permis de visibiliser plein de gens. Mais on observe clairement quelque chose qui va crescendo entre 2010 et 2020.» «Avec les applis, cela prend deux minutes de rencontrer quelqu’un qui veut s’engager dans des pratiques de chemsex, confirme Pablo. C’est le cas à Bruxelles, mais aussi dans des plus petites villes en Wallonie. Le crystal meth (méthamphétamine, NDLR) semble quelque chose de marginal en Belgique, mais, dans la population urbaine des HSH et des gens qui sortent, pas du tout.»
Et ces pratiques sont loin d’avoir pris fin avec les périodes de confinement. Certains en ont profité pour se sevrer, mais les bouleversements dans notre rapport au temps ont amené d’autres à augmenter leur consommation, voire à la reprendre après un arrêt. «À la fin du premier confinement, les demandes d’aide se sont accrues. On recevait quasi un appel par jour. Je n’imagine pas les dégâts que ça va faire», s’inquiète Samy Soussi, coordinateur des projets prévention Chemsex à Ex Aequo, asbl de promotion de la santé.
Toutes classes sociales confondues
L’image du chemsexeur en costard-cravate qui se déplace de capitale en capitale pour ses «plans chem» est dépassée: le phénomène touche toutes les classes sociales et de plus en plus de jeunes, au point d’inquiéter les aînés. Certains jeunes de 20 ans ont déjà tout essayé, tout consommé, ont déjà eu trois perforations (de l’intestin, suite à des pratiques de pénétration par le poing – fist-fucking), témoignent ceux qui, au même âge, se contentaient d’inhaler des poppers et de s’envoyer en l’air dans des saunas. Une évolution qui inquiète les acteurs de terrain et qui dépasserait le cadre de la communauté gay. «D’une manière générale, les pratiques problématiques semblent moins fréquentes (et moins documentées) chez les hétérosexuels, mais il y a tout de même une inquiétude croissante quant aux jeunes qui témoignent avoir déjà eu, dès 13 ans, des dizaines de rapports sexuels à plusieurs en consommant de la kétamine ou du crystal», avance Sandrine Detandt.
«Il y a tout de même une inquiétude croissante quant aux jeunes qui témoignent avoir déjà eu, dès 13 ans, des dizaines de rapports sexuels à plusieurs en consommant de la kétamine ou du crystal.» Sandrine Detandt, Observatoire du sida et des sexualités (Université Saint-Louis)
Autre milieu qui attire l’attention depuis peu: la prostitution. L’association Alias, qui accompagne les HSH et les personnes trans en situation de prostitution, a mené une enquête sur le sujet parmi son public2. L’échantillon de 52 répondants ne permet pas d’avoir une vue exhaustive de la question, mais l’étude pointe la vulnérabilité de ces personnes qui mettent leur corps en jeu. Un tiers des personnes interrogées pratiqueraient le chemsex par envie, un quart uniquement à la demande du client et une petite moitié parce que leur souhait rejoint celui des clients. Se posent alors des questions liées au consentement et à la pression financière qui peut pousser à accepter des «plans chem» pour ne pas perdre de clients – «les escorts qui sont mieux avec la drogue gagnent beaucoup plus d’argent», témoigne l’un d’entre eux. Les voilà parfois contraints de bricoler pour éviter de (trop ou mal) consommer: «Un travailleur du sexe peut se retrouver chez un client avec de la poudre sans savoir de quel produit il s’agit. Certains font semblant de prendre, d’autres prennent un tout petit peu», illustre Alexandre Félix, travailleur social chez Alias. Le risque d’addiction induit par la profession n’est pas mince: parmi les répondants, près de la moitié déclarent pratiquer le chemsex une fois par semaine et 20% rapportent avoir déjà eu au moins une fois un échange sexuel dans le but de se fournir en produits. «On a tendance à croire que ce sont les plus privilégiés qui pratiquent le chemsex, car ce sont les plus visibles, commente Samy Soussi. Cela concerne aussi des travailleurs du sexe, des personnes racisées, des sans-papiers, des personnes obligées de dealer pour vivre et consommer, des personnes qui s’endettent jusqu’au cou. Il y a un truc beaucoup plus profond dans le théâtre du chemsex, un souterrain auquel on n’a pas accès.»
Des risques psychiques, physiques et sexuels
Là où certains ne font que passer, où d’autres s’égratignent, certains dérapent. C’est le cas de Xavier, dont l’histoire, à la fois banale et singulière, entremêle ce désir d’expériences inédites et un terreau de blessures familiales non pansées. Dès son deuxième plan chemsex, en son for intérieur, il se met en garde: «Il ne faut pas faire ça trop souvent.» Ecstasy, cocaïne, GBL, Tina (méthamphétamine), 4FMA (drogue de synthèse de la famille des amphétamines): il repousse pourtant ses limites, s’abandonne à des fantasmes jusque-là inconnus, éprouve des sensations autrement inaccessibles. Ses sens s’éveillent toujours plus, ses croyances se déplacent. Progressivement, les sessions s’étirent en longueur, se répètent et se rapprochent. «Le crystal meth, la première fois, ça ne fait pas grand-chose. C’est ça qui est dégueulasse avec ce produit. Ça travaille sur ton inconscient. Tu finis par ne plus penser qu’au sexe, et ça devient malsain: on a rencontré tout Bruxelles dans nos plans.» Un peu plus tard, il en vient au «slam» – dans le jargon, l’injection – et là, «c’est vraiment un autre effet». Une injection qui devient le rituel de ses plans sexuels. Puis de ses plans en ligne – «Je connaissais Zoom bien avant le confinement (rires) avec, parfois des salles de 100 personnes.» Puis de ses plans en solo – pourtant, comme beaucoup, il s’était dit: «Jamais tout seul.» Et là ça capote. Il évite les coups de blues à coups de nouvelles doses et, presque par mégarde, le geste devient quotidien. «C’est un piège: plus tu essayes de t’en sortir, plus tu t’enfonces dedans. À un moment, il faut plonger au fond du problème. Après, il n’y a plus qu’une chose à faire: remonter», confesse Xavier, affichant courageusement ses cinq semaines de sobriété.
Dans la communauté des HSH, plus sensible à l’isolement et au stress3, le chemsex est devenu un mode de socialisation et d’identification. Il contribue à faire tomber des barrières – le rapport à la performance, à l’esthétique –, à endurer les discriminations externes mais aussi celles, «extrêmement violentes et beaucoup plus pernicieuses», existant au sein même de ce groupe minoritaire: «Il y a une tentative d’identification – si je suis gay, je dois ressembler à ça, je dois faire ça, je dois aimer ça – et, dans le même temps, ils subissent des formes de stigmatisation liées à leur corps, à leur poids, à l’esthétique, à l’âge. Tous ces facteurs peuvent être en partie éliminés grâce à la consommation», décrypte Sandrine Detandt. Et si les applications de rencontre et le chemsex se révèlent efficaces pour rompre l’isolement, ils peuvent paradoxalement le renforcer: «Sur le moyen et long terme, le réseau social se limite ou se réorganise autour de réseaux sexualisés.»
À Bruxelles, une première étude exploratoire quantitative de l’Observatoire du sida et des sexualités4 avait établi en 2017 une photographie des profils, pratiques et problématiques des chemsexeurs parmi les gays, bisexuels et HSH. Parmi les 225 répondants, plus de la moitié déclaraient avoir rencontré des problèmes dans le cadre de ses plans «chem». D’ordre psychique (dépressions, sautes d’humeur, culpabilité, paranoïa, manque, pensées suicidaires…), physique (troubles du sommeil, pertes de conscience, abcès, lésions…), sexuel (infections sexuellement transmissibles [IST], perte de libido) et/ou social (professionnels, relationnels), ceux-ci étaient plus fréquents chez les consommateurs célibataires, chez les plus jeunes (mais aussi les plus âgés) et les personnes sans emploi.
Côté produits, les GHB/GBL et la méthamphétamine seraient les substances les plus problématiques actuellement, selon Maurizio Ferrara. Le GHB (anesthésiant) et le GBL (solvant-décapant, qui se transforme en GHB dans le corps après absorption), aujourd’hui sortis du milieu gay et utilisés dans le milieu festif pour l’ivresse qu’ils procurent, sont à la source de nombre d’accidents: les «G-holes», pertes de connaissance qui peuvent mener au coma. En cause? Des difficultés de dosage et des interactions dangereuses, entre autres avec l’alcool. La méthamphétamine (Tina, crystal meth), arrivée en droite ligne des États-Unis, serait l’objet de nombreux problèmes d’addiction. «Comme pour toute drogue, l’effet est lié au contexte, rappelle le psychologue. Systématiquement, on cherche à rejouer la même scène: on recherche des partenaires sexuels, on achète le produit, on s’envoie en l’air. C’est toujours le même schéma et c’est cette séquence contextuelle qui va prendre le dessus.»
«C’est ça qui est dégueulasse avec ce produit. Ça travaille sur ton inconscient. Tu finis par ne plus penser qu’au sexe et ça devient malsain.» Xavier
«Beaucoup entrent dans des circuits de conso par du chemsex, ce qui est un facteur d’aggravation des risques», précise aussi Sandrine Detandt. Moins habitués, ils ne font pas partie d’un réseau de consommateurs qui connaissent les «bonnes pratiques». «Et tout comme un consommateur festif ne se sent pas ‘toxico’, c’est encore moins le cas pour quelqu’un qui n’a jamais consommé de sa vie et qui, à 50 ans, se met à s’éclater tous les week-ends à la kétamine ou au crystal meth: s’il se retrouve avec des difficultés, il ne va pas appeler un centre d’aide pour toxicomanes.»
Accompagner sans juger
Face à l’augmentation des demandes d’aide, l’Observatoire du sida et des sexualités, les associations de prévention du VIH et des IST chez les HSH, et les acteurs du secteur «assuétudes» se réunissent et font réseau. Ex Aequo reprend les groupes de parole «Let’s talk about chemsex» et les scinde en deux: une partie se destine à ceux qui visent un arrêt de leur consommation, l’autre à ceux dont la consommation apporte du plaisir mais qui souhaitent se prémunir des risques liés à ses usages. «La drogue et le sexe sont deux sujets tabous. Ici, ils peuvent parler de pratiques extrêmes, de ‘fist’, de partouzes de 10 à 100 personnes qui durent deux ou trois jours. On cherche à toucher les personnes qui ne s’en sortent pas dans leur consommation, mais aussi des gens non problématiques qui ont envie d’en parler», explique Samy Soussi.
Pour toucher ce public qui ne s’identifie pas aux autres usagers de drogues, des consultations psys sont organisées dans les locaux d’Ex Aequo en partenariat avec l’asbl Infordrogues. Du matériel de réduction des risques (pipettes de dosage GHB, seringues, matériel de sniff, préservatifs et autotests VIH) est distribué, gratuitement, sur le web et au cours d’une permanence organisée avec l’asbl Modus Vivendi. Et un nouveau site, www.chemsex.be, «le premier du genre en francophonie à parler de drogues et de sexe sans jugement», est mis en ligne afin d’aiguiller les usagers et d’informer les professionnels du social et de la santé, encore peu outillés sur cette question. Un site qui intègre une page spécifiquement dédiée aux travailleurs du sexe. Enfin, une formation est en cours d’élaboration pour sensibiliser médecins généralistes, psychologues et urgentistes sur le sujet. Objectif: renforcer les possibilités de relais pour répondre aux demandes d’accompagnement aujourd’hui trop nombreuses. «Cet accueil professionnel, c’est le but que l’on poursuivait. Notre rêve était qu’il y ait à Bruxelles une clinique spécialisée ‘chemsex’ ouverte 24 h/24 comme cela existe à Londres, avec du testing, des dépistages et une prise en charge ambulatoire. On n’y est pas encore, mais un grand pas a été fait dans cette direction», conclut aujourd’hui Pablo.
- Éditions Massot, 2020.
- «Enquête exploratoire sur le chemsex dans le contexte de la prostitution/du travail du sexe HSH et Trans à Bruxelles-capitale et au-delà», Alias asbl, mars 2020, Bailleux Emmanuel et Dieleman Myriam.
- Lire à ce sujet «L’épidémie de la solitude gaie», Huff Post Québec, M. Hobbes.
- «Plan chem? Plan slam? Les plans ‘sous prod’. Une recherche exploratoire sur le chemsex parmi les gays, bisexuels et HSH dans la Région de Bruxelles-Capitale», Observatoire du sida et des sexualités, Université Saint-Louis, 2017, Jonas Van Acker.
En savoir plus
 «LGBTQI+ des patient.e.s aux besoins spécifiques» (dossier), Santé Conjuguée n°86, mars 2019.
«LGBTQI+ des patient.e.s aux besoins spécifiques» (dossier), Santé Conjuguée n°86, mars 2019.