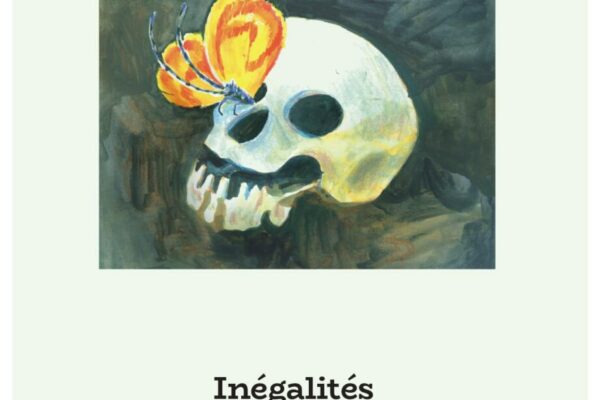Un article initialement publié dans MO, Mondiaal Nieuws Magazine – Traduction: Manon Legrand
En 2015, Mirwais Mahrzoi débarque, via un trafiquant d’êtres humains, dans une ruelle de Rotterdam. Les conseils de survie reçus durant son voyage coûteux se résumaient à: «Interpellez un policier en lui disant que vous voulez demander l’asile aux Pays-Bas.» Muni de ce conseil et convaincu que les ponts avec l’Afghanistan étaient définitivement coupés, Mirwais est descendu. Sans savoir que cela lui prendrait encore beaucoup de temps pour trouver la sérénité.
À Rotterdam, Mirwais a été envoyé à Ter Apel, dans le nord du pays, pour se présenter au bureau central d’inscription comme demandeur d’asile. Il a séjourné ensuite dans de nombreux centres pour demandeurs d’asile durant sa longue procédure: Ter Apel, Alphen-sur-le-Rhin, Budel, et enfin un centre d’accueil près d’Utrecht.
C’est alors qu’est arrivé un courrier lui signalant que le gouvernement néerlandais ne voyait aucune raison de lui accorder une protection. Son avenir s’est assombri. «Comme si retourner à Kaboul était une option», se disait Mirwais, se secouant la tête, comme s’il ne pouvait toujours pas y croire. Et il resta donc, sans titre de séjour. Destiné, comme beaucoup d’autres, à mener une vie dans l’ombre et l’illégalité. Mais la municipalité d’Utrecht en a décidé autrement. Il a atterri dans un abri d’urgence.
«C’était encore une fois un nouvel endroit. J’y ai passé quelques mois puis j’ai obtenu ma propre chambre dans une véritable maison 24 h/24.» Mirwais raconte qu’il avait à cette époque peu d’espoir et encore moins de confiance envers les gens qu’il croisait sur sa route. Mais on lui a donné un endroit pour se reposer, des gens pour l’accompagner et des soins médicaux si besoin.
Sa confiance s’est accrue lorsque les travailleurs sociaux ont examiné sa situation avec lui et ont étudié en profondeur son témoignage d’exil. «Ils ont fait ce que personne n’avait fait: ils m’ont écouté. Et ils ont reconnu mon histoire. Enfin, quelqu’un a cru que j’étais en danger en Afghanistan, que je n’avais pas quitté ma famille pour le plaisir.»
Accompagné par la Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht (SNDVU – Fondation d’intervention d’urgence pour les étrangers sans abri), Mirwais a décidé, en ajoutant de nouveaux éléments à son dossier, de présenter une nouvelle demande d’asile. Après un an et demi passé dans l’abri d’urgence, il a reçu des documents de résidence aux Pays-Bas en septembre 2019. Il raconte son histoire en néerlandais. Il l’a appris quand il était bénévole dans le jardin public, ainsi que dans le centre d’accueil de nuit. Maintenant que son diplôme afghan a été reconnu, il veut poursuivre ses études: d’abord un cours de néerlandais de niveau avancé, puis des études supérieures.
«Ils ont fait ce que personne n’avait fait: ils m’ont écouté. Et ils ont reconnu mon histoire.» Mirwais Mahrzoi
La ville pragmatique
Dès les années 90, les Pays-Bas ont renforcé leur législation pour les demandeurs d’asile et les personnes en séjour illégal et fermé l’accès à la sécurité sociale et à d’autres mesures de soutien. En 2001, avec la nouvelle loi sur les étrangers, les Pays-Bas mettent également fin à l’accueil des demandeurs d’asile déboutés. Seules les personnes qui coopèrent volontiers à leur retour peuvent encore compter sur un accueil limité. Le législateur a estimé qu’il s’agissait d’une règle stricte, juste et logique.
Mais de nombreux demandeurs d’asile déboutés ne le voyaient pas du même œil. Pour les personnes qui ont coupé les liens avec leur pays d’origine, pour diverses raisons, le retour n’est pas une option. Cela signifie que leur longue route vers un nouveau départ a échoué. Et donc ils restent. C’est comme cela aujourd’hui, c’était aussi le cas il y a 20 ans.
De nombreuses personnes se sont donc retrouvées à la rue, y compris des familles avec des enfants. «C’était exactement la même chose chez vous à Bruxelles», explique Jan Braat, rencontré avec Niene Oepkes à Utrecht. Tous deux sont conseillers politiques en matière d’asile et d’immigration à la municipalité d’Utrecht et sont à la tête de la politique d’accueil municipale depuis vingt ans.
Jan Braat avait déjà expliqué cette situation lors d’une journée d’étude à Bruxelles, lors de laquelle il était venu présenter l’approche alternative d’Utrecht. Sur le chemin de la gare Centrale vers la salle de conférences, il avait rencontré plusieurs sans-abri, dont une famille non européenne avec des enfants sous un porche. C’était un jour de décembre humide et froid, et leur misère à nu faisait que les passants pressaient le pas. «Nous avons également connu cette terrible situation dans les rues d’Utrecht en 2001. Jusqu’à ce que nous réalisions que laisser les gens dans la rue ne constituait pas la solution, mais le problème. Aujourd’hui, nous n’avons pratiquement plus de sans-abri dans les rues d’Utrecht.»
Jan Braat raconte comment, il y a presque vingt ans, la Ville d’Utrecht s’est emparée du vide que le gouvernement central avait créé en cessant l’accueil des personnes sans titre de séjour. Tout comme d’autres villes néerlandaises, Utrecht a décidé de commencer par un abri d’urgence municipal: le «bed-bad-brood» (lit-bain-pain). À l’instar d’Eindhoven et de Groningue, elle a ajouté un quatrième «b» – celui de l’accompagnement (begeleiding). La Ville a opté pour un abri ouvert 24 h/24 avec un accompagnement intensif des personnes hébergées, optant ainsi pour une approche durable et orientée solutions.
«Cela nécessite du temps, reconnaît Niene Oepkes. Nous ne mettons pas de limite à la durée de l’accueil, donc les gens peuvent rester dans nos structures d’accueil pendant un certain temps. D’autant que leurs dossiers, souvent complexes, nécessitent du temps pour les traiter correctement, ajoute-t-elle. Mais l’objectif est vraiment d’investir massivement et de trouver avec eux une solution durable à leur situation. Cette solution peut signifier un retour définitif, même si ce n’est pas notre principe de départ, ou l’obtention d’un permis de séjour. Et qu’est-ce qu’il apparaît? Nos résultats sont vraiment bons. C’est indéniable.» En effet, pour plus de 92 % des personnes accueillies, une solution durable a été trouvée.
Regarder dans la même direction
Lorsque Utrecht a opté pour une approche orientée solutions en 2002, elle semblait diamétralement opposée à la politique du gouvernement néerlandais, de plus en plus stricte en matière de migration et d’accueil. En 2003, Rita Verdonk est devenue ministre de l’Immigration et de l’Intégration. Son approche dure et son strict respect de la loi sur les étrangers de 2001 ont non seulement valu à Verdonk le surnom d’«Iron Rita» – Rita de Fer –, mais lui ont également permis de remporter pas mal de voix aux élections suivantes.
D’ailleurs, Verdonk, qui est née et a grandi à Utrecht, défendait la ligne dure du parti libéral VVD (Parti populaire pour la liberté et la démocratie, centre droit), aux commandes à Utrecht, avec le parti travailliste (PvdA) et un parti local.
Lorsque Utrecht a opté pour une approche orientée solutions en 2002, elle semblait diamétralement opposée à la politique du gouvernement néerlandais, de plus en plus stricte en matière de migration et d’accueil.
Même avec un maire PvdA, le conseil municipal ne s’est pas vraiment révélé progressiste. Comment les partis d’Utrecht ont-ils donc accordé leurs violons sur un thème aussi polarisant que l’immigration?
«Le but de notre approche était et reste de prévenir l’illégalité. Et c’est précisément l’illégalité, le problème dont il s’agit, répond Niene Oepkes. Vous trouvez alors des appuis de toutes parts. Il s’agit de s’attaquer à un problème. Ce n’est pas seulement une considération humanitaire, il s’agit aussi d’une question d’intérêt personnel.»
«Nous avons fait le lien entre l’accueil des personnes sans permis de séjour et la résolution des problèmes de sécurité et d’ordre public», ajoute Jan Braat. Il fait référence à une étude sur le milieu des drogues dures à Utrecht de 2003. Environ 18 % des personnes qui en font partie étaient des personnes en séjour illégal. Il s’agissait principalement de mineurs étrangers non accompagnés qui n’avaient plus droit, dès leur 18e anniversaire, à la protection et à l’accueil. «Nous avions des nuisances dans les rues, de la petite délinquance. Les filles étaient contraintes à la prostitution. Des personnes se sont retrouvées dans le circuit du travail illégal et ont été ‘exploitées’.»
La commune devait réagir
«Il nous fallait donc intervenir en tant que municipalité, explique Jan Braat, puisque le respect de la sécurité et de l’ordre publics sont du ressort des communes. En outre, elles ont aussi un devoir de vigilance à l’égard de toute personne se trouvant sur le territoire municipal, en termes de respect des droits humains mais également d’accueil. Et n’oubliez pas: un gouvernement municipal est directement confronté aux personnes en séjour irrégulier, contrairement au gouvernement fédéral.» En d’autres termes: un conseil municipal a moins de temps à perdre dans des discussions idéologiques qu’un gouvernement national. Lorsque la proposition d’une approche de résolution des problèmes et d’accueil des sans-abri sans résidence légale était sur la table de la municipalité, la quasi-totalité des douze partis l’a approuvée.
Fait à souligner: le conseil municipal a continué à opter pour cette approche, même après que le gouvernement néerlandais eut régularisé 28.000 personnes (tout demandeur d’asile débouté arrivé avant 2001 aux Pays-Bas et dont l’expulsion n’a pas eu lieu ainsi que sa famille, NDLR) par le biais de l’«amnistie générale», comme ils l’ont nommée, en 2007. Le gouvernement ne voyait plus la nécessité d’un accueil municipal et a obligé les municipalités néerlandaises à mettre fin à leur accueil municipal à la fin de 2009. Utrecht a refusé et a continué.

Créer un lien de confiance
La Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht (SNDVU) est située dans les bâtiments de l’église d’un quartier résidentiel. Elle est l’une des huit organisations sociales du réseau qui met en œuvre la politique d’accueil d’Utrecht. Avec 22 maisons, le SNDVU accueille environ deux cents personnes par an. En moyenne, car les périodes d’accueil sont variables, et un séjour d’un an et demi à deux ans ne fait pas exception.
«Cela s’explique par le processus intensif d’orientation juridique et le travail à long terme, explique Rana van den Burg. Elle travaille comme coordinatrice générale du SNDVU. Tout prend du temps: de la recherche d’experts qui peuvent contribuer à un meilleur dossier juridique à la construction d’un lien de confiance en passant par la décision finale en cas de nouvelle demande d’asile. Mais il faut d’abord que les gens s’installent, loin du mode de survie et de l’énorme stress lié à leur vie en rue.»
«Le but de notre approche était et reste de prévenir l’illégalité. Et c’est précisément l’illégalité, le problème dont il s’agit.» Niene Oepkes, conseillère politique en matière d’asile et d’immigration à la municipalité d’Utrecht
Le SNDVU passe alors à l’étape suivante dans laquelle les personnes doivent activement participer à la recherche d’une solution de sortie de leur situation difficile. Plus souvent qu’il n’était pensé initialement, cette solution conduit à près de 60 % de droits de séjour. Cela signifie également que près de 20 % d’entre elles retournent dans leur pays d’origine ou d’arrivée en Europe. «Mais ici aussi, nous constatons que des personnes qui, au départ, ne voulaient rien entendre sur le retour sont toujours disposées à retourner définitivement après avoir bénéficié d’une assistance psychologique intensive», explique M. Van den Burg.
«Les personnes que nous conseillons participent de A à Z à leur processus. Ils ont le contrôle et ont un regard sur les nombreuses mesures qui ont été prises. S’ils constatent que toutes les possibilités du plan A ont été explorées en profondeur mais que la chance d’obtenir un droit de séjour est nulle, ils donnent également plus de place à un plan B. Même s’il s’agit d’un ‘retour’.»
Utrecht est un village
Leidseweg, une rue dans le quartier multiculturel de Lombok, à l’Ouest d’Utrecht. D’un côté du canal, le bruit des sonnette des vélos fait écho aux cacardements d’oie sur l’autre rive. Au loin: deux coqs chantent. L’un est posé sous les ailes d’un moulin du XVIIIe siècle, l’autre chante quelque part dans un jardin attenant au Molenpark. L’espace public de la ville est étonnamment vert et spacieux, et il est largement partagé par les habitants d’Utrecht.
Cela transparaît aussi dans la partie sud de la ville, où la fondation Villa Vrede est basée. Le centre d’accueil pour les personnes sans titre de séjour est adjacent à un parc et on y accède par un jardin luxuriant, qui sert également de potager pour les personnes qui ont trouvé dans ce lieu un accueil de jour. Comme je ne crains pas les compagnons à quatre pattes, le chien restera dans le bureau de Jaap Meeuwsen et Iris Leenknegt. Il s’intègre parfaitement à l’atmosphère presque pastorale de la ville que je ressens dans différents endroits d’Utrecht.
«Utrecht est un village», s’esclaffe Iris Leenknegt. Un village qui est pourtant la quatrième plus grande ville des Pays-Bas. Début 2020, la ville comptait 357.719 habitants. Selon le moniteur de la ville, près de 130.000 habitants d’Utrecht, soit 36% de la population, sont issus de l’immigration. Plus de la moitié d’entre eux sont nés à l’étranger (première génération), l’autre moitié aux Pays-Bas (deuxième génération). Ainsi, dans le quartier de Lombok, on peut entendre simultanément le couinement des oies et le chant du muezzin résonner dans les haut-parleurs de la mosquée Ulu Camii.
Comment se fait-il que dans une grande ville comme Utrecht, il soit possible de réaliser ce qui dans d’autres villes, conduit malheureusement trop souvent des protestations? La clé du succès, explique Iris Leenknegt de la Fondation Villa Vrede, est le modèle de coopération désormais bien instauré entre les organisations de la société civile et le gouvernement municipal d’Utrecht. «Tout le monde se connaît – Utrecht ce village, vous savez – et sait qui fait quoi.»
Ce n’est bien sûr pas le cas de de tous habitants d’Utrecht. Les jeunes habitants qui n’ont pas vécu ici depuis si longtemps pensent que le quartier s’est amélioré. Mais certaines personnes qui vivent ici depuis vingt ans ont plutôt tendance à considérer que leur quartier se dégrade. «C’est pourquoi, il est important d’investir dans le quartier. Ce que nous, en tant qu’organisations de la société civile, essayons de réaliser. Nous ouvrons nos portes à tout le monde et invitons les habitants pour montrer que les résidents que nous accueillons sont des gens ordinaires», explique Jaap Meeuwsen.
Et cela marche, selon lui. Il fait référence au pèlerinage annuel de la Saint-Martin, apôtre des pauvres et saint patron de la ville. Le fait que les résidents de la Villa Vrede aient reçu une place permanente dans le cortège prouve qu’ils en font partie.
«Il est également important que le responsable municipal tienne bon et que la population voie que l’approche de la municipalité fonctionne vraiment», observe Jaap Meeuwsen. «Les villes qui gèrent les sans-abri à coup de restrictions, ont tout simplement plus de nuisances et sont confrontées à d’autres problèmes liés aux personnes vivant dans la rue. Utrecht se penche sur ce qu’il faut faire pour empêcher les gens d’errer, de fouiner dans les poubelles ou de disperser des canettes de bière dans les parcs.»
Jan Braat partage ce constat: «Les Utrechtois savent ce que c’est.» Il fait à nouveau référence à la scène des drogues dures d’Utrecht, implantée dans la ville il y a plus de vingt ans. Les consommateurs vivaient dans un tunnel sous un centre commercial dans des conditions extrêmement difficiles. Ce tunnel a été le théâtre d’années et d’années de nuisances. «La ville s’est également attaquée au problème de la drogue en leur offrant un refuge. Et les habitants d’Utrecht n’ont pas oublié. L’accueil des personnes sans titre de séjour légal bénéficie donc d’un soutien important.»
«Les personnes que nous conseillons participent de A à Z à leur processus. Ils ont le contrôle et ont une bonne vue sur les nombreuses mesures qui ont été prises.» Rana van den Burg (SNDVU)
Et le coût?
Depuis 2019, Utrecht dispose d’un accord de coopération temporaire avec les services gouvernementaux (le service néerlandais de l’immigration et de la naturalisation, le service du rapatriement et du départ et la police des étrangers). Pour la période d’essai de trois ans, Utrecht recevra 9,9 millions d’euros du gouvernement néerlandais1. La Ville transmettra cet argent aux organisations de la société civile. C’est bien, mais combien cela coûte-t-il réellement sur une base annuelle: recevoir une personne et lui apporter un soutien intensif? Ce doit être la question la plus fréquemment posée à Jan Braat et Niene Oepkes.
«J’aimerais vous présenter quelques dépenses, dit Braat. Pour environ 230 places, pour 300 personnes – parce qu’une partie de ces places passe par les installations de l’État –, cela nous coûte, en tant que municipalité, 3,5 millions d’euros par an. Cela semble être beaucoup d’argent, et ça l’est. Mais si vous convertissez cela, vous arrivez à un montant de 12.000 euros par personne, accompagnement compris.
L’accueil dans les centres collectifs de l’AOC (l’Agence centrale pour l’accueil des demandeurs d’asile, NDLR) coûte à l’État de 24.000 à 25.000 euros par personne. C’est deux fois plus. Sans accompagnement. La détention des migrants, l’accueil dans des centres fermés pour les personnes sans séjour légal, coûte même quatre fois plus cher: 50.000 euros par personne et par an.»
Braat poursuit, sans cacher sa satisfaction: «Si vous comparez ensuite les résultats, tant en matière de retour que de séjour, les comptes sont vite faits. Utrecht obtient de bien meilleurs résultats pour beaucoup moins d’argent.»

1. Jusqu’en 2019, la Ville subventionnait les organisations de la société civile qui assuraient conjointement l’accueil, le conseil et l’accompagnement des sans-papiers. L’accord de coopération fait partie du projet pilote Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV), qui comprend quatre autres municipalités: Amsterdam, Rotterdam, Groningen et Eindhoven. Le rapport d’évaluation après un an montre que les consultations entre les organisations de la société civile et les services gouvernementaux ne produisent pas encore les résultats escomptés.