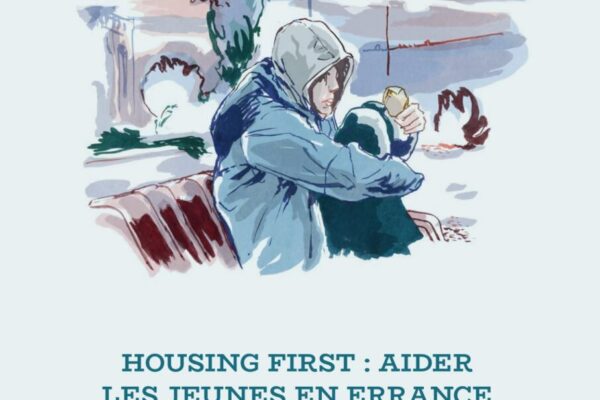Le livre Mon enfant se radicalise trouve sa source dans une des très rares initiatives pour prévenir la radicalisation en Belgique: le projet «Rien à faire, rien à perdre». Créé par la sociologue clinicienne Isabelle Seret et porté dans les écoles par Saliha Ben Ali, la maman d’un djihadiste décédé en Syrie, «RAFRAP» présente les témoignages vidéo de quatre jeunes anciennement radicalisés. Derrière cet outil pédagogique1, des centaines d’heures d’écoute, de ces ados un temps séduits par le discours djihadiste, mais aussi de parents d’enfants partis en Syrie. Avec l’aide de son confrère Vincent de Gaulejac, Isabelle Seret analyse cette matière première, d’une importance primordiale pour qui veut comprendre les processus de radicalisation.
Alter Échos: Les quatre jeunes qui témoignent pour RAFRAP ont tous des parcours et des profils différents. Mais vous en avez rencontré d’autres. Existe-t-il des points communs entre eux? Dans votre livre, les enfants issus de couples mixtes, que ce soit sur le plan ethnique ou religieux, semblent plus à risque de radicalisation…
Isabelle Seret: Pour ce qui est des causes de la radicalisation, nous nous en tenons à émettre des hypothèses. Parmi celles-ci, en effet, l’idée que les enfants issus de couples mixtes sont peut-être plus à risque. Ceux issus de l’immigration aussi. Dans le parcours de ces jeunes, il est très souvent question d’identité, d’absence de récit familial. Un récit familial que les parents ont du mal à transmettre, car il est imprégné de honte. À l’origine de cette honte, un parcours migratoire perçu comme dévalorisant. Les aspects positifs – la joie d’arriver dans un nouveau pays, de se marier, d’emménager dans un logement qui ne soit pas forcément proche de la belle-famille – ou les aspects valorisants, comme le fait d’apprendre d’autres codes sociaux, de vivre avec une double culture, sont mis de côté. Ce sont des récits que les parents taisent, car ils n’en perçoivent pas la richesse. Cela dit, le problème d’absence de récit familial peut aussi se poser avec des familles autochtones. On vit dans une société où tout est tellement mouvant, où tout évolue avec une telle rapidité qu’on en perd un élément essentiel dans la construction de soi: le fait d’avoir un socle, des racines, de savoir d’où l’on vient. C’est pourtant fondamental pour grandir en tant que sujet.
AÉ: Ces questions relatives à l’identité véhiculent donc beaucoup de honte. Un sentiment dont certains jeunes pensent pouvoir se débarrasser en adhérant à l’idéologie djihadiste.
IS: Oui, d’autant qu’à la honte liée au récit familial, il faut ajouter celle de ne pas pouvoir poursuivre le projet parental d’ascension sociale. À nouveau, c’est ce que l’on a compris en écoutant les mamans. Souvent, leurs grands-parents étaient agriculteurs ou éleveurs au Maroc. Leurs parents sont ensuite arrivés en Belgique et ont connu une forte ascension sociale, certes dans des conditions difficiles, mais avec, quand même, un salaire qui tombait tous les mois. Une fois adultes, ces mamans ont, pour la plupart, entrepris des études d’assistantes sociales, d’éducatrices, d’institutrices, etc., avec l’espoir de continuer l’ascension initiée par leurs parents. Mais la situation économique a changé, il y a une crise de l’emploi et leur propre enfant n’a plus la possibilité de s’élever socialement. Il se sent dans une impasse avec, en prime, l’impression de ne pas être pas bien accueilli par la société dans laquelle il vit. C’est une des raisons qui expliquent l’attrait que le discours du groupe «État islamique» exerce sur ces jeunes. Il règle à la fois les questions d’identités multiples et de dévalorisation. Dans sa vidéo, Mansour2 le dit très bien: «Je ne suis ni Belge ni Marocain, je suis Mansour et je suis musulman.» C’est une identité simple, unique et surtout beaucoup plus valorisée. Car, en plus, on n’est pas n’importe quel musulman. On est un «grand» musulman, qui détient le véritable islam, qui fait partie d’un «État» destiné à montrer aux autres musulmans comment il faut vivre, etc.
AÉ: Valoriser les origines des jeunes issus de l’immigration serait donc une solution pour lutter contre la radicalisation?
IS: Il est surtout essentiel de revaloriser les parcours migratoires, les chemins qui ont amené ces familles à s’installer en Belgique. Quand on demande à un jeune de venir avec des plats, des objets de son pays, de parler de ses racines, on le renvoie à l’idée qu’il n’est pas d’ici, alors que son pays, c’est la Belgique! De plus, en évoquant de manière élogieuse la terre natale de ses aïeux, on valorise la part manquante de son identité. Mieux vaudrait lui proposer de réaliser un travail sur sa généalogie, pour que ses parents lui racontent l’histoire de sa famille et qu’il soit capable de la mettre en récit.
AÉ: À vous lire, Daech n’apporte pas seulement une réponse aux questions d’identité. Il libère aussi les jeunes de l’obligation permanente d’opérer des choix. Pourtant, choisir, c’est être libre…
IS: Effectivement, nous vivons dans une société où domine le sentiment que nous sommes libres et égaux. Auparavant, un enfant qui naissait dans une famille de notaires ou d’agriculteurs avait de grandes chances de devenir à son tour notaire ou agriculteur. Aujourd’hui, on vit avec la croyance que tout est possible. La responsabilité à réussir, à se réaliser en tant qu’individu, n’en est que plus grande, voire écrasante. Autre évolution liée à notre époque: les grands récits sociétaux, qu’ils soient politiques, religieux ou autres, se sont effondrés. Les certitudes aussi, qu’elles portent sur l’écologie, le bio, l’identité genrée, etc. Les questionnements sont incessants. Dois-je m’acheter une voiture diesel ou essence? Puis-je me fier à ce label bio? Est-ce qu’une femme, ça doit avoir des enfants et travailler en même temps? Si je deviens maman, dois-je ou non allaiter mon bébé? Est-on vraiment un homme si on participe aux tâches ménagères et que l’on câline ses enfants? Tout est sujet à interrogation. Ces choix permanents, cette injonction à devenir soi-même dans un contexte dénué de référents sociétaux, sont fatigants. Nous formulons donc l’hypothèse que, parmi ces jeunes, survient, à un moment donné, une «fatigue d’être soi», pour reprendre l’expression du sociologue Alain Ehrenberg. À cela aussi, le groupe «État islamique» vient apporter une solution. L’idéologie djihadiste fournit, en quelque sorte, une identité clé-sur-porte. Le jeune n’a plus à réfléchir sur l’adulte qu’il veut devenir. On lui dit de quelle manière il doit s’habiller, ce qu’il peut manger ou non, la façon dont il convient de prier… Tout est codé, toute question trouve une réponse prête à l’emploi.
AÉ: Les jeunes que vous avez rencontrés sont aujourd’hui sortis de la radicalisation. Ça doit être compliqué de réapprendre à faire ses propres choix.
IS: Et à se faire à nouveau confiance, tout simplement! Je pense, par exemple, à Marie2 qui, entre un tee-shirt blanc et un tee-shirt blanc, ne savait plus lequel choisir. Car comment se faire encore confiance lorsque, un jour, on a cru que quitter sa mère, se marier en Syrie et y mourir en martyr était un objectif de vie? En cela, le fait de témoigner dans une capsule vidéo, de réfléchir à ce qui a pu conduire à la radicalisation, de mettre des mots sur son histoire est extrêmement important. Cela permet de donner du sens à un vécu qui, sinon, serait tout bonnement effrayant.
AÉ: Il y a aussi la volonté chez eux d’empêcher que d’autres jeunes suivent leurs traces…
IS: Tout à fait. C’est même une motivation fondamentale dans leur démarche. Parmi les quatre jeunes qui ont accepté de partager leur histoire, trois sont aujourd’hui actifs dans la prévention. Certains au sein d’associations, d’autres par le biais de l’expression artistique, ou en tentant de mettre en garde les copains contre le discours de l’État islamique. L’envie de s’engager pour que d’autres ne connaissent pas le même destin est très forte. C’est la raison pour laquelle je trouve personnellement dommageable que l’on parle de «désengagement», lorsqu’il est question de sortir un jeune de la radicalisation, car, finalement, c’est très beau de vouloir s’engager. Au départ, ces jeunes avaient de belles valeurs, ils désiraient changer le monde. Malheureusement, ils ont emprunté la plus mauvaise voie pour y arriver. Quoi qu’on en pense, si l’on veut lutter contre la radicalisation, l’engagement, ou plutôt le «réengagement», est important. Il faut créer des structures qui rendent cela possible. C’est très bien de construire un terrain de football pour les jeunes. Le sport, ça défoule, c’est indispensable, mais ce n’est pas ça qui fait un citoyen, ce n’est pas ça qui donne du sens. Or, tous ces jeunes sont en demande de pistes d’engagement. Il est essentiel de leur offrir les moyens de se faire entendre en tant que futurs citoyens.
(1) Disponible via le site www.extremismes-violents.be.
(2) Une des jeunes qui a participé au projet «Rien à faire, rien à perdre».