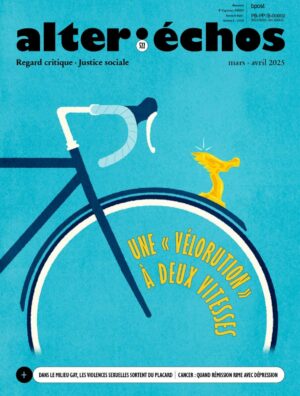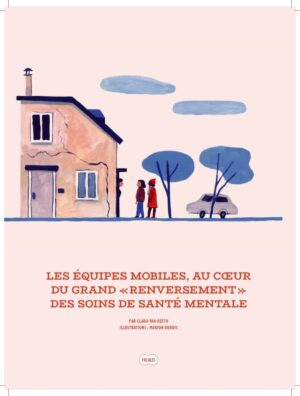Alter Échos: Pour commencer, en quoi consiste le GERAS, ce groupe d’étude pour la réforme de l’action sociale?
Pierre Verbeeren: Le GERAS est un groupe informel. Il n’a pas pour vocation de devenir une association, une fédération quelconque. Son seul objectif est d’avoir une parole libre et collective sur l’action sociale publique, et singulièrement à Bruxelles, là où réside notre expertise.
AÉ: Les CPAS sont à un tournant, vous le savez. Dans vos analyses, vous proposez pour dépasser les clivages actuels de revoir la gouvernance des CPAS. Quelles sont vos propositions?
Pierre Verbeeren: Cela nous paraît nécessaire de repenser la gouvernance des CPAS, en veillant à quelques éléments essentiels à nos yeux: il ne faut pas créer des ruptures de droits comme c’est le cas actuellement. Bruxelles est fragmentée en 19 communes, alors que les phénomènes sociaux sont ceux d’une métropole unifiée. Lorsqu’une famille déménage d’une rue à l’autre, elle traverse les frontières communales et subit une rupture de ses droits sociaux. Cette rupture n’aide personne, ni les travailleurs sociaux ni les ayants droit. Elle renforce en outre une illisibilité de l’impact des politiques publiques à l’égard de populations cibles, notamment celles pour qui cette compétence territoriale n’a pas de sens comme les sans-abri, les étudiants ou les sans-papiers. Il faut donc un nouvel équilibre entre local et régional, sans tabou, en renforçant la proximité des travailleurs sociaux avec les citoyens, en renforçant aussi la responsabilité de résultat du politique vis-à-vis de la pauvreté.
Il faut donc un nouvel équilibre entre local et régional, sans tabou, en renforçant la proximité des travailleurs sociaux avec les citoyens, en renforçant aussi la responsabilité de résultat du politique vis-à-vis de la pauvreté.
Sara Vanhoyland: Une gouvernance davantage uniformisée de l’action sociale permettrait en effet d’éviter pas mal de problèmes pour les ayants droit. Lors d’un déménagement, et une association comme la nôtre rencontre souvent de tels cas, des personnes doivent attendre jusqu’à six mois pour avoir une réponse. Cela signifie six mois sans revenu, en venant d’une commune, d’un CPAS où elles avaient droit auparavant au revenu d’intégration sociale. Tout était en ordre, la seule chose qui a changé, c’est l’adresse. Le fait qu’il faille attendre des mois, cela amplifie les difficultés sociales de ces personnes qui se retrouvent sans moyens pour payer leur loyer, leurs factures… Ce sont des dettes qui s’accumulent, des soins reportés. Le coût à la fin est bien plus important pour la société. En outre, il est difficile pour une association comme la nôtre de pouvoir expliquer qu’un tel est aidé de la sorte dans telle commune, et qu’un autre ne l’est pas dans une autre commune, alors que leur situation est identique.
AÉ: Vous pointez en effet dans votre analyse les inégalités entre communes, notamment entre les communes les plus riches et les plus pauvres de la capitale…
Xavier Polfliet: En termes de politiques sociales, on a des réponses très différentes entre les 19 communes, ce qui rend les choses assez illisibles pour les bénéficiaires. Cela devient aussi compliqué que le système des mutualités complémentaires: il est impossible de comparer les offres et on se retrouve avec un «marché» de politiques sociales alors qu’il y a une base commune sur laquelle on pourrait se retrouver, s’aligner. Cela renvoie aussi au modèle de financement: aujourd’hui, plus la précarité est concentrée dans une commune, moins elle dispose de moyens pour mener des politiques sociales efficientes.
En termes de politiques sociales, on a des réponses très différentes entre les 19 communes, ce qui rend les choses assez illisibles pour les bénéficiaires.
Carlo Caldarini: Proportionnellement au nombre de bénéficiaires, les CPAS des communes les plus riches disposent de deux à trois fois plus de moyens financiers que les CPAS des communes les plus pauvres. À titre d’exemple, le CPAS d’Anderlecht a trois fois plus de moyens que celui de Woluwe-Saint-Pierre, mais Anderlecht a 15 fois plus de bénéficiaires que celui de Woluwe. Avant de s’intéresser à l’organisation des CPAS, à l’harmonisation des pratiques, il faudra se poser aussi la question du financement de l’action sociale publique.
Xavier Polfliet: Cette situation crée des rapports de force défavorables pour les CPAS où on parle de 19 voix différentes, chacun réinventant son petit logiciel de son côté, en dépensant énormément de moyens. S’il est essentiel que la prise en charge soit faite au niveau le plus proche du citoyen, il est nécessaire d’avoir des politiques sociales pensées à l’échelle de la région.
AÉ: À côté de cela, le malaise des travailleurs sociaux s’accroît. Comment redonner du sens à leur pratique?
Grégory Meurant: Au fil des années, le travail social s’est technocratisé. Il y a des raisons technologiques, mais pas seulement. Le management n’est plus le même, les modes de financement ne sont plus les mêmes, en fonctionnant par appels à projets hyper-ciblés… Tout cela au détriment du temps consacré à l’accompagnement des bénéficiaires. Auparavant, les travailleurs sociaux étaient des praticiens de l’intimité, capables de se mettre au même niveau que les personnes en situation de précarité, de comprendre leur souffrance. Ils sont devenus des techniciens du droit administratif, et plus des agents de transformation sociale. La mission du travail social, sa finalité de réinsertion sociale s’est transformée pour devenir de la gestion administrative de la précarité par l’octroi des aides sociales. L’octroi est fondamental pour la dignité humaine, mais cela ne fait pas de l’émancipation, de la réinsertion. Cela maintient les personnes dans leur situation.
Au fil des années, le travail social s’est technocratisé. Il y a des raisons technologiques, mais pas seulement. Le management n’est plus le même, les modes de financement ne sont plus les mêmes, en fonctionnant par appels à projets hyper-ciblés…
Sara Vanhoyland: Contrairement aux idées reçues, les bénéficiaires ne sont pas là à attendre du cash, sans demander un accompagnement. La plupart des bénéficiaires que je rencontre réclament réellement un accompagnement à leur mesure. Ils ont besoin de travailleurs sociaux qui peuvent prendre du temps… Je comprends parfaitement le malaise des travailleurs qui se retrouvent avec 150, 200 dossiers: il est impossible de faire un accompagnement de qualité. Je suis moi-même travailleuse sociale, je ne travaille pas dans un CPAS parce que je sais que ce n’est pas possible, dans les conditions actuelles, de proposer aux bénéficiaires un accompagnement sur mesure.
AÉ: Un malaise renforcé par cette volonté politique – et sanctionnante – de l’activation… Au final, les CPAS ne sont-ils pas devenus au fil du temps des centres publics d’activation sociale?
Xavier Polfliet: C’est un doux rêve de la part des politiques. Considérer qu’on va pouvoir mener un travail de haute couture sans nous donner les moyens, cela n’a pas de sens… Pour le moment, une partie de la souffrance des travailleurs sociaux vient du fait de devoir faire du tri, en se demandant à chaque fois devant un bénéficiaire ce qui est le plus urgent à traiter. En CPAS, on fait du tri, pas de l’activation. En outre, à travers cette logique de l’activation, le politique a fait des CPAS le premier filet de la Sécurité sociale, en nous renvoyant tous les exclus du système: les jeunes ou les chômeurs de longue durée, par exemple. Or, les CPAS ne sortent pas de la précarité. Nous sommes un dispositif de gestion de la précarité qui aide les personnes à s’en sortir, mais sans sortir de la précarité. C’est le rôle de la sécurité sociale d’empêcher les gens de tomber dans la précarité, et il faut admettre, dans cette logique où les CPAS ramassent les échecs de ce système, que les politiques ne croient plus au rôle de sécurité sociale.