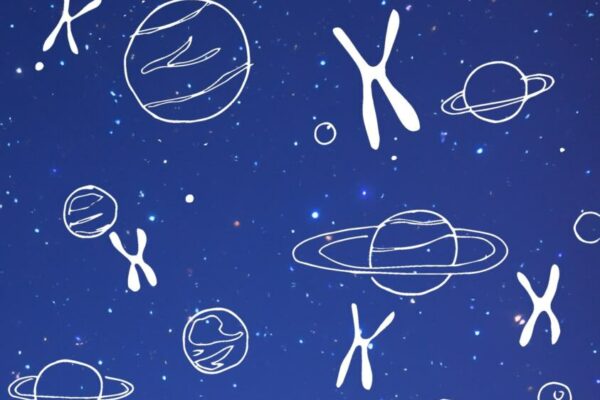Étienne Joiret est psychologue clinicien au centre hospitalier Jean Titeca (pédopsychiatrie). Il évoque la situation particulière de mineurs délinquants souffrant de troubles psychiatriques. Le récent rapport sur la communautarisation de la prise en charge de mineurs ayant commis des faits qualifiés d'infraction propose quelques changements à ce sujet. Explications.
Alter Échos: Lorsqu’un mineur commet un fait qualifié d'infraction et souffre de problèmes psychiatriques, quelle est la loi qui s’applique?
Étienne Joiret: Dans la loi de 1965 sur la protection de la jeunesse, le juge peut prendre des mesures de soins médicopsychologiques «obligés». Soit en le plaçant en hôpital pédopsychiatrique, «en vue de soins», en argumentant sa demande sur la base d’un rapport médical, qui est une condition minimale; soit il peut le faire suivre par une équipe médicale en ambulatoire après avoir reçu une indication médicale. Il peut aussi prendre les mesures habituelles, par exemple, un placement dans un service de l’Aide à la jeunesse, avec une dimension médico-psychologique.
A.É.: Si le juge souhaite que le placement en hôpital soit plus contraignant, il doit s’appuyer sur une autre loi, celle de 1990 sur la protection de la personne des malades mentaux...
É.J.: Oui, le tribunal peut décider d’une «mise en observation» (il s’agit d’une mesure de «protection de la personne» réputée malade me...
La suite de cet article est réservé à nos abonnés
Abonnez-vous et accédez à l'intégralité de nos contenus et archives en ligne
Déjà abonné ?
Aller plus loin
Étienne Joiret est psychologue clinicien au centre hospitalier Jean Titeca (pédopsychiatrie). Il évoque la situation particulière de mineurs délinquants souffrant de troubles psychiatriques. Le récent rapport sur la communautarisation de la prise en charge de mineurs ayant commis des faits qualifiés d'infraction propose quelques changements à ce sujet. Explications.
Alter Échos: Lorsqu’un mineur commet un fait qualifié d'infraction et souffre de problèmes psychiatriques, quelle est la loi qui s’applique?
Étienne Joiret: Dans la loi de 1965 sur la protection de la jeunesse, le juge peut prendre des mesures de soins médicopsychologiques «obligés». Soit en le plaçant en hôpital pédopsychiatrique, «en vue de soins», en argumentant sa demande sur la base d’un rapport médical, qui est une condition minimale; soit il peut le faire suivre par une équipe médicale en ambulatoire après avoir reçu une indication médicale. Il peut aussi prendre les mesures habituelles, par exemple, un placement dans un service de l’Aide à la jeunesse, avec une dimension médico-psychologique.
A.É.: Si le juge souhaite que le placement en hôpital soit plus contraignant, il doit s’appuyer sur une autre loi, celle de 1990 sur la protection de la personne des malades mentaux...
É.J.: Oui, le tribunal peut décider d’une «mise en observation» (il s’agit d’une mesure de «protection de la personne» réputée malade me...