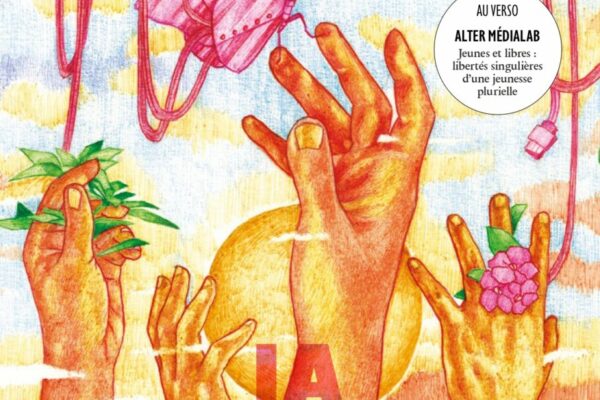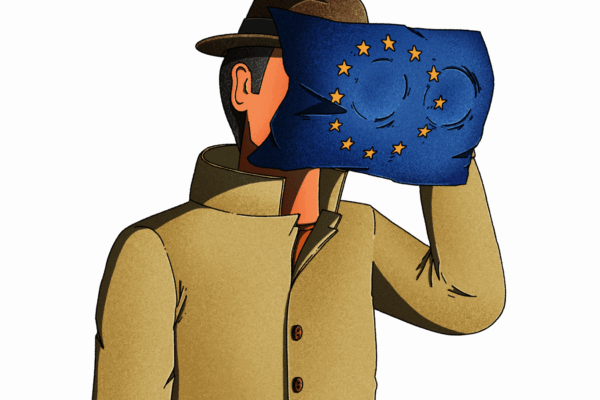Alter Échos: En 2025, l’UCLouvain fêtera ses 600 ans avec aux commandes la première rectrice de son histoire. Qu’est-ce que cela vous inspire?
Françoise Smets: Il s’agit d’un chouette symbole. Cela dit, le fait qu’une femme puisse arriver à cette position continue d’être une question et cela montre qu’il y a encore pas mal de choses à faire pour assurer une diversité et une inclusivité les plus optimales possible.
AÉ: Les universités de Bruxelles, Liège et Namur ont également des femmes à leur tête. Il s’agit d’un momentum?
FS: Je pense qu’il y a eu un momentum, en tout cas chez nous. Je ne suis même pas certaine qu’il y ait eu une candidate au poste de rectrice par le passé… Quand il n’y a pas de candidate, il ne peut pas y avoir de femme élue non plus. D’un autre côté, on peut aussi le voir comme un point négatif: on estimait que le moment était venu et, à candidature plus ou moins équivalente, une femme avait plus de chance de passer qu’un homme.
AÉ: Ce sont des remarques qu’on vous a faites?
FS: Je pense que certaines personnes n’ont pas regardé ce qu’Alain Vas (candidat au même titre que Françoise Smets et Geneviève Schamps pour le rectorat de l’UCLouvain, NDLR) avait à proposer parce qu’elles avaient décidé de voter pour une femme. Ce sont des choses qu’on entend et un message dont n’a pas vraiment envie. C’est dépréciateur parce qu’on pense alors que les femmes sont promues parce qu’elles sont des femmes et qu’il en faut alors que je pense que ce qui a surtout joué, c’est qu’il y avait de bonnes candidatures féminines sur la table.
AÉ: Vous dites «Quand il n’y a pas de candidate, il ne peut pas y avoir de femme élue non plus». Vous pensez que les femmes ont eu tendance, comme ont pu l’affirmer certaines études, à se déprécier professionnellement au point de faire preuve de trop de modestie?
FS: C’est une partie de l’explication, même si cette tendance est probablement en train de changer. La deuxième explication est à mon sens encore plus importante: pour être en mesure de candidater au rectorat, il faut déjà avoir progressé jusqu’à un certain stade et pour ça le milieu académique est encore très imparfait pour les femmes.
AÉ: À quel niveau?
FS: On diplôme plus de filles, mais le croisement des courbes (filles/garçons, NDLR) se fait au niveau de la thèse de doctorat. Le milieu académique et les thèses ne sont pas du tout adaptés au fait de pouvoir effectuer son retour facilement après une grossesse. La thèse est financée pour une certaine période, l’étendre est parfois très difficile, le retour de grossesse se fait sous pression parce qu’on a «perdu» quelques mois alors que c’est un moment où on devrait pouvoir recommencer à travailler tout en profitant du très jeune enfant qui est là. Il faut vraiment revoir le système.
On diplôme plus de filles, mais le croisement des courbes (filles/garçons, NDLR) se fait au niveau de la thèse de doctorat. Le milieu académique et les thèses ne sont pas du tout adaptés au fait de pouvoir effectuer son retour facilement après une grossesse.
AÉ: Comment comptez-vous travailler sur ces enjeux?
FS: Le gouvernement de l’université, c’est le conseil rectoral. Il existe en son sein une série de prorecteurs et prorectrices. Sous le mandat de mon prédécesseur, il en existait quatre pour la recherche, l’enseignement, l’international et l’enjeu des transitions, qui devait aussi prendre en charge les transitions sociétales. Il y a cependant tellement à faire à ce niveau que j’ai décidé de créer un cinquième poste pour l’EDI (équité, diversité, inclusion). Il y aura un portage politique fort de ces enjeux qui sont transversaux, ce qui les rend difficiles à rencontrer.
AÉ: Existe-t-il d’autres enjeux sur lesquels vous comptez vous pencher?
FS: Il faut que tout le monde puisse se sentir mieux au sein de l’université, que ce soient les étudiants ou le personnel. C’est un objectif qui a été un peu perdu de vue parce que la société va mal, avec les crises qu’on a connues, les enjeux environnementaux qui sont préoccupants, les guerres. Et puis au niveau des universités, nous avons connu des contraintes qui nous ont été imposées de l’extérieur et qui nous ont compliqué la vie. Je pense notamment au décret Paysage qui était prétendument destiné à générer plus de réussite, y compris pour les étudiants moins favorisés, mais qui loupe complètement son objectif.
AÉ: Vous pensez au décret initial ou à la révision effectuée en avril 2024?
FS: Le décret initial était une catastrophe.
AÉ: Pourquoi?
FS: Avant le décret, l’étudiant était promu chaque année, il savait s’il avait raté ou réussi. Avec le décret, plus aucun étudiant ne considérait qu’il avait raté du moment qu’il avait validé quelques cours. Cela a allongé les parcours d’études, sans obtenir plus de diplomation. Pour les étudiants, ce n’était pas du tout valorisant et quand ils allaient dans le mur, ils ne s’en rendaient pas compte. Et pour les enseignants et les équipes administratives, c’était démoralisant parce que cela mettait à mal tout ce qui avait été réfléchi pour proposer des programmes de qualité.
Avant le décret, l’étudiant était promu chaque année, il savait s’il avait raté ou réussi. Avec le décret, plus aucun étudiant ne considérait qu’il avait raté du moment qu’il avait validé quelques cours. Cela a allongé les parcours d’études, sans obtenir plus de diplomation.
AÉ: Il y a déjà eu une révision du décret votée en décembre 2021…
FS: Elle avait remis des balises qui permettaient à l’étudiant de mieux visualiser s’il était dans une trajectoire de réussite ou pas. Et puis avant les élections, on a de nouveau tout mis par terre.
AÉ: La réforme de 2024, soutenue par le PS et Écolo, a été justifiée par l’incertitude que celle de 2021 aurait fait planer sur la finançabilité de certains étudiants et donc leur possible réinscription. C’était un peu le sauve-qui-peut…
FS: Il n’y a eu aucune réflexion. Le problème est que ces décrets sont écrits par des gens qui ne savent pas ce que c’est d’enseigner et qui font de la démagogie. Je pense que les politiques ont espéré récolter l’ensemble des voix des étudiants. Or ça n’a pas été le cas. Il est quand même plutôt rassurant de voir que la population ne s’y est pas complètement laissé prendre.
Le problème est que ces décrets sont écrits par des gens qui ne savent pas ce que c’est d’enseigner et qui font de la démagogie. Je pense que les politiques ont espéré récolter l’ensemble des voix des étudiants. Or ça n’a pas été le cas.
AÉ: La situation de certains étudiants n’était donc pas problématique?
FS: Ces situations auraient pu être solutionnées sans toucher au décret. On aurait pu «valider» les étudiants avec ce qui était à notre disposition, ils pouvaient introduire une demande de dérogation pour pouvoir se réinscrire. Chaque année, une très grande proportion d’étudiants qui font cette demande sont acceptés. Mais, dans ce cas, on peut alors vérifier qu’ils sont dans une trajectoire de réussite ou qu’il y a des éléments externes qui les ont empêchés d’être dans cette trajectoire. Ce qu’on voit sur le terrain, et c’est ce que les politiques n’ont pas voulu entendre, c’est que des étudiants s’acharnent alors que l’on sait qu’ils n’y arriveront pas. C’est dur à entendre, mais si on veut qu’ils puissent se réorienter vers quelque chose où ils s’épanouiront mieux, c’est un message qu’il faut pouvoir faire passer.
Ce qu’on voit sur le terrain, et c’est ce que les politiques n’ont pas voulu entendre, c’est que des étudiants s’acharnent alors que l’on sait qu’ils n’y arriveront pas. C’est dur à entendre, mais si on veut qu’ils puissent se réorienter vers quelque chose où ils s’épanouiront mieux, c’est un message qu’il faut pouvoir faire passer.
AÉ: La précarité étudiante est un sujet qui a souvent été mis sur la table par la FEF (Fédération des étudiants francophones, NDLR), notamment lors de la réforme du décret Paysage de 2024.
FS: Il y a une paupérisation de la population, sur certains de nos campus plus que d’autres (Mons, Bruxelles, NDLR). Nous essayons, à travers toutes les aides mises en place, de couvrir complètement le coût des études. Cela inclut le minerval, le fait de proposer un logement gratuit ou à frais réduits, les outils électroniques nécessaires, la prise en charge des supports de cours obligatoires, éventuellement certaines dépenses sur le campus, en ce inclus un suivi psychologique, social ou autre. Mais cela n’inclut pas le logement en dehors de l’université, le fait de pouvoir s’habiller… Il faut rester raisonnable, l’université a des ressources limitées, on pourrait aussi dire qu’elle est en situation de précarité par rapport aux missions qu’elle doit remplir. Ce qu’on regrette parfois, c’est qu’il y a une difficulté à être dans un dialogue (avec la FEF, NDLR) où on cherche des solutions qui sont à la fois réalistes par rapport aux moyens disponibles et qui n’entrent pas dans le discours démagogique qui est dire que l’on ne fait rien pour ces étudiants et que tel ou tel pourcentage d’entre eux doivent travailler durant leurs études.
AÉ: Ce qui est le cas.
FS: Oui, un certain nombre travaillent pour payer leurs études, mais d’autres le font pour payer leurs vacances.
AÉ: Comment mieux identifier les étudiants en situation de précarité?
FS: C’est très difficile. Il faut changer la culture. Il existe encore parfois une pudeur, certains étudiants en difficulté craignent d’être mal vus. Il faudrait que l’on puisse, au plus tard lors de la session de janvier de la première année d’études contacter tous les étudiants qui ont un parcours qui nous inquiète, c’est-à-dire ceux qui n’ont présenté aucun examen, ou qui ont tout raté pour que l’on puisse comprendre pourquoi avec eux. Mais il faudrait pour cela que nous ayons, avec les ressources qui sont les nôtres et qui sont limitées par rapport au nombre d’étudiants, du personnel libre et du temps pour prendre ces contacts individuels…
AÉ: Ce serait donc un vrai accompagnement pédagogique. Comment?
FS: En leur faisant des programmes adaptés au temps qu’ils doivent passer par ailleurs pour travailler afin de couvrir des dépenses qui n’ont pas à être prises en charge par les universités. Il faudrait aussi que les étudiants comprennent l’avantage de ce système. Ils ont toujours l’impression qu’ils vont y arriver et ils veulent que ce soit le plus vite possible. Réaliser qu’on va mettre six ans pour obtenir son diplôme de bachelier au lieu de trois, ce n’est pas super sexy pour ces jeunes qui ont envie d’être le plus vite possible sur le marché du travail afin de ne pas étudier et travailler en même temps plus longtemps. Or, de notre côté, on sait que ce ne sera pas possible pour une partie significative d’entre eux. Il faut d’abord les en convaincre.
AÉ: La fin de l’année scolaire passée a été marquée par les occupations d’universités afin de protester contre la situation à Gaza. Quel est votre point de vue à ce sujet?
FS: Nous sommes toujours très heureux quand les étudiants se mobilisent sur une question sociale. C’est leur rôle, et quand c’est fait correctement, nous nous en réjouissons. Il faut remettre du débat un sein des universités, où on a eu tendance ces derniers temps à aller plus vers le consensus. Mais cela doit rester un débat respectueux et constructif. Or les mouvements étudiants en place sur les campus en Europe (sur Gaza, NDLR) ne cherchent pas à trouver des solutions. Il n’y a pas de dialogue possible.
Nous sommes toujours très heureux quand les étudiants se mobilisent sur une question sociale. C’est leur rôle, et quand c’est fait correctement, nous nous en réjouissons. Il faut remettre du débat un sein des universités, où on a eu tendance ces derniers temps à aller plus vers le consensus.
AÉ: Certains de ces mouvements se sont aussi fait remarquer par leur volonté d’empêcher la tenue de débats ou la venue d’interlocuteurs/interlocutrices.
FS: Il s’agit de quelque chose qu’on ne peut pas accepter. Il y a une vraie inquiétude par rapport à la liberté académique ces dernières années et cela n’en est qu’un exemple. Il y a beaucoup de configurations différentes qui font que le débat est malade, la possibilité d’avoir un vrai débat devient de plus en plus difficile. Certains mouvements sociaux sont devenus tellement émotionnels que certaines personnes ne sont plus en capacité d’être dans la mesure, l’écoute. Sans doute que le rôle de l’université est de travailler à voir comment on peut revenir à une société où le débat redevient possible. Cela va passer par une analyse de la société et des mouvements pour comprendre en profondeur d’où ils viennent et comment ils peuvent être «inversés».