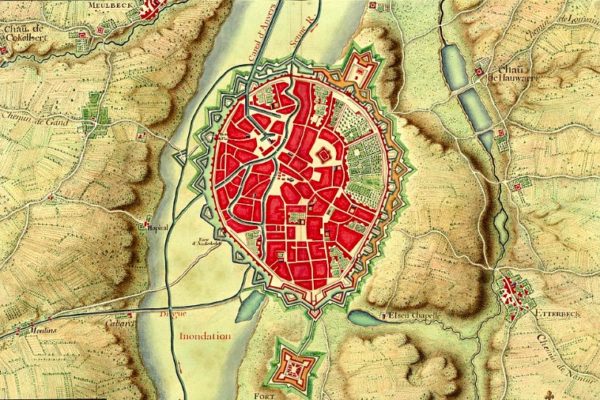Didier Gosuin (FDF) est ministre de l’Emploi et de l’Économie à la Région bruxelloise. Il est aussi ministre Cocof de la Formation professionnelle. Il a accordé un long entretien à Alter Échos.
Alter Échos: Depuis votre entrée en fonction on sent une volonté d’évaluer, voire de rationaliser les politiques déjà en place au niveau de l’emploi. Vous confirmez?
Didier Gosuin: Quand on est responsable de deniers publics, on se doit d’évaluer les politiques qui ont été adoptées ou qu’on adopte. C’est légitime. Il s’agit d’argent public et il faut se poser la question de savoir si cet argent est correctement dépensé, s’il atteint les objectifs qu’on lui a assignés.
A.É.: Cela n’a pas été assez fait auparavant?
D.G.: Ce n’est pas dans la culture politique. Cette culture politique aura plutôt tendance à faire voter une ordonnance, à mettre en place un système et à dire a priori: «Voilà la solution.» Alors qu’il s’agit peut-être de la solution, mais peut-être pas, ou en partie. Pour moi, il existe une obligation inhérente à ma fonction: faire l’évaluation des politiques qui sont en place. Cessons de faire croire que chacun a la solution miracle. Moi en tout cas je ne suis pas un faiseur de miracles. D’où la nécessité d’évaluer. Et de se mettre en autocritique permanente. Des idées, j’en ai à peu près une tous les jours. Mais est-ce que ce sont de bonnes idées?
A.É.: Il est vrai que l’accumulation des plans pour l’emploi en tous genres est un peu une spécialité bruxelloise.
D.G.: À Bruxelles, faire l’évaluation des politiques est probablement encore plus nécessaire. Il faut bien reconnaître que tous les indicateurs sont au rouge. Quand on voit le taux de chômage, celui des jeunes, le taux de sous-qualification… Et cela fait 20 ou 25 ans qu’on met des politiques les unes à côté des autres, qu’on les empile et qu’on les présente comme la solution qui va tout régler. Les responsables politiques, moi peut-être y compris, disent à chaque fois: «Ça va mal, mais maintenant vous allez voir.» Oui, on voit qu’il n’y a pas grand-chose qui se passe. Ça, c’est la réalité. Et si rien ne change, tout le débat sur le vivre-ensemble, c’est de la littérature. Il faut bien comprendre que l’on ne peut pas vivre dans une Ville-Région avec 28,7% de taux de chômage chez les jeunes. Parce qu’on est en train d’accumuler une dette sociétale qui est considérable. Voilà ce qui me motive. Cela dit, je ne vais pas vous dire que dans cinq ans on aura le plein emploi à Bruxelles, qu’il n’y aura plus de problèmes de qualification. Je sais très bien que ma marge de manœuvre est limitée. Se mettre en autocritique, c’est comme ça qu’on s’en sortira.
A.É.: Question un peu tarte à la crème: une fois cette autocritique effectuée, que comptez-vous faire?
D.G.: On prendra des décisions, comme pour les agents contractuels subventionnés (Didier Gosuin a annoncé que le gouvernement procédera à l’analyse et à l’évaluation des postes ACS, NDLR). Eh oui, ça crée des crispations. C’est ça le conservatisme, c’est refuser qu’à un moment donné on puisse se mettre en réflexion. Si notre modèle social est en train de s’effilocher, c’est parce que pour des raisons idéologiques, on refuse de se remettre en question et de briser les conservatismes. Dans ma lecture politique, je suis très «rocardien». Je crois que Rocard a tenté de faire bouger un certain nombre de lignes au PS français. Et il a raison de dire que c’est la social-démocratie qui est le plus responsable de ce que notre modèle social file à l’anglaise, vers le modèle anglo-saxon. On ne peut pas reprocher ça aux libéraux, c’est leurs convictions. Mais je pense que ceux qui faillissent le plus, c’est la gauche.
A.É.: Pourquoi?
D.G.: Parce que la gauche croit que la crise est conjoncturelle. Et donc, on attend que ça aille mieux. Eh bien, moi, je dis non. Pour sortir de la crise, il faut investir dans l’humain, dans l’enseignement, dans la qualification. On doit investir dans notre capacité de créativité et d’innovation. C’est là qu’on fera la différence sur le plan économique et sur le plan social.
A.É.: Dans ce contexte, le fait de disposer des portefeuilles de l’emploi et de la formation, qui n’étaient pas aux mains des mêmes ministres dans la législature précédente, c’était un must pour vous?
D.G.: Pour moi, c’est une imbécillité totale de dissocier l’emploi et la formation. Si je n’avais pas eu ces deux portefeuilles, je n’aurais pas été ministre. C’était une condition sine qua non. Ce faisant, je me mets un poids sur les épaules. Je peux me casser la gueule mais pas plus que les autres. On est dans une situation telle à Bruxelles, comment voulez-vous qu’on se casse la figure un peu plus?
A.É.: Malgré leurs divergences notoires, vos prédécesseurs Benoît Cerexhe et Emir Kir avaient lancé des «politiques croisées emploi-formation» censées rapprocher ces deux matières. Qu’allez-vous en faire maintenant que vous centralisez ces deux portefeuilles?
D.G.: Je suis le croisement. J’ai régulièrement autour de la table Actiris, le VDAB, Bruxelles Formation. Et c’est ensemble qu’on fait les politiques.
A.É.: D’accord, mais une ou deux choses concrètes en avaient résulté…
D.G.: Quoi?
A.É.: Le dossier unique du demandeur d’emploi, notamment, qui peut être alimenté tant par Bruxelles Formation que par Actiris.
D.G.: Dorénavant, nous aurons un trajet du demandeur d’emploi que les opérateurs d’emploi et de formation vont alimenter. On va pouvoir suivre le parcours d’une personne pour savoir où elle est en formation, ce qu’elle fait, quels stages. Écoutez, c’est tellement banal que je ne considère pas que c’est merveilleux. Mais même ça ce n’est pas évident. Je sais que j’ai des partenaires qui disent: «Ouh la la la, on ne va pas donner d’informations, parce que cela pourrait se retourner contre le demandeur d’emploi…»
A.É.: Certains opérateurs craignent effectivement que plus de transferts d’informations concernant le demandeur d’emploi ne facilitent les sanctions à son encontre…
D.G.: Pas d’angélisme. Les allocations de chômage, ce sont des droits et des obligations. J’ai lutté de manière très nette et très claire contre les exclusions de chômeurs décidées par l’ancien gouvernement. Je trouve que des exclusions à l’aveugle, c’est de la connerie. Ceux qui ont décidé cela portent cette responsabilité. Ce qu’il faut faire passer comme message au demandeur d’emploi, c’est que les pouvoirs publics vont tout faire pour lui donner la possibilité d’être autonome, d’être émancipé dans la société. Mais dire qu’il n’y aura jamais d’exclusion, c’est de la connerie aussi. Certains pourront se voir éventuellement exclus, parce qu’ils ne veulent pas travailler ou se voir insérés pour des raisons X ou Y.
A.É.: Il existe aussi des crispations à propos d’Actiris. À la suite de la sixième réforme de l’État, ce service devra contrôler la disponibilité des chômeurs. En plus de les accompagner dans leur recherche d’emploi. Existe-t-il un risque de confusion des rôles dans l’esprit des chômeurs?
D.G.: Je n’étais pas pour. Mais maintenant, on doit l’assumer avec humanité. J’entends certains dire qu’il faut créer un Actiris bis centré sur le contrôle. C’est exactement tout le contraire de ce qu’il faut faire. Parce que sa seule justification, ce sera de faire du contrôle. Plus il aura fait de contrôles et de sanctions, plus on dira «Ah, il est efficace». C’est humain. Alors que dans un ensemble on peut faire adhérer tout le monde à une stratégie. Et je vous l’ai dit, l’exclusion ce n’est pas l’objectif. L’objectif c’est l’inclusion.
A.É.: À propos de la formation, n’intervient-elle pas un peu tard? Ce n’est pas plutôt du côté de l’enseignement, qui n’est pas dans vos compétences, que l’on devrait renforcer les dispositifs?
D.G.: Notre enseignement est un des moins performants d’Europe. Il crée des inégalités, il les encourage, il ne donne pas de qualifications aux gens. On dit que c’est bateau, mais je pense que l’on devrait inscrire le droit à la qualification dans la Constitution. Cela existe dans d’autres pays en Europe. Et cela induit une obligation morale de résultat, de réformer son enseignement, de l’adapter aux besoins des jeunes et de la situation socio-économique, sociologique, aux besoins du marché.
A.É.: À parler de l’enseignement, vous venez de lancer une task force emploi/formation/enseignement/entreprises. Que comptez-vous en faire?
D.G.: Je suis un fédéraliste, c’est-à-dire que j’essaie de mettre les gens autour de la table. Je ne vous dis pas qu’on va refaire une nouvelle organisation institutionnelle, mais cessons de toujours mettre la Belgique cul par-dessus tête tous les cinq ans. Ici, nous essayons d’avoir une politique d’emploi, de formation et d’enseignement commune. C’est comme ça qu’on s’en sortira.
A.É.: Mettre l’enseignement dans le coup, c’est jouable?
D.G.: Je vais vous répondre par l’absurde. Ne pas le faire, vous pensez que c’est jouable? Il vaut mieux tenter de mettre les gens autour de la table, de discuter. En Belgique, pour l’instant, la Communauté française est dans sa bulle, les Régions sont dans leur bulle. On va essayer de faire en sorte que ça marche. Je ne dis pas que c’est gagné, mais c’est neuf. Et ça n’était pas évident il y a quelques années. Du côté néerlandophone, certaines formations politiques voyaient d’un mauvais œil le fait de mettre les communautés autour de la table. Le précédent gouvernement n’y est pas arrivé, nous oui. Ce n’est pas parce qu’on s’est réuni que le problème est résolu. Mais on va y travailler.
A.É.: Vous parlez de créer 20.000 formations à l’horizon 2020. Comment allez-vous vous y prendre?
D.G.: Je ne m’enferme jamais dans des chiffres. Ce que je veux, ce sont des formations qui mènent à quelque chose. Ma grille d’analyse, c’est: est-ce que la formation a permis à un certain nombre de personnes d’entrer sur le marché du travail? Allons dans le fond des choses. Et le fond des choses, c’est avoir une formation efficace, qui répond à la réalité des besoins et qui permet de sortir des gens de la mouise.
A.É.: L’idée, c’est de s’orienter vers les métiers en pénurie?
D.G.: Il faut que nous collions davantage aux besoins du marché. Parallèlement à ça, il faut aussi voir quels sont les leviers qui permettent de faire croître un emploi s’adressant plus particulièrement aux Bruxellois. Je pense notamment à l’espoir de faire naître une économie sociale axée sur les besoins et services de la ville. Un chantier qui a été à peine entamé.
A.É.: Existe-t-il une volonté de votre part d’aller vers une économie sociale de type entrepreneuriat social alors qu’à Bruxelles, on se situe plus pour l’instant dans une économie sociale d’insertion?
D.G.: L’économie sociale d’insertion est importante, et sera maintenue. Ce que je veux, c’est développer l’entrepreneuriat social. Ce pan de notre économie est sous-développé. Il existe des services, des produits nouveaux qui sont propres à l’économie urbaine et qui pourraient se développer dans une optique qui n’est pas une optique de profit. Nous devons faire naître ce type d’entrepreneuriat. Lui donner un cadre plus dynamique. On doit susciter des initiatives issues de gens souhaitant se lancer dans ce développement économique.
A.É.: Vous parlez de lui donner un cadre légal? Parce qu’une ordonnance pour l’économie sociale (principalement d’insertion, NDLR) existe déjà.
D.G.: Elle est inapplicable. Les arrêtés d’exécution n’ont jamais été votés. Je le découvre. Ici aussi on me dit: «Vous devez faire voter les arrêtés.» Mais je leur réponds: «Pendant dix ans, vous ne l’avez pas fait.» Et, tout d’un coup, je dois le faire? Je vais d’abord voir ce qui se passe. Et pourquoi.
Aller plus loin
Alter Échos n°397 du 17.02.2015: «Didier Gosuin: une médecine par quartier pour les patients précarisés»