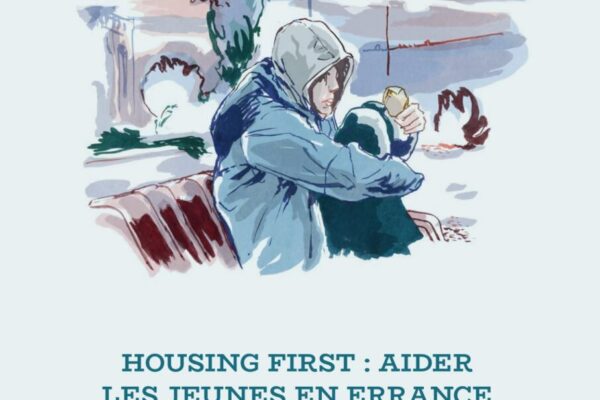Alter Échos: Quelle a été votre réaction lors des premières violences à Forest? C’était prévisible ou inattendu dans une ville comme Bruxelles?
Andrea Rea: C’était prévisible parce qu’il y avait déjà eu des événements similaires en France et en Grande-Bretagne. Les émeutes dans les Minguettes [en 1981, dans le quartier résidentiel de Vénissieux, dans la banlieue sud de Lyon, NDLR] avaient montré, comme à Forest, l’énorme contentieux entre les jeunes et la police. Il faut se rappeler qu’à l’époque, à Schaerbeek, le bourgmestre Roger Nols organisait le contrôle policier systématique des quartiers.
Fred Mawet: Je suis arrivée à la mission locale de Forest peu après les émeutes. J’ai vécu ses «répliques» en 94-95.
AR: Les émeutes ont été l’occasion de créer le délit d’incitation à l’émeute et de rébellion.
AÉ: Aujourd’hui encore, les relations entre les jeunes des quartiers populaires et la police restent très conflictuelles. Rien n’a changé?
AR: Le problème n’était pas réglé en 94-95 et il ne l’est toujours pas. Le contentieux s’est même aggravé. Parce qu’il touche désormais des gens qui sont «installés» socialement. La discrimination frappe des diplômés, qui vont réagir, ne plus se laisser faire. Avant, il y avait une plus grande soumission dans les classes populaires qui ne pouvaient donc réagir que de manière collective.
AÉ: En 91, on avait évoqué l’intégration des jeunes d’origine étrangère dans les rangs de la police. Trente ans plus tard, il semble qu’on n’ait guère avancé.
FM: Cela dépend. Dans certaines communes, on voit une majorité de personnes issues de l’immigration dans la police.
AR: Les chiffres ne disent pas ça. Au niveau local, ils sont peut-être plus nombreux mais, dans la police fédérale, ils sont sous-représentés. L’impossibilité de réussir l’examen linguistique fait que la majorité des engagements à Bruxelles sont ceux de néerlandophones originaires du Brabant flamand qui ne connaissent pas les populations des quartiers bruxellois et ne rencontrent les jeunes que dans des situations difficiles.
AÉ: Contrats de quartier, soutien aux associations… Les émeutes ont-elles généré rapidement de nouvelles politiques sociales?
FM: La plupart de ces politiques avaient déjà été lancées avant. Les zones d’éducation prioritaires (ZEP) ont été créées à la fin des années 80. Les missions locales sont venues dans la foulée.
AR: Ce qui a été déterminant, c’est le retour des socialistes au pouvoir en 1987 et, avec lui, la volonté de mettre en place des politiques en faveur de la jeunesse. Les socialistes français avaient créé les ZEP. On a importé plusieurs de ces politiques. Charles Picqué, en devenant président de la Région bruxelloise, a créé le premier programme de soutien aux associations d’aide aux immigrés. En même temps, Yvan Mayeur déposait sa proposition de loi pour l’acquisition de la nationalité belge à la naissance pour la seconde génération. Il y avait à l’époque tout un discours pour dire «l’intégration est en marche», mais ce n’est pas ce que les jeunes vivaient dans la réalité, à cause des relations avec la police. Après les émeutes, le Commissariat royal à la politique des immigrés a créé le Fonds d’impulsion à la politique des immigrés (FIPI). Mais avec lui sont nés aussi les contrats de sécurité.
«La discrimination frappe des diplômés, qui vont réagir, ne plus se laisser faire. Avant, il y avait une plus grande soumission dans les classes populaires qui ne pouvaient donc réagir que de manière collective.» Fred Mawet
AÉ: Intégration. Ce mot a disparu du vocable sociopolitique…
AR: Effectivement. Aujourd’hui on ne parle plus d’intégration mais de discrimination. En 91, la plupart des jeunes sur le parvis de la place Saint-Antoine étaient encore majoritairement des non-Belges. À l’époque, la question de l’intégration était une question légitime. Aujourd’hui, ces jeunes sont des Belges racisés et donc le changement de paradigme est complet. Le paradigme actuel est celui de la discrimination, soit un traitement illégitime imposé aux personnes sur la base de l’origine sociale et/ou ethnique.
AÉ: Quelles sont les mesures qui ont le plus concrètement changé le quotidien de ces jeunes et de leurs parents?
AR: Plusieurs politiques urbaines ont amélioré les choses. En 91, à Bruxelles, 30% des habitations avaient encore des w.c. sur le palier. On a mis en place des politiques de rénovation du logement, en partie par les contrats de quartier. Le Forest d’aujourd’hui n’est plus celui de 91. Ce qui a moins changé, c’est la question de l’accès à l’emploi. Les jeunes d’aujourd’hui sont les enfants des émeutiers de 91; or la question de l’emploi n’a guère évolué pour eux. D’abord parce qu’il reste très peu d’emplois peu qualifiés en raison de la désindustrialisation de Bruxelles, mais aussi parce que la formation reste insuffisante. Enfin, il y a la discrimination ethnique qui touche, et c’est nouveau, surtout les femmes qui portent le voile. On est aujourd’hui dans une situation désastreuse de ce point de vue. On a une pénurie d’infirmières dans les hôpitaux, mais on refuse d’embaucher celles qui portent le voile.
AÉ: Revenons au FIPI. En quoi a-t-il changé la donne?
AR: Le FIPI est lié aux politiques régionales. À Bruxelles, on ne peut pas le nier, cela a financé les associations mais cela a aussi transformé l’orientation des politiques existantes. Au départ, les pionnières à la Communauté française, comme Thérèse Mangot [qui était en charge des centres culturels de la Communauté française, NDLR], finançaient les associations ayant une dimension culturelle. C’était un minuscule programme qui voulait valoriser l’apport culturel des populations immigrées au travers de cours de cuisine, de musique… Avec le FIPI, c’est la dimension sociale qui s’est imposée. J’ai fait l’évaluation des programmes de cohabitation FIPI: 70% du budget a été octroyé aux écoles de devoirs. On a financé les associations qui «réparaient» en quelque sorte tout ce qui ne fonctionnait pas dans le système scolaire, et l’aspect culturel a totalement disparu. Le FIPI a créé de nouvelles associations. Son utilité est évidente.
FM: Pour moi, le gros problème de ces nouveaux programmes, c’est qu’ils sont venus doubler des politiques existantes au niveau communal. Plutôt que de refinancer le culturel, l’éducation permanente, l’action sociale, on a fait une superposition des politiques. Les associations ont fait leur «popote» comme elles ont pu. Il a fallu du temps pour réguler et évaluer ces programmes de cohésion sociale. À Forest, cela se passait plutôt bien. Là où il existait une certaine démocratie sur le plan local, on a pu «tricoter» tout ça de manière harmonieuse et faire du bon travail. Dans d’autres communes – car elles seules géraient ces programmes –, cela a surtout servi à faire du clientélisme politique. Il fallait, au niveau des associations, articuler FIPI, politiques de cohésion sociale, des programmes comme Été Jeunes. C’était des politiques morcelées qui ont parfois conduit à des réponses totalement inappropriées. Ainsi, on engageait de «grands frères» pour essayer qu’il n’y ait pas trop de troubles dans le quartier mais ces «grands frères» n’étaient pas du tout formés. Bref, cela a donné le meilleur et le pire.
AÉ: Les communes étaient seules maîtresses à bord?
FM: C’étaient des politiques régionales mais déléguées aux communes. À certaines communes (sept pour être précis), en fonction du pourcentage de populations pauvres, d’origine étrangère. Comme par hasard, c’était toutes des communes gérées par des bourgmestres socialistes.
AR: En 93, on a régionalisé la politique d’intégration des communautés étrangères. Les Régions sont devenues compétentes, plus la Communauté française. À Bruxelles, on avait des ministres régionaux qui étaient surtout des municipalistes. Ils étaient donc tous dans une optique de délégation totale des compétences et du financement aux communes. Les communes recevaient une enveloppe financière mais sans ligne directrice claire au niveau régional. Dans certaines communes, comme Bruxelles, Molenbeek, on avait une association qui monopolisait tout et dans une logique très «top down». En 2004, avec le décret sur la cohésion sociale, on est passé à une politique régionale plus affirmée. Le Centre bruxellois d’action interculturelle (CBAI) est devenu une sorte de régulateur dans l’attribution des fonds mais aussi dans l’évaluation des politiques. Avant, on attribuait des fonds mais on ne disait pas pour quoi faire ni comment. Ce n’est plus le cas.
FM: Cette reprise en main par la Région a permis d’objectiver les choses, de mettre fin au clientélisme local.
«Il y avait à l’époque tout un discours pour dire ‘l’intégration est en marche’, mais ce n’est pas ce que les jeunes vivaient dans la réalité, à cause des relations avec la police.» Andrea Rea
AÉ: Et sur le plan politique, quel a été finalement l’impact des émeutes et des politiques d’intégration mises en place peu après 91?
AR: C’est d’avoir fait du parlement bruxellois le parlement le plus représentatif de la population locale existante. Bon, d’accord, que certains élus fassent du clientélisme, ce n’est pas faux. Cela n’a peut-être pas eu non plus l’impact politique que l’on imaginait, mais, sur le plan symbolique, c’est important. Cela permet à ces populations d’origine étrangère de se référer à leurs députés pour attirer l’attention sur tel ou tel problème. Ce phénomène n’est pas possible en France. Cette représentation politique est sans aucun doute quelque chose qu’il faut valoriser dans la gestion bruxelloise de l’immigration. On a réussi là un processus qui n’existait pas du tout avant 91.
AÉ: C’est propre à Bruxelles? Et pourquoi? Parce que les partis politiques bruxellois l’ont voulu?
AR: Oui, c’est spécifiquement bruxellois. C’est la conjonction du phénomène de concentration des populations d’origine étrangère sur le territoire et des lois électorales qui permettent que les gens soient élus sur la base du vote préférentiel et pas en fonction de la place occupée sur la liste. Des candidats qui se trouvaient à la 25e place ont pu être élus à la place d’un candidat belge en tête de liste mais qui avait recueilli bien moins de voix. Et, oui, cela a aussi été rendu possible par l’ouverture des partis à ces candidats. On ne peut pas le nier: cela a joué un rôle essentiel.
FM: Auraient-ils pu faire autrement? Pour ces partis, c’était une question de survie!
AR: En France, dans les villes de banlieue, ils cadenassent l’accès aux listes électorales. Avec le vote à deux tours et qui n’est pas préférentiel, c’est le parti qui décide de la composition de la liste.
«Il y a des écoles, secondaires surtout, qui sont restées des ghettos, où rien n’a changé. Rien. Or, comme en 91, le vrai enjeu, cela reste l’école, l’éducation.» Fred Mawet
AÉ: En 91, les jeunes se plaignaient de l’absence de mixité dans leur quartier. Ils disaient ne plus avoir de contact avec les jeunes Belges. Comment ce phénomène a-t-il évolué?
FM: Il y a un phénomène de gentrification dans ces quartiers, notamment à Saint-Gilles. Par ailleurs, beaucoup de familles turques et maghrébines sont devenues propriétaires de leur logement puis l’ont revendu pour s’installer ailleurs.
AR: Il y a plusieurs dynamiques en cours. On constate une exacerbation de ce qui se passait déjà en 91 avec des parties de quartiers toujours plus précarisées. C’est le cas autour de l’institut de la Providence à Anderlecht, qu’on appelait à l’époque le Petit Chicago. Tout est resté dans le même état sauf que les Guinéens ont remplacé les Marocains. À l’inverse, à certains endroits, et cela concerne parfois trois rues, on observe une gentrification. Certains quartiers de Forest sont devenus «bobos». Il y a des changements de population à tous les niveaux. Le quartier de la gare du Midi, par exemple, est, de plus, habité par des Subsahariens.
FM: À Forest, les jeunes de 91 n’y sont plus.
AR: Ce remplacement des populations est quelque chose qu’on observe depuis longtemps dans la manière d’habiter une ville. Les classes moyennes belges ont quitté certains quartiers, les classes moyennes marocaines aussi. Les quartiers sont devenus plus mixtes. La ségrégation urbaine existe mais prend des dimensions beaucoup plus localisées, avec parfois seulement quelques rues qui sont habitées par une classe sociale plus favorisée et développent des comités de quartier puissants. Par contre, dans les écoles, la ségrégation reste très forte.
AÉ: Pourquoi dans les écoles?
AR: La gentrification des quartiers ne conduit pas à ce que les «gentrifiés» se servent des services et des équipements de l’endroit où ils vivent. Ce sont des familles qui vont conduire leurs enfants à l’école à Uccle ou à Woluwe.
FM: Il y a des familles bourgeoises qui cherchent la mixité sociale. Si, dans leur quartier, on trouve des écoles avec des équipes pédagogiques fortes et un directeur soucieux d’ouvrir l’école sur le quartier, elles mettront leurs enfants dans ces écoles. Le problème, c’est que, comme il n’y a pas de régulation des inscriptions en Belgique, très vite ces plus favorisés vont remplacer les autres populations. Ils vont inscrire leurs enfants très tôt et s’assurer d’avoir «leur» place. Mais, pour le reste, il y a des écoles, secondaires surtout, qui sont restées des ghettos, où rien n’a changé. Rien. Or, comme en 91, le vrai enjeu, cela reste l’école, l’éducation.
En savoir plus
«Cohésion sociale: Vervoort contre les communes», Alter Échos n°462, mars 2018, Cédric Vallet.
«Au carrefour des discriminations», Alter Échos n° 455, novembre 2015, Céline Teret.
«La cohésion sociale se décline dans toutes nos politiques», Alter Échos n° 406, juillet 2015, Cedric Vallet.
«Cohésion sociale: le changement dans la continuité?», Alter Échos n°395, janvier 2015, Cédric Vallet.
«Les jeunes dans la ville: ceux qui ‘tiennent les murs’ et les autres», Alter Échos n° 379, mars 2014, Martine Vandemeulebroucke.
«Quand la Belgique intègre…»: un numéro spécial de la revue «Nouvelle Tribune», Alter Échos n°145 juillet 2005, Pierre Verbeeren.