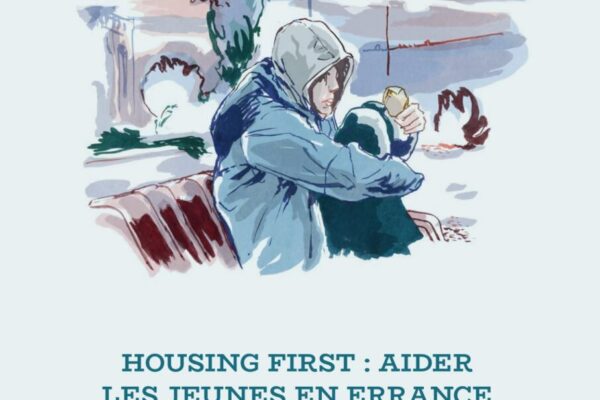Sarajevo, carrefour entre l’Occident et l’Orient. La ville entourée de montagnes s’étend le long de la Miljacka. Quand le soleil devient trop écrasant, il suffit de monter sur ses flancs boisés pour profiter de la fraîcheur. En prenant de la hauteur, la vue sur cette enclave urbaine se révèle époustouflante. L’histoire du pays se lit à travers l’horizon: les clochers des églises catholiques et orthodoxes, les minarets des mosquées, les bâtiments à l’architecture ottomane, austro-hongroise ou encore yougoslave. Et puis les cimetières, dont les pierres tombales blanches réfléchissent la lumière. Ici, les morts côtoient les vivants. Partout les traces de la guerre restent omniprésentes. Entre 1992 et 1995, la guerre ethnique de Bosnie a fait près de 100.000 victimes et plus de deux millions de déplacés. Les traumatismes sont ancrés dans la chair. Qu’on veuille s’en détacher ou pas, chacun, chacune est profondément marqué par ces évènements. À la suite de la «génération sacrifiée», qu’en est-il des perspectives de la génération de l’après? Rencontre avec quatre jeunes qui tentent de faire bouger les lignes figées du passé.
Les accords qui divisent
1995, la signature des accords de Dayton met fin au conflit entre Serbes, Croates et Bosniaques. Le pays est séparé en deux entités: la Fédération bosno-croate d’une part et la Republika Srpska (République serbe de Bosnie-Herzégovine) de l’autre. Près de trente ans plus tard, chaque communauté continue de vivre repliée sur elle-même dans un nationalisme toujours plus criant. Neira Sabanovic a 27 ans, elle est Belge d’origine bosniaque. Doctorante au Centre d’étude de la vie politique de l’ULB, elle réside actuellement à Sarajevo pour mener des recherches sur la mobilisation de la mémoire collective dans les discours politiques de peur dans la région. «L’annexe 4 des accords de Dayton a introduit la séparation ethnique à tous les niveaux de pouvoir. Rien d’étonnant donc que, dans ce système, les partis dominants soient des partis nationalistes», analyse-t-elle.
La Bosnie-Herzégovine est un territoire d’une superficie d’un peu plus d’une fois et demie la Belgique (51.209 km²) qui compte 3,2 millions d’habitants. Ici, avant la guerre, les différentes communautés vivaient ensemble: on célébrait des mariages mixtes, dans le même immeuble, les voisins serbes, croates et bosniaques se filaient des coups de main, les enfants fréquentaient les mêmes écoles. Mais ça, c’était avant. Prenons Banja Luka, par exemple. Située au nord-ouest du pays, c’est là que le père de Neira Sabanovic a passé la première partie de son existence avant de devoir fuir. Autrefois multi-ethnique, la cité est désormais le siège économique et politique de la Republika Srpska et de son dirigeant: l’ultranationaliste séparatiste serbe Milorad Dodik. «Le narratif sécessionniste de Dodik lui a permis de s’imposer comme l’homme politique dominant pour la défense des intérêts des Serbes de Bosnie. Mais ne nous détrompons pas, ce système nationaliste exacerbé du côté serbe tient précisément parce qu’en face il y a d’autres nationalistes», explique l’experte en faisant référence au Parti d’Action démocratique (SDA, centre droit, nationaliste bosniaque) et à l’Union démocratique croate de Bosnie et Herzégovine, le HDZ-BiH.
À chaque communauté sa version de l’histoire
Tandis que des charniers sont encore à découvrir, partout les blessures restent à vif. Il y a quelques semaines, en avril, une résolution a été présentée à l’Assemblée générale des Nations unies pour dénoncer toute expression de négationnisme à l’encontre du génocide de Srebrenica durant lequel 8.000 hommes bosniaques ont été assassinés en 1995 par les milices serbes de Bosnie-Herzégovine. Cette résolution internationale a réveillé les tensions: Milorad Dodik s’est aussitôt prononcé contre. «Nous allons clairement indiquer que nous ne pouvons pas vivre avec les Bosniaques, qui nous calomnient constamment et imposent des responsabilités là où elles n’existent pas», a-t-il déclaré. Si la question des atrocités reste extrêmement sensible, c’est notamment en raison d’une incapacité à se mettre d’accord sur la véracité des faits. Dans un pays où chaque entité défend son système scolaire, où chaque communauté édite ses propres manuels, où chaque partie scande sa rhétorique victimaire, quelle place pour la mémoire? Pour trouver d’autres regards aux récits défensifs, il faut se tourner vers la société civile.
Tatjana Milovanović a 30 ans et vient d’une famille serbe. Son père a participé à la guerre. Face à cette histoire lourde à porter, elle a décidé d’emprunter la voie du dialogue autour des enjeux mémoriels. Elle est directrice des programmes du Post-Conflict Research Center, une ONG qui entend faciliter les liens interethniques. «Nous travaillons beaucoup avec les jeunes, mais la plupart du temps c’est en extrascolaire. Puisque le territoire est morcelé administrativement, c’est très compliqué de pénétrer dans les écoles. Cependant, nous œuvrons avec les professeurs volontaires à créer un cursus d’histoire du conflit commun aux trois communautés du pays.» L’activiste pour la paix observe par ailleurs différentes réactions parmi les jeunes au sein des ateliers et formations qu’elle donne. «Quand on parle de sujets sensibles comme la question de génocide, les Serbes montrent sans doute plus de craintes parce qu’ils ont peur d’être blâmés. Évidemment, aucun jeune n’est responsable de ce qu’il s’est passé dans les années 90. Nous insistons là-dessus durant nos séances pour essayer de rompre ce préjudice entre les différents groupes ethniques.»
Génération No Future
Mostar. Toutes celles et ceux qui sont en âge de s’en souvenir auront probablement en tête la vision du pont détruit en 1993. L’image est devenue l’un des symboles de la guerre des Balkans. À quelques kilomètres de cette ville du sud du pays se trouve la région de Prozor-Rama, théâtre d’un «nettoyage ethnique» mené par le Conseil de défense croate (HVO) en 1992-1993 à l’encontre de la population bosniaque. Aujourd’hui, seules quelques mosquées à moitié abandonnées témoignent de la présence passée des musulmans. Sur les rives du grand lac de Rama, au milieu des arbres fruitiers, flottent des drapeaux aux couleurs des Croates de Bosnie. Stjepan Filipović a 28 ans, c’est ici qu’il a grandi. Comme nombre de jeunes de sa génération, et ce peu importe les communautés, il a l’étranger dans le viseur en quête d’un avenir meilleur. «Ici, il y a beaucoup de corruption, de népotisme, il faut faire partie d’un parti pour accéder aux emplois. Moi je ne veux pas renoncer à mes idéaux en me vendant à ce système… J’ai envoyé des tas de lettres de candidatures, mais là j’ai perdu espoir.» Faute de mieux, selon les saisons, en Autriche ou en Croatie, l’ingénieur travaille comme serveur. «Tous mes amis sont éparpillés dans différents pays. Nous assistons à une fuite des cerveaux. Mais comment faire autrement? Mon objectif est de me perfectionner en allemand, de faire reconnaître mon diplôme et ensuite de trouver une position en Suisse, en Allemagne ou en Autriche.»
«Tous mes amis sont éparpillés dans différents pays. Nous assistons à une fuite des cerveaux. Mais comment faire autrement? Mon objectif est de me perfectionner en allemand, de faire reconnaître mon diplôme et ensuite de trouver une position en Suisse, en Allemagne ou en Autriche.»
Stjepan Filipović, 28 ans
Pour lui, la seule solution à cet exode serait que les politiciens prennent la mesure des enjeux auxquels fait face la jeunesse. «C’est important de créer plus de débats publics pour porter de nouvelles idées. Mais ce que j’observe, c’est le contraire: les traumas de la guerre sont utilisés pour attiser les divisions. Nous vivons dans un pays construit sur la peur.» Assez défaitiste, Stjepan Filipović tente de trouver du sens là où il peut, notamment en s’engageant dans des groupes d’activistes écologistes: la pollution du l’air, des sols et de l’eau est en effet l’une des conséquences directes de la corruption. Aussi, il participe à son échelle à la guérison collective des traumatismes. «J’ai joué un petit rôle dans le film La Voix d’Aïda qui raconte l’histoire du génocide de Srebrenica. C’était important pour moi, beaucoup de gens n’admettent toujours pas ce génocide.»
Le «backlash»
Selon la dernière enquête autour de la jeunesse bosnienne menée de la fondation Friedrich Ebert, un tiers des jeunes interrogés préférait voir émerger un régime autoritaire «dans certaines circonstances». Les auteurs de l’étude justifient cet enclin non pas comme un dédain pour la démocratie, mais plutôt comme une conséquence des failles du système politique et de la corruption. Au niveau de la liberté de la presse, la situation s’aggrave également. Selon le dernier rapport de l’organisation Reporters sans Frontières, la Bosnie-Herzégovine est passée de la 64e place l’année dernière à la 81e place sur 180 cette année. En cause notamment, la réintroduction en Republika Srpska de la criminalisation de la diffamation. Azem Kurtic, 30 ans, est journaliste et membre du Balkan Investigative Reporting Network. Il couvre les questions de droits humains, de crimes, de corruption, d’ingérence politique. Avec ses collègues, au quotidien, il se bat pour un fact checking rigoureux dans un pays où la manipulation des faits se révèle une norme. «J’ai grandi avec la perspective bosniaque de la guerre et je voulais en savoir plus… C’est ainsi que le journalisme est venu à moi. Je me donne comme mission personnelle de sauver le plus de témoignages possible. Mais dès que j’écris quelque chose, peu importe à quel point je tente d’être nuancé, il va y avoir des opposants qui vont critiquer.» Comme beaucoup de ses collègues, il observe une montée des attaques. «Certains journalistes ont dû quitter le pays après avoir été menacés de mort. On ne sait pas à qui on peut faire confiance.»
«Certains journalistes ont dû quitter le pays après avoir été menacés de mort. On ne sait pas à qui on peut faire confiance.»
Azem Kurtic, journaliste et membre du Balkan Investigative Reporting Network
Quant au futur proche, tous les regards sont portés vers l’Ukraine. «Les images de bombardements et la rhétorique russe ont ravivé les traumas de la population. Ce qu’il va se passer en Ukraine dans les prochains mois est extrêmement important pour l’équilibre géopolitique de la région. Poutine incite Dodik à maintenir une insécurité afin de garder ce risque de conflit aux portes de l’Union européenne», commente la politologue Neira Sabanovic. Aussi, à Bruxelles, le 21 mars 2024, les 27 dirigeants ont donné leur accord à l’ouverture des négociations d’adhésion à l’Union européenne avec la Bosnie-Herzégovine. Un nouveau souffle à venir?