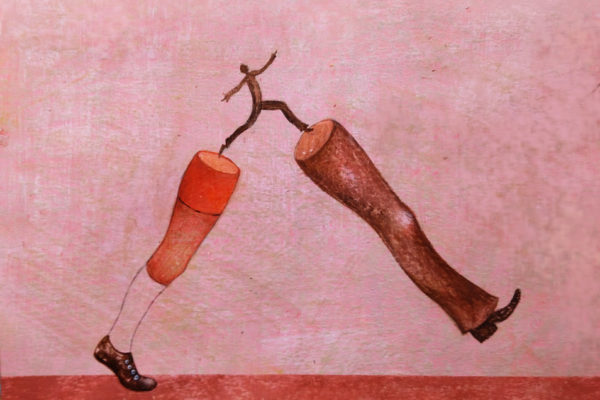« Rozenn Le Berre a travaillé durant 18 mois comme éducatrice dans un service d’accueil pour les jeunes exilés arrivés en France sans leurs parents. Cette éducatrice de 28 ans devait, à partir de rencontres d’une à deux heures, constituer un dossier en vue d’établir si oui ou non, ils pouvaient obtenir le statut de mineurs isolés étrangers. En rentrant chez elle, Rozenn a compilé les histoires qu’elle entendait. Ces textes sont aujourd’hui rassemblés dans un livre, plongée intime dans un bureau où se joue le destin de jeunes filles et garçons amenés à devenir « mineurs à protéger ou majeurs à expulser ».
Alter Échos : « Je implore toi dormir couloir », c’est la première phrase et la première histoire de votre livre. Pourquoi avoir choisi celle-là ?
Rozenn Le Berre : C’est l’histoire d’un jeune Albanais, Mirjet, qui me disait avoir 17 ans mais n’était pas encore reconnu mineur. Il dormait à la rue et cette phrase « Je implore toi dormir couloir » est apparue sur mon écran sur Google traduction. D’habitude, les traductions dans ce logiciel sont plutôt drôles, celle-ci était terrible, d’autant que toutes les chambres de notre service étaient prises. J’ai commencé par cette histoire-là car elle explique tout l’enjeu du service dans lequel j’ai travaillé, qui vise à assurer le premier accueil des personnes se présentant comme mineur isolé étranger (MENA, en Belgique, NDLR), c’est-à-dire une personne de moins de 18 ans sans représentant légal sur le territoire français et de nationalité étrangère. Ces jeunes-là sont inexpulsables et doivent être placés en foyer car ils sont considérés comme des « enfants en danger ». C’est donc un statut protecteur. Mon service a comme rôle de se charger du premier accueil et de transmettre un rapport à partir des entretiens réalisés avec les jeunes qui permettront au département de déterminer, si oui ou non cette personne est mineure étrangère, si elle sera un enfant à protéger ou un étranger à expulser. En attendant la décision, établie en fonction de notre rapport, les jeunes doivent théoriquement être mis à l’abri.
A.É. : « Théoriquement », vous dites, car la réalité est bien différente…
R.LB. : En France, l’accueil des mineurs isolés étrangers est régi par la circulaire Taubira qui dit que l’État finance cinq jours d’accueil et d’évaluation des jeunes. En théorie, les jeunes sont donc hébergés et nourris le temps de l’évaluation. À l’issue de cette petite semaine, il reçoit la décision. Dans la réalité, il y a un manque criant de places ce qui fait que la plupart des jeunes sont à la rue le temps de l’évaluation, et l’évaluation est longue… Ce qui veut dire que les jeunes restent dehors longtemps. C’est totalement contraire à la circulaire. Heureusement que des réseaux associatifs se sont constitués pour assurer les failles des institutions incapables de gérer les mineurs. En 2015, il y a eu environ 6.000 jeunes reconnus mineurs étrangers, un nombre pas si énorme à l’échelle de la France…
A.É. : Comment gérez-vous, en tant que travailleuse sociale, ces deux missions contradictoires ?
R.LB. : C’est schizophrénique. On est à la fois dans du premier accueil, c’est-à-dire qu’on reçoit des jeunes dans des situations de vulnérabilité extrême et on essaye de répondre à leurs besoins de base : leur faire rencontrer un médecin et leur donner un toit. D’autre part, le travailleur social écrit le rapport d’évaluation qui permettra au département de prendre la décision. Nous ne sommes pas décisionnaires en soit mais on fait partie du système qui vise, pour une partie des jeunes, à ne pas leur accorder de protection. Une fois que la décision est prise, c’est à nous de mettre à la rue des personnes reconnues majeures hébergées chez nous. C’est à nous de frapper à la porter de leur chambre. Et ce rôle est très difficile à tenir.
A.É. : Vous racontez le rapport au mensonge des personnes que vous rencontrez…
R.LB. : Il y a forcément des histoire prêtes-à-raconter car les cases pour les statuts sont tellement fixes que les discours s’adaptent. Chacun adapte, avec des erreurs parfois. On le sentait parfois très vite. Il arrivait aussi que des jeunes nous racontent des histoires qui semblaient récitées et qui pouvaient correspondre à une demande d’asile, alors qu’ils avaient moins de 18 ans et donc pas besoin de justifier une situation de danger dans leur pays puisque les raisons du départ au pays n’ont pas d’impact sur la décision, contrairement à la demande pour le statut de réfugié. Parfois, la vérité est parfois bien plus douloureuse que le mensonge qu’on leur a conseillé de raconter. De toute façon, l’exil est forcément traumatique, donc toutes les histoires sont par nature douloureuses. Certains jeunes allègent d’ailleurs leur récit pour nous protéger. Par ailleurs, cette situation où l’on met le travailleur social en position de juger s’il s’agit de la vérité ou d’un mensonge est problématique. Qui je suis pour estimer qu’un jeune dit vrai ou faux ?
A.É. : Sachant que vous tenez leur destin en main, n’y a–t-il pas une envie de triche ? Et comment on la gère ?
R.LB. : Tous les travailleurs sociaux savent qu’ils ont une marge de manœuvre immense dans l’orientation de la décision. Quand je travaillais, je me forçais à ne pas avoir l’envie de tricher, car la seule manière pour moi d’accepter ce travail était de me dire « mon travail est de protéger les mineurs, pas d’aider tous les exilés ». En gardant en tête qu’à côté de mon boulot ou après mon boulot, j’allais pouvoir militer pour tout le monde, ce que j’ai fait dans la Jungle de Calais. Cette règle personnelle me permettait de tenir et de ne pas avoir envie de tricher. Il faut aussi savoir que nous étions deux en entretien, ce qui permet de protéger la trop grande subjectivité. Même si l’envie de tricher était très forte, je me rendais compte aussi que c’est tellement difficile de tricher pour quelqu’un et pas un autre… Cette tentation n’est pas tenable à long terme.
A.É. : Vous avez décidé d’arrêter ce travail par « peur de devenir un monstre ». C’est-à-dire ?
R.LB. : On voit énormément de jeunes et on peut facilement dériver vers une position moins accueillante et moins bienveillante. J’ai eu très peur de glisser vers cette posture… Je suis souvent rentrée le soir en culpabilisant d’avoir mal parlé aux jeunes, d’avoir été agacée.
A.É. : Quand et pourquoi avez-vous commencé à écrire ?
R.LB. : J’ai commencé à écrire au moment où j’ai annoncé à mes responsables que je n’allais pas renouveler le contrat. Je craignais de voir disparaître de ma mémoire cette matière extrêmement riche, ces histoires de jeunes héroïques. J’ai commencé à écrire pour ne pas oublier d’abord. Il y avait certainement aussi un effet cathartique.
A.É. : Votre livre vient de sortir mais plusieurs extraits avaient été publiés sur Libération il y a quelques mois. Quelles ont été les réactions ?
R.LB. : J’ai eu énormément de réactions. Cela s’explique je pense en raison du peu de témoignages sur l’intérieur. Les gens ont apprécié pouvoir rentrer dans le bureau avec moi, découvrir ces jeunes à travers mes yeux et mon ressenti. C’est difficile de s’identifier à un mineur étranger isolé, l’identification est plus simple avec moi. J’ai eu énormément de retours de travailleurs sociaux, d’éducateurs, qui m’ont remercié de parler de situations douloureuses qu’on a l’impression de vivre tout seuls. Ils partageaient mes constats sur le manque de moyens et se reconnaissaient dans cette tension entre accompagnement et contrôle. »