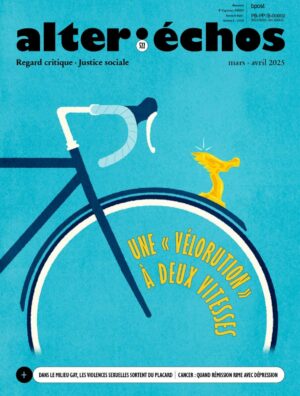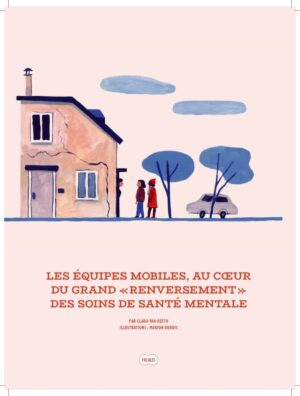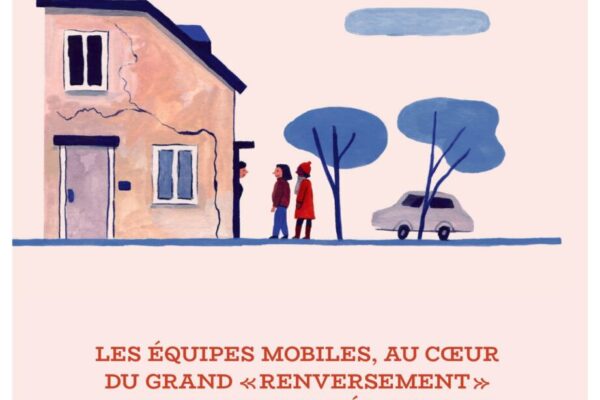Le dernier rapport de la Commission nationale d’évaluation des interruptions de grossesse (IVG), publié en 2023, est sans appel: les centres d’IVG extra-hospitaliers – tant francophones que néerlandophones – réalisent 84% des avortements en Belgique. Les derniers chiffres datant de 2021 montrent que ces centres ont assuré 75,5 % des IVG dans les établissements de santé francophones et 98 % dans les établissements néerlandophones.
L’approche médicale des soins et sa prise en charge ne varient pas d’une région à l’autre, tous les centres extra-hospitaliers de Belgique qui pratiquent des IVG ont une convention avec l’Inami. C’est au niveau des infrastructures que des différences apparaissent. Là où la Flandre compte seulement quatre centres spécialisés, situés à Anvers, Gand, Hasselt et Ostende, la Wallonie et Bruxelles disposent d’une trentaine de centres de planning familial (CPF) pratiquant l’avortement. «Il n’y a plus de centre de planning familial en Flandre. Il s’agit d’une particularité de la Fédération Wallonie-Bruxelles», souligne Cécile Artus, présidente de Sofélia, la fédération militante des centres de planning familial solidaires du réseau Solidaris.
Là où la Flandre compte seulement quatre centres spécialisés, situés à Anvers, Gand, Hasselt et Ostende, la Wallonie et Bruxelles disposent d’une trentaine de centres de planning familial (CPF) pratiquant l’avortement.
Bien que des centres de planning aient existé en Flandre – le tout premier centre du pays était d’ailleurs flamand –, le contexte politique, plus hostile à l’IVG qu’au sud du pays, a conduit à leur disparition complète. Durant les années septante, les centres de planning familial flamands qui pratiquaient des avortements malgré l’illégalité ont été confrontés à des pressions croissantes, notamment de la part du Parti chrétien flamand (anciennement CVP, aujourd’hui CD&V), qui s’est fermement opposé à l’avortement.
Un même combat
Après Mai 68, les luttes pour le droit à l’avortement ont pris une ampleur considérable, du fait de l’évolution des mentalités et du travail acharné des médecins, des militantes féministes et des associations qui ont uni leurs forces pour revendiquer la légalisation de l’avortement. Dans une interview publiée sur le site de la VUB, le professeur Jean-Jacques Amy, gynécologue et militant pour les droits des femmes, témoigne des difficultés auxquelles il faisait face en 1973, époque où l’avortement était encore largement réprimé dans tout le pays: «La Flandre était encore très catholique, même à l’Université de Gand, où les demandes d’avortement étaient généralement refusées. J’ai donc systématiquement orienté les femmes vers les Pays-Bas, où l’avortement était toléré.» La même année, l’affaire Willy Peers marque un tournant majeur. Ce gynécologue est emprisonné à Namur durant un mois pour avoir pratiqué plus de trois cents avortements. L’événement génère une mobilisation générale. Peers ne sera jamais condamné, un fait qui témoigne d’un changement radical dans la perception publique de l’avortement à l’époque.
En 1980, sous la pression politique du CVP et par crainte de voir leurs financements disparaître, les centres de planning familial flamands décident de séparer leurs activités. Une décision qui acte en quelque sorte leur disparition. D’une part, ils créent des cliniques dédiées à l’avortement – les abortuscentra – et, d’autre part, des centres de santé reproductive, appelés Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding (CGSO), qui se concentrent sur la prévention et l’éducation en matière de santé sexuelle. Cette division permettait de protéger l’avortement, en le distinguant clairement des autres services de santé reproductive, afin de minimiser les risques politiques et de préserver les financements de ces centres de santé.
L’affaire Willy Peers marque un tournant majeur. Ce gynécologue est emprisonné à Namur durant un mois pour avoir pratiqué plus de trois cents avortements. L’événement génère une mobilisation générale. Peers ne sera jamais condamné, un fait qui témoigne d’un changement radical dans la perception publique de l’avortement à l’époque.
Au sud du pays, dès 1975, certains centres de planning familial décident de pratiquer des avortements en dehors du cadre légal. Ces actes de résistance se soldent en 1979 par la création du Groupe d’action des centres extra-hospitaliers pratiquant l’avortement (GACEHPA), toujours actif aujourd’hui. Les années 80 sont marquées par une répression importante avec de nombreux procès pour avortement contre des gynécologues, des médecins généralistes, des infirmières et des patientes. En 1984, Jean-Jacques Amy est ainsi condamné à un mois de prison pour avoir pratiqué une interruption de grossesse sur une jeune fille de 13 ans victime de viol.
L’aboutissement des mobilisations se concrétise en 1990 avec la dépénalisation partielle de l’avortement, grâce à la loi Lallemand-Michielsens. Cette législation marque une étape décisive, mais elle est loin d’être simple à adopter. Le roi Baudouin, fervent catholique, refuse de signer la loi, obligeant le gouvernement à recourir à un argument constitutionnel, l’impossibilité de régner, pour la promulguer sans l’accord du souverain.
L’aboutissement des mobilisations se concrétise en 1990 avec la dépénalisation partielle de l’avortement, grâce à la loi Lallemand-Michielsens. Cette législation marque une étape décisive, mais elle est loin d’être simple à adopter.
«Si cela n’avait tenu qu’à la Wallonie et Bruxelles, du fait du rôle majeur de l’ULB et de la VUB dans la lutte, la loi serait passée vingt ans plus tôt. Le parti chrétien flamand était très puissant et s’y est toujours opposé, la loi n’est passée que dix-sept ans après l’incarcération de Willy Peers à cause du positionnement idéologique de ce parti sur ce sujet», assène Anne Verougstraete, gynécologue, membre fondatrice de Dilemma, le centre d’avortement relié à la VUB et formatrice pour les futurs médecins.
Une application différente
Aujourd’hui, malgré la dépénalisation partielle, l’application de la loi a pris des formes différentes selon les régions. La Flandre a conservé des cliniques spécialisées dans l’avortement héritées des années de répression et c’est l’influence du modèle néerlandais de Stimezo qui a participé à cette spécialisation. C’est-à-dire un réseau de médecins qui accueillent les femmes et les redirigent vers un centre d’avortement, les abortuscentra. Ce sont des cliniques aseptisées, où l’efficacité budgétaire et la médicalisation prédominent. Carine Vrancken, présidente de l’asbl Luna, qui fédère les abortuscentra flamands, explique: «Notre business model, ce sont les avortements, c’est notre unique source de revenus.» Les abortuscentra sont donc uniquement dépendants des revenus remboursés par l’Inami.
En Wallonie et à Bruxelles, l’avortement s’inscrit dans un cadre plus large de santé reproductive, fidèle à la tradition historique des centres de planning. Ces derniers, dès leur création en 1966 sous le nom de «centres de conseil conjugal», ont progressivement élargi leurs missions pour inclure diverses consultations, telles que psychologiques, juridiques, sociales, médicales et gynécologiques, ainsi que des animations liées à la vie relationnelle, affective et sexuelle. C’est en 1997 que les centres de planning familial ont été officiellement subventionnés et reconnus en Wallonie et à Bruxelles, marquant une étape importante dans la professionnalisation du secteur. Le décret qui leur est consacré, qui introduisait les subsides pour ces centres, a permis de structurer et d’organiser les centres. Depuis lors, ils bénéficient d’une reconnaissance et d’un cadre législatif qui ont favorisé leur développement et leur professionnalisation.
En Wallonie et à Bruxelles, l’avortement s’inscrit dans un cadre plus large de santé reproductive, fidèle à la tradition historique des centres de planning. Ces derniers, dès leur création en 1966 sous le nom de «centres de conseil conjugal», ont progressivement élargi leurs missions pour inclure diverses consultations, telles que psychologiques, juridiques, sociales, médicales et gynécologiques, ainsi que des animations liées à la vie relationnelle, affective et sexuelle.
Dans les centres de planning familial, une grande importance est accordée à l’aspect social et humain des consultations, souvent au détriment de la rentabilité économique. Par exemple, pour les consultations médicales, notamment celles liées à de la petite gynécologie, le temps consacré à chaque patiente est plus long que dans d’autres structures, atteignant parfois 30 minutes, au lieu des 10 minutes habituelles. Les centres de planning familial suivent la stratégie consistant à inclure la prise en charge de l’avortement dans leurs autres missions de prévention, de santé reproductive et de conseil en lien avec la vie affective en général. C’est dans ces mêmes plannings que, plus tard, les pilules contraceptives ont été distribuées en premier lieu. Cet ensemble se matérialise dans la continuité de l’histoire des centres de planning familial, où la prise en compte de l’aspect social se situe au cœur du projet. «Parce qu’il y a un vrai bénéfice pour la personne qui vient consulter, on ne parle plus de secteur non marchand pour parler de notre activité, mais d’un secteur d’entreprise à profit social», résume ainsi Cécile Artus.
Malgré les différences de ces structures, d’un côté comme de l’autre de la frontière linguistique, les énergies convergent désormais vers un seul et même objectif: permettre aux femmes d’avorter aussi rapidement que possible.
Encadré: «Un accès à l’information disparate»
L’accès à l’IVG dépend aussi de la disponibilité des informations, particulièrement en ligne, où des disparités existent également entre la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. En Flandre, le site abortus.be, géré par l’asbl Luna, centralise des informations fiables et actualisées, redirigeant les utilisateurs vers des sources officielles, à l’abri des sites anti-avortement. En Wallonie et à Bruxelles, l’accès est plus complexe, avec des ressources dispersées et parfois ambiguës. Les informations peuvent être biaisées, nécessitant une vigilance accrue pour éviter les sites anti-avortement. En 2023, un projet de site d’information fédéral centralisé1– pouvant pallier cette situation – a vu le jour, après la publication d’un rapport d’expert2 sur l’évolution de la législation concernant l’avortement en Belgique. Cependant, son ergonomie reste perfectible. La rubrique dédiée à l’IVG se trouve dans la catégorie «début et fin de vie», mêlée à d’autres sujets comme le don d’organe et l’euthanasie, rendant l’accès difficile.
- https://www.health.belgium.be/fr/sante/prenez-soin-de-vous/debut-et-fin-de-vie/interruption-volontaire-de-grossess
- En avril 2023, sept experts de sept universités du pays ont présenté sur demande de la majorité gouvernementale un rapport intitulé : « Étude et évaluation de la loi et de la pratique de l’avortement en Belgique ».