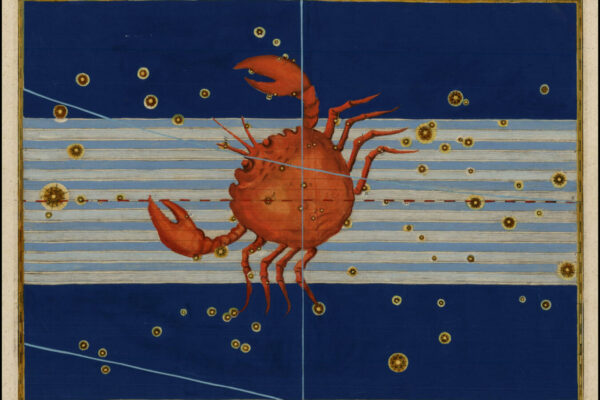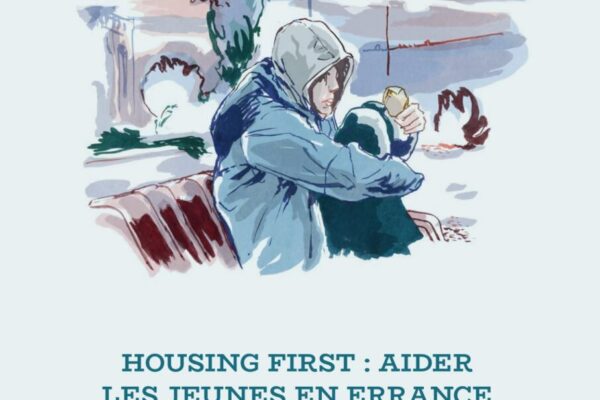Grèves, manifestations… Depuis 2007, le personnel des Institutions publiques de protection de la jeunesse (IPPJ) ne cesse de dénoncer le manque de personnel et de moyens mis à leur disposition pour prendre en charge les jeunes souffrant d’un trouble ou d’un handicap mental. Le secteur a été entendu par le cabinet de l’Aide à la jeunesse: à partir de janvier 2019, les IPPJ n’accueilleront plus ces jeunes.
Depuis une vingtaine d’années, les Institutions publiques de protection de la jeunesse (IPPJ) attendaient que les pouvoirs publics prennent au sérieux leur difficulté quant à la prise en charge de mineurs ayant commis des faits qualifiés infractions et souffrant d’un trouble ou de handicap mental. Considérées comme des institutions de type «éducatif» ayant pour mission d’offrir et de développer des outils permettant la «resocialisation, la recitoyenneté aux mineurs» qui leur sont confiés, les IPPJ ne se disent pas adaptées à ces jeunes.
Afin de répondre aux demandes du secteur, le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a voté le 17 janvier 2018 la modification de l’article 122 dans le cadre du nouveau Code de l’aide à la jeunesse. Ce dernier prévoit désormais qu’un «jeune ne peut être confié à une institution publique (IPPJ) s’il souffre d’un handicap mental ou d’un trouble mental établi par un rapport médical circonstancié».
Le Code de l’aide à la jeunesse distingue trois types de jeunes: le mineur en danger, le mineur ayant commis des faits qualifiés infractions et le mineur souffrant de troubles psychologiques et/ou d’un handicap mental. Or, les frontières ne sont pas étanches. Un mineur «en danger», fragilisé, peut être amené à commettre des infractions, tout en souffrant de troubles psychologiques. Celui-ci se retrouve donc à circuler entre différentes institutions existantes du secteur de l’Aide à la jeunesse et de la santé avec, éventuellement, des passages en IPPJ dits «time out», à la suite desquels le jeune est censé réintégrer son institution d’origine.
«L’idée d’un ‘time out’, on n’est pas contre évidemment. mais il faudrait qu’il y ait une sorte de contrat garantissant la reprise du jeune.», Dominique Hélin, directrice de l’IPPJ de Fraipont
Le «time out» apparaît comme un élément crucial pour les structures d’accueil hospitalières ou résidentielles. Il permet aux équipes et au jeune de prendre du recul. Il serait également l’occasion de confronter le jeune à ses actes. C’est l’avis de Sabrina Pedulla, responsable des paramédicaux à l’unité hospitalière d’AREA+: «Quand un jeune multiplie les comportements transgressifs, il nous arrive de demander au magistrat qu’il y ait un arrêt en IPPJ durant 15 jours. Cela offre un temps pour souffler, pour penser. Je trouve que l’article 122 ne va plus rendre possible ce temps pour penser.»
De leur côté, les IPPJ disent parfois accueillir des jeunes pendant plusieurs mois, voire plusieurs années sans plus aucun motif de fait qualifié «infraction» effectif. Deux cas de figure peuvent se présenter: un jeune placé en IPPJ pour des FQI nécessitant une réorientation afin de bénéficier de soins adaptés; un jeune bénéficiant déjà de soins redirigé temporairement vers l’IPPJ. Dans les deux cas, il s’avère extrêmement complexe de réorienter le jeune, une fois le placement arrivé à terme, regrettent les IPPJ. Que ce soit par manque de place, à cause d’un refus d’admission ou de la procédure d’exclusion. «Un jeune arrive chez nous parce qu’il a posé des actes destructeurs et puis il reste… On le garde et il n’y a plus de réorientation possible. L’idée d’un time out, on n’est pas contre évidemment. mais il faudrait qu’il y ait une sorte de contrat garantissant la reprise du jeune», explique Dominique Hélin, directrice de l’IPPJ de Fraipont.
La fin de l’inconditionnalité des IPPJ
La problématique n’est pas neuve. Dès les années 1990, on songe à créer des structures spécifiques pour ces jeunes à la frontière entre l’Aide à la jeunesse et la Santé. En 2002, le ministre des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke, permet la mise sur pied d’une première unité pilote, Karibu, à l’hôpital Jean Titeca en 2003, suivi par d’autres en Flandre en 2004-2005. C’est l’apparition des «lits for K», devenus UTI (unités de traitement intensif). «Ces unités peuvent accueillir tous les publics pour peu qu’il y ait un mandat, une contrainte au soin», explique Etienne Joiret, psychologue et chef de service adjoint de l’unité Karibu à Titeca. La prise en charge est de six mois, renouvelables une fois. Suite à la grève de 2007, d’autres unités sont ouvertes en 2008. Au total pour Bruxelles et la Wallonie, 68 lits sont mis à disposition.
Si ce projet était porteur de beaucoup d’espérance, il n’est pas parvenu à apaiser les équipes des IPPJ, qui ont le sentiment de demeurer les «réceptacles de toutes les difficultés que présentent ces jeunes en Communauté française», explique le directeur de l’IPPJ de Wauthier-Braine, Didier Delbart. Car jusqu’ici, contrairement au milieu hospitalier ou résidentiel, les IPPJ ne pouvaient refuser un jeune placé par le tribunal de la jeunesse. «Les anciens textes empêchaient les directeurs de pouvoir refuser un jeune, sauf au motif évident d’absence de place. Avec la sortie de ce décret, on est allé un pas plus loin, en rappelant aux autres instances de la santé mentale et du handicap qu’elles doivent également jouer leur rôle.»
Diagnostic à l’appui
Si les IPPJ accueillent positivement la modification du cabinet Madrane, côté santé mentale et acteurs judiciaires, le son de cloche est différent. Ces derniers déplorent le fait de ne pas avoir été consultés et se sentent pris en otage. En octobre 2017, ils demandaient à être entendus par le cabinet. Ils n’ont été reçus que le 19 janvier 2018. Deux jours après la promulgation du Code…
Pour eux, la modification de l’article 122 est une porte qui se ferme, un outil en moins pour ces jeunes. C’est l’avis de Marc-Antoine Poncelet, substitut au parquet du procureur du Roi de Namur et membre de la commission d’avis d’enquête du Conseil supérieur de la justice: «Nous n’avons pas toujours d’autres solutions que l’IPPJ. Cette mesure exclut une possibilité, ce qui enlève de la latitude au juge pour trouver la moins mauvaise solution.» Bricoleurs, les juges de la jeunesse sont à la recherche constante de places disponibles, «obligés de se rabattre sur des plans B». Même s’il s’agit de cas relativement peu fréquents – selon le cabinet Madrane, 15 à 20 jeunes seraient concernés par an –, leur prise en charge s’avère lourde et complexe.
«Il n’y a pas une personne qui échappe à un diagnostic potentiellement psychiatrique.», Sophie Maes, Domaine de Braine-l’Alleud
Autre question posée par la mesure: celle du diagnostic. Sur quoi s’appuiera le certificat médical circonstancié? Qui sera à même de l’établir? Comment trancher les avis contradictoires?
Seul un médecin habilité par le juge pourrait être entendu sur la question, selon Alberto Mulas, directeur adjoint du Cabinet Madrane. En outre, tout jeune déjà inscrit dans une institution hospitalière ou résidentielle se verra automatiquement exclu d’une possibilité de passage en IPPJ, «sauf exception». «Pour un jeune déjà dans un SRJ (Service résidentiel pour jeunes handicapés) ou placé lit K (ouvert à tous) ou lit for K (UTI), tout est déjà établi. Il a déjà un passé médical. Donc, s’il passe à l’acte sur l’un des travailleurs, cela fait partie de sa pathologie». Une disposition qui suscite le débat: pourquoi un trouble/handicap mental devrait-il exclure tout autre type de prise en charge que celle de la santé mentale? «Une pathologie mentale n’est que temporaire, souligne aussi Sophie Maes, pédopsychiatre et responsable de l’Unité des adolescents du Domaine de Braine-l’Alleud. On dirait que dès qu’un certificat a été fait, cela marque le jeune au fer rouge. Ce qui est extrêmement stigmatisant. Dire que ces jeunes n’auront plus accès à l’IPPJ tend à faire croire que parce qu’un jeune souffre d’une problématique affective et relationnelle, il n’est plus responsable de ses actes. Les deux approches sont pourtant nécessaires».
De plus, d’un point de vue strictement légal, seul le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM IV) est reconnu comme source de référence par l’État belge. Toujours selon Sophie Maes, ce manuel comprend tout comportement qui pose problème à la société au même titre qu’une pathologie avérée telle que le trouble bipolaire, une schizophrénie ou une dépression grave. «Dès lors, qui a encore sa place en IPPJ? Il n’y a pas une personne qui échappe à un diagnostic potentiellement psychiatrique.»
Entre De Block et Madrane
Perçu par le cabinet de la ministre de la Santé, Maggie De Block, comme une mesure unilatérale et singulière, l’article 122 n’irait pas dans le sens de la réforme de la santé mentale 0-18 ans entamée depuis 2015. Celle-ci encourage la prise en charge ambulatoire et le travail en réseaux. Élaborée par le gouvernement fédéral, la Communauté française a été associée aux travaux dans le cadre de la Conférence interministérielle Santé publique (CIM) en 2015.
Après avoir cherché à savoir si une telle mesure pouvait être prise par un seul des secteurs concernés alors qu’elle impacte le travail de huit autres ministres, le cabinet De Block a constaté qu’elle relève bel et bien des compétences de l’Aide à la jeunesse. Ni consulté ni informé, le cabinet s’est aussi interrogé quant à la constitutionnalité de l’article 122 pour son caractère discriminant. «Un patient pourrait dire qu’il n’a pas seulement un trouble mental mais qu’il a aussi un problème qui relève de la ‘délinquance’», explique Harmen Lecok, conseiller au cabinet.
«Il y a une forme de pression qui est mise sur le secteur du handicap et de la psychiatrie à travers cette mesure.», Etienne Joiret, centre hospitalier Jean Titeca
De son côté, le cabinet Madrane ne considère pas que ces jeunes relèvent de l’Aide à la jeunesse. Il souhaite mettre le problème sur la table, en invitant à la réflexion et à la création d’une solution associant soins et sanction. Ce qui fait écho au modèle d’internement tel qu’il existe pour les majeurs (défense sociale). «J’ai bien compris qu’il y a une forme de pression qui est mise sur le secteur du handicap et de la psychiatrie à travers cette mesure. Mais il faut réfléchir quant à savoir si c’est vraiment dans l’intérêt du jeune», souligne Etienne Joiret, qui n’entend pas faire du «lit for K» de l’internement déguisé.
Pris en étau entre la politique du cabinet De Block qui encourage le travail en ambulatoire et la politique sectorielle du cabinet Madrane faisant une scission entre «délinquance» et «santé mentale», les acteurs de terrain peinent à s’y retrouver. Dans ce contexte, le risque est que cet article 122 ne devienne une «usine à incasables». Il pourrait rendre les hôpitaux plus «frileux», n’ayant plus de relais auxquels se raccrocher et des équipes à ménager, et contribuer à une augmentation des dessaisissements et une surmédication des jeunes. Pour le magistrat Marc-Antoine Poncelet, «c’est toujours la même chose. On met l’autre communauté ou l’autre institution au pied du mur. On va se renvoyer la balle et il n’y aura rien. Je suis certain que dans un an il n’y aura pas une seule institution qui répondra à ça».
En savoir plus
Alter Echos (web), «Une réforme santé mentale pour les 0-18 ans», Marinette Mormont, 30 mars 2015