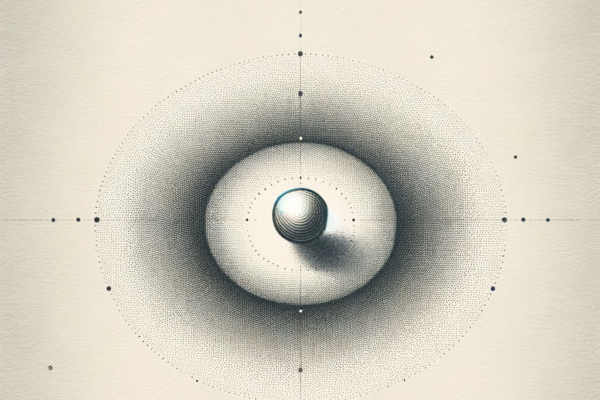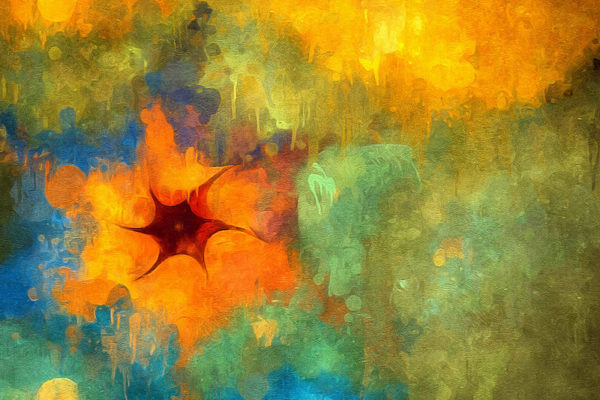Deux journalistes spécialisés nous livrent leurs réflexions sur la place du social dans les médias, son rôle, ses limites… Et laissent entrevoir du changement ces dernières années, résultat de crises et de l’expansion des inégalités, mais aussi de la modification en profondeur des univers médiatique et associatif.
Jérôme Durant:
Journaliste radio à la rédaction bruxelloise de la RTBF depuis 13 ans, il suit régulièrement l’actualité sociale et a réalisé plusieurs longs formats consacrés à des problématiques sociales parmi lesquels «Les nouveaux pauvres», «Les naufragés du Covid» et «Salauds de pauvres: une vie de mendiant à Bruxelles».
Martine Vandemeulebroucke:
Journaliste au Soir dès 1980, spécialiste des questions d’asile et immigration, de pauvreté et de politique belge, elle quitte le quotidien en 2013 pour se consacrer au journalisme social en tant qu’indépendante. Elle écrit depuis régulièrement pour Alter Échos et se consacre également à la défense des journalistes exilés au travers de l’asbl «En-GAJE» dont elle est cofondatrice.
Le social, parent pauvre du journalisme
Pas assez vendeur, pas assez «sexy»? La disgrâce du social dans les rédactions ne date pas d’hier. Tout comme les populations précaires dont elle parle, l’information sociale part souvent avec un désavantage.
Martine Vandemeulebroucke: La place marginale du social dans les médias a selon moi toujours existé. Au début des années 80, le social n’était même pas un sujet. Au Soir, on suivait les interlocuteurs sociaux, mais tout le reste, tout ce qui touchait à la pauvreté, à l’associatif, à la toxicomanie ou que sais-je encore, bref le social au sens large n’a jamais intéressé personne. Sauf quand il y avait une actualité particulière, qui pouvait faire l’objet d’un reportage ou d’un micro-trottoir.
De mon expérience dans la presse écrite, et au Soir plus précisément, j’ai toujours dû batailler pour faire exister ces sujets.
Jérôme Durant: En 2000, je suis étudiant à l’Ihecs et on a un cours intitulé «Les oubliés de l’information sociale». Ce constat était donc déjà fait à l’époque par des profs qui étaient eux-mêmes d’anciens journalistes. J’ai également toujours eu ce sentiment qu’il fallait redoubler d’efforts avec les sujets sociaux, qu’ils partaient avec un désavantage par rapport aux autres sujets.
MV: L’une des raisons à cela est je crois liée à l’origine sociale des journalistes, qui sont majoritairement des diplômés universitaires issus de la classe sociale supérieure. Ils n’ont pas cette expérience ressentie du terrain qui donne envie d’en parler ou de mieux comprendre ce qui s’y passe.
Et puis, il y a le profil de ceux qui consomment les médias. Je me souviens d’un papier d’analyse que j’avais écrit pour tenter d’évaluer l’efficacité des politiques de lutte contre la pauvreté, au niveau tant fédéral que régional. La rédactrice en chef de l’époque lève les yeux au ciel et me dit: «Mais Martine, ce n’est pas notre lectorat!» Les responsables de rédaction se font l’idée que l’information sociale n’est pas sexy, qu’elle ne correspond pas aux attentes de leurs lecteurs.
JD: Ce sont des sujets qui, si on les traite, vont nécessiter de trouver un angle qui peut intéresser le plus large public. Car on part du principe que la plupart des gens qui nous regardent et nous écoutent ne sont pas les plus défavorisés. Même s’il y a eu des inflexions ces dernières années…
Tous concernés?
Les crises – économique de 2008, du Covid depuis 2020 – ont propulsé les inégalités sur le devant de la scène. En rebattant les cartes de la précarité, elles ont rendu le sujet beaucoup plus «grand public», quasi incontournable.
JD: La crise économique de 2008 et le Covid apparaissent selon moi comme deux moments importants. De ce que j’observe à la RTBF, il y a depuis quelques années une ouverture plus grande aux sujets sociaux. D’une part, plus d’attention: aujourd’hui, en réunion de rédaction, on va avoir conscience du fait que tel ou tel phénomène (par exemple, le télétravail) sera vécu différemment pour les personnes plus précaires. D’autre part, plus de nuance aussi dans le type de traitement: on va essayer de minimiser les discours misérabilistes. Il y a quelques années, il nous arrivait encore en décembre de faire un sujet sur les sans-abri, sans plus de réflexion. Maintenant, on essaie de trouver de vrais angles d’attaque.
MV: C’est exact, je ressens aussi cette attention-là. Par exemple, au sujet des inondations de l’été dernier en Wallonie, on sait que ce sont les plus précarisés qui ont le plus encaissé et je suis vraiment agréablement surprise de voir que le service public ne les a pas abandonnés six mois plus tard. Je perçois cette attention aux exclus de façon plus récurrente – davantage à la RTBF que dans la presse écrite généraliste d’ailleurs.
JD: D’un autre côté, il y a une sorte de «fascination» pour les nouveaux phénomènes. J’ai réalisé quelques longs formats, notamment sur la dépénalisation de la mendicité, les nouvelles formes de précarité et les personnes que le Covid a soudainement fait basculer dans la pauvreté; et ça, typiquement, ça marche super bien. Ça parle à beaucoup de monde, parce que ça correspond davantage au public de la RTBF. Mais cela crée aussi d’énormes tensions avec le secteur social, qui estime qu’en se concentrant sur les nouveaux pauvres on se désintéresse complètement des anciens.
C’est vrai que les médias vont avoir tendance à être très attirés par des concepts forts et accrocheurs, comme les «nouveaux pauvres», le «Housing First» ou encore le «Community Land Trust». Par contre, il sera beaucoup plus compliqué, au sein d’une rédaction, de faire comprendre l’enjeu d’un sujet comme la problématique du non-recours aux droits sociaux, qui est un sujet pourtant très important.
«Produire avant tout»
Le journalisme a changé. Plus de polyvalence et plus de bureau d’un côté, moins de temps et moins de terrain de l’autre. L’impact sur le traitement des problématiques sociales est notable, elles qui nécessitent, spécialement, du temps et du terrain.
MV: Le problème, ce n’est pas seulement la place allouée aux sujets sociaux c’est aussi la manière d’en rendre compte. C’est quelque chose qui m’a toujours frappé au Soir: Si j’arrivais avec des reportages en temps de crise – le marronnier par excellence, c’est les sans-abri en hiver – alors ça passait. Mais parler du phénomène du sans-abrisme de manière plus large et structurelle, c’était inenvisageable.
Une anecdote, très révélatrice: il y a eu en 2009-2010 une grosse crise de l’accueil des demandeurs d’asile. À la suite de ça, le Samusocial et le ministère de l’Intégration sociale avaient organisé une conférence de presse pour expliquer le dispositif qu’ils allaient mettre en œuvre pour solutionner les problèmes d’hébergement d’urgence des sans-abri et des demandeurs d’asile. Alors que j’étais en chemin, je reçois un appel de la rédaction: «Martine, n’y va pas, ça ne nous intéresse pas. Tu feras un reportage en décembre.»
JD: Quand il y a des conflits sociaux, il y a toujours cette opposition au sein des médias audiovisuels (et, dans une certaine mesure, écrits), entre deux angles: l’angle «perturbations pour l’usager» et l’angle «enjeu du conflit social». Typiquement, cela crée souvent de grosses tensions au sein des rédactions des médias.
MV: La question du temps est aussi cruciale. Aujourd’hui, il faut produire avant tout. Et produire ça se fait par coups de téléphone, pas en allant sur le terrain, qui est considéré comme une perte de temps. Ce manque de temps me causait un vrai désespoir à la fin de ma carrière au Soir. J’avais un à deux articles à produire par jour et je n’avais donc le temps que pour des coups de téléphone à des associations, etc., plus pour rencontrer des gens. En étant free-lance et en travaillant pour la presse indépendante, j’ai retrouvé le plaisir de travailler; celui d’aller à la rencontre des gens et de renouer avec les bases du métier.
JD: Il y a clairement une facilité à traiter les sujets sociaux via des formats plus longs. On peut vraiment angler et décrypter en profondeur une problématique. Forcément, on touche moins d’auditeurs avec une émission le samedi à 13 heures, mais il y a une vraie demande, au niveau tant de la RTBF que du public. Dans les journaux, a fortiori à la radio, c’est plus compliqué, car on a moins de temps. Demain par exemple, je vais parler du projet de l’Îlot de créer un centre d’hébergement pour femmes sans abri, mais je n’aurai qu’une minute vingt pour le faire…
Méfiance associative
Le journalisme social et le monde associatif ont des liens étroits. Les deux mondes s’observent sans toujours bien se comprendre, entre défiance et intérêt mutuel.
MV: Étonnamment, c’est dans le secteur associatif que je vois la plus grande obsession de contrôle de ce qui est écrit (ce que je ne voyais pas auparavant). On me demande aujourd’hui très régulièrement de relire mon article avant publication. Il y a une vraie crispation, une méfiance et une volonté de contrôle de la part des associations. C’est sans doute la conséquence du discours anti-média qui percole dans toute la société, et qui atteint le milieu associatif.
Mais ça peut aussi s’expliquer par le manque de connaissances de certains journalistes. Quand les médias n’ont pas un ou une journaliste qui suit cette matière de façon régulière – je pense au social, mais aussi à l’immigration par exemple –, il ne leur est pas possible de comprendre précisément comment fonctionnent les institutions, d’en connaître le jargon, le contexte… On a aujourd’hui de plus en plus de journalistes touche-à-tout, ce qui peut expliquer le mépris du secteur associatif.
JD: Par ailleurs, j’observe que le secteur associatif se professionnalise et professionnalise sa communication. Il y a quelques années, je n’ai pas le souvenir d’appeler une association d’aide aux sans-abri et d’être en lien avec deux attachés de presse au téléphone. Les associations sont parfois devenues des machines de communication. C’est souvent une bonne chose, parce qu’à nous, ça nous facilite le boulot et à elles, ça leur permet de mieux se faire entendre. Mais d’un autre côté, certaines associations se voient aujourd’hui reprocher par le reste du secteur d’être trop dans la «com».
Journalistes privilégiés, mais engagés
Le journalisme, même social et y compris au sein de la rédaction d’Alter Échos, reste incarné par des personnes éloignées des classes populaires, plus précaires. Comment mieux rendre compte de réalités dont on n’est pas issu?
MV: Je pense qu’il y a dans les rédactions une incompréhension totale du ressenti de ceux qui sont exclus. Comme je le disais, c’est parce qu’il y a très peu de journalistes qui sont issus de ce milieu. Il se trouve que c’est mon cas; je proviens d’un milieu social très défavorisé. Et je me souviens n’avoir jamais été capable d’expliquer à ma rédaction cette difficulté qu’ont les pauvres à parler de leur expérience, de leur ressenti. C’est un autre obstacle pour arriver à rendre compte de leurs réalités… Je me demande aussi si la place du social dans les médias n’est pas intimement liée à la sensibilité, voire à l’engagement du journaliste; c’est ce qui détermine que l’information sociale «remonte» et qu’on décide ou non de la traiter.
JD: Je le pense aussi. Tous mes collègues journalistes qui font de l’information sociale sont des personnes qui viennent d’une famille certes éduquée et qui a les moyens, mais aussi dont l’un des parents travaille dans le social… Il y a clairement une question de sensibilité personnelle.
À la RTBF, il y a une volonté très claire de diversité depuis trois ou quatre ans, aussi bien dans les contenus que dans le profil des journalistes. On essaie de sortir des circuits traditionnels et de cette logique d’aller chercher des jeunes tout juste sortis des écoles de journalisme. Et je pense que c’est par cette diversité des journalistes, qui apportent d’autres regards, qu’on pourra avoir davantage de transversalité de ces problématiques (qu’il s’agisse du social, du genre, du racisme, etc.).
En savoir plus
«Médias et non-marchand: je t’aime, moi non plus», Alter Échos n° 414-415, Céline Gautier.
«Journalisme et citoyens: entre défiance et participation», Alter Échos n° 444, mai 2017, Marinette Mormont.