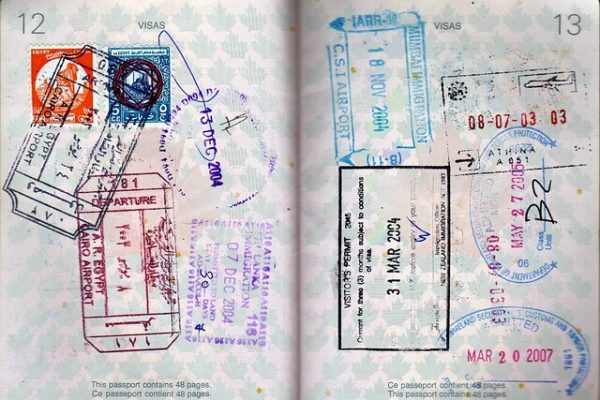Les données disponibles sur l’insertion socioprofessionnelle des personnes récemment immigrées en Belgique démontent quelques a priori et esquissent des trajectoires «longues et sinueuses».
Publiée en 2014 sous la direction d’Andrea Rea (ULB, GERME) et de Johan Wets (KULeuven, HIVA), l’étude «Careers»[1], lancée par le Centre fédéral Migration et le SPP Politique scientifique, a suivi de manière longitudinale la trajectoire de quelque 100.000 demandeurs d’asile et réfugiés entre 2001 et 2010 grâce à un couplage d’informations du Registre national et de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale. La recherche ne porte donc pas sur un échantillon représentatif mais sur l’ensemble des personnes ayant demandé l’asile en Belgique durant cette période et toujours présentes sur le territoire en 2010. L’étude constate que, comme dans les autres pays européens, l’intégration de cette population sur le marché du travail tend à être inférieure à celle des citoyens natifs: ce désavantage est même légèrement plus marqué en Belgique que dans le reste de l’OCDE. Pour autant, l’intégration socioprofessionnelle est réelle. «L’image que l’on peut en dépeindre est celle d’une dynamique d’intégration lente, mais progressive», résume l’étude. Le facteur «temps» est en effet déterminant: plus une personne est présente depuis longtemps sur le territoire, plus ses chances de s’intégrer sur le marché de l’emploi sont grandes. Après un an, les demandeurs d’asile arrivés en 2002 affichent ainsi un taux d’emploi de 0,6% tandis qu’en 2010, ce taux passe à 37%. L’étude montre par ailleurs que le fait d’avoir travaillé pendant la procédure d’asile a un impact positif sur le reste de la carrière[2]. Pour ceux qui ont obtenu le statut de réfugié, les chercheurs remarquent que le taux d’emploi reste fortement corrélé au nombre d’années passées en Belgique. La proportion de réfugiés actifs sur le marché du travail (salariés, indépendants et chômeurs indemnisés) passe de 19% au moment de la reconnaissance du statut à 55% après quatre ans.
Vers des «white collar jobs»
Synonyme d’un apprentissage de la langue, de la mise en place de nouveaux liens sociaux, d’une meilleure connaissance de l’environnement et des possibilités offertes par cet environnement, le temps a une influence non seulement sur le taux d’emploi mais aussi sur le type d’emploi. En 2001, 6% des emplois occupés par les personnes ayant demandé l’asile entre 2001 et 2010 entrent dans la catégorie «white collar jobs» («cols blancs» – statut d’employé); 94% sont des «blue collar jobs» («cols bleus» – statut d’ouvrier). Neuf ans plus tard, en 2010, la proportion de «white collar jobs» est passée à 21%. Le rapport met par ailleurs en avant des différences nettes suivant le sexe et la situation familiale. Les femmes seules avec enfants (une femme sur quatre parmi les femmes demandeuses d’asile et réfugiées) dépendent davantage des allocations d’aide sociale que les autres groupes. «Careers» pointe par ailleurs des différences selon la région d’origine: les personnes provenant d’Afrique subsaharienne et d’Asie ont en moyenne deux fois plus de probabilités de trouver un emploi que celles issues d’Europe centrale et de l’Est, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. La connaissance du français – ou à tout le moins de l’anglais – de nombreux Africains pourrait expliquer en partie cette meilleure insertion, de même que la présence de longue date d’une communauté africaine en Belgique, le réseau social s’avérant souvent bénéfique dans la recherche d’un emploi.
Seuls 2% des primoarrivants sont par ailleurs bénéficiaires d’allocations de chômage et 7% d’une aide octroyée par un CPAS
L’étude suggère aussi que, de manière générale, les personnes qui ont le plus de probabilité de trouver un emploi viennent paradoxalement des pays les plus pauvres. Un constat pourrait s’expliquer par le fait qu’elles seraient moins qualifiées et qu’elles accepteraient donc plus facilement les métiers de type 3Ds («Dirty, Dangerous and Demeaning», autrement dit «sale, dangereux et dévalorisant») vers lesquels sont généralement orientés les demandeurs d’asile. Les demandeurs d’asile les plus qualifiés se lanceraient, eux, plus fréquemment dans des formations, ce qui pourrait ralentir leur mise à l’emploi d’un point de vue statistique mais non pas leur intégration socioprofessionnelle à long terme. Enfin, «Careers» relève que la probabilité d’emploi est deux fois plus grande en Flandre qu’en Wallonie. Les chercheurs supposent que cette différence pourrait être liée à la meilleure santé économique de la Flandre. Peut-être aussi, avancent-ils à titre d’hypothèse, grâce au parcours de citoyenneté obligatoire mis en place par la communauté flamande à destination des primoarrivants depuis plus de 10 ans.
Les primoarrivants à Bruxelles
Dans «État des lieux de la situation des primoarrivants en région de Bruxelles-Capitale» (2012)[3], une étude réalisée à la demande de Charles Picqué (PS), alors ministre Cocof en charge de la cohésion sociale, des chercheurs du CBAI (Centre bruxellois d’action interculturelle) et de l’UCL ont quant à eux analysé la situation des primoarrivants (définis comme les migrants étrangers résidant depuis moins de trois ans en Belgique) dans la seule Région de Bruxelles-Capitale qui accueille plus du tiers d’entre eux. Elle montre que, pour ces personnes, le taux d’inactivité s’élève, après un an, à 61%, soit quelque trois fois plus que dans le reste de la population. Mais là encore, la photographie se modifie sensiblement au fil du temps: le taux d’inactifs baisse à 47% pour les primoarrivants arrivés depuis trois ans. Seuls 2% des primoarrivants sont par ailleurs bénéficiaires d’allocations de chômage et 7% d’une aide octroyée par un CPAS (revenu d’intégration sociale ou aide financière).
Les emplois obtenus vont de l’automobile à l’Horeca, en passant par les télécommunications et le secteur des «activités de service administratif et de soutien», en ce compris le nettoyage, avec des filières d’accès à l’emploi qui semblent spécifiques aux différents groupes nationaux. Le taux d’emploi serait de manière générale presque deux fois supérieur chez les ressortissants des pays de l’UE12 (52%). Pour autant, il ne s’agirait pas de deux mondes séparés. «Si leur insertion sur le marché de l’emploi semble à première vue meilleure en comparaison avec d’autres groupes (taux d’emploi élevé, faible part de bénéficiaires d’aides sociales, faible taux d’inactivité́), elle ne doit pas masquer le fait qu’ils résident dans des quartiers a priori peu aisés. Le fait de disposer d’un emploi ne leur garantit manifestement pas des revenus suffisants pour se démarquer d’autres groupes de migrants précarisés», estime le rapport qui rappelle que, pour la période étudiée, 33% des primoarrivants sont issus de l’UE15 et près de 25% de l’UE12.
[1] Les résultats de cette étude ont été́ publiés dans: Rea A. et Wets J. (ed.), «The long and Winding Road to Employment. An Analysis of the Labour Market Careers of Asylum Seekers and Refugees in Belgium», Academia Press, Gand, 2014. L’étude et son résumé sont disponibles sur www.myria.be
[2] Aujourd’hui, les demandeurs d’asile peuvent travailler avec un permis de travail C quatre mois après avoir introduit leur demande. Sur la période étudiée par le projet Careers (2001-2010), la législation sur cette question a changé plusieurs fois.
[3] http://www.cbai.be/resource/docsenstock/cohesion_sociale/Rapport_Etat_des_lieux.pdf
En savoir plus
«Réinstallation des réfugiés: les premiers pas d’un programme belge», Focales n°5, mai 2014, Cédric Vallet.