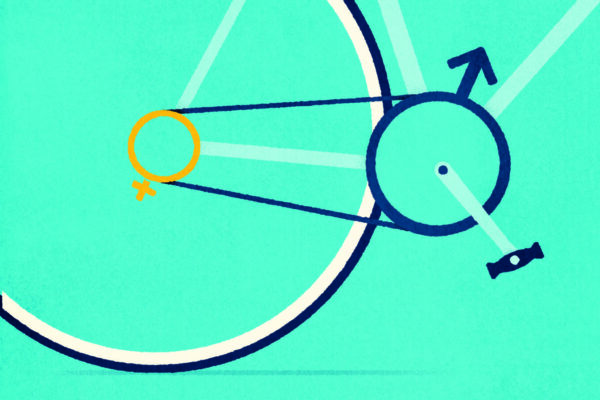En mars 2015, un incident a fait grand bruit en Flandre. Faute de place en institution, une jeune fille de 17 ans, qui avait été envoyée en pédopsychiatrie à la suite d’une décision d’un juge de la jeunesse, a passé la nuit dans un commissariat après que les psychiatres du réseau hospitalier d’Anvers ont refusé de poursuivre son traitement.
Le cas est emblématique de l’incompréhension qui règne entre pédopsychiatres et juges de la jeunesse, et celle-ci vient d’être mise en lumière par une thèse de doctorat dont les résultats ont été transmis à l’Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) de l’Université de Gand. «Les juges et les psychiatres ont des points de vue différents», confirme Leen Cappon, l’auteure de la thèse. «Dans ce genre de dossiers, on parle souvent de jeunes qui butent déjà sur les limites de l’aide ‘traditionnelle’ à la jeunesse. Si un juge de la jeunesse veut envoyer un jeune vers un service pédopsychiatrique, le jeune concerné doit passer par un processus d’admission. Au cours de celui-ci, on va vérifier s’il répond aux critères de sélection, comme le fait de présenter des symptômes de «problématique psychiatrique». En outre, on attend du mineur d’âge qu’il soit motivé à suivre un traitement et de ses parents qu’ils soient eux aussi prêts à s’impliquer dans le traitement. C’est seulement à ce moment-là que l’équipe d’admission va décider de la prise en charge du jeune. Si celle-ci n’a pas lieu et que, malgré l’urgence, les psychiatres campent sur leur position, les juges de la jeunesse doivent chercher une autre solution. En pratique, celle-ci sera le plus souvent un placement dans une institution communautaire, laquelle ne sera pas toujours équipée pour traiter ce genre de problème, ce qui pourra susciter des rancœurs en son sein.»
Un juge, interrogé dans le cadre de l’enquête gantoise, résume la situation: «Les pédopsychiatres raisonnent souvent comme ceci: nous sommes les médecins, nous traitons ce patient, donc c’est nous qui prenons les décisions. À quoi les juges de la jeunesse répondent: ‘Non, nous sommes les juges, nous sommes responsables de ce qui va arriver à ce jeune, donc c’est nous qui prenons les décisions.’ Et il y a un clash.»
Deux mondes étrangers
Selon Leen Cappon, le clash entre ces deux mondes survient au moins en partie parce qu’ils se connaissent mal et ne se comprennent pas assez. «C’est souvent le mineur qui est la victime involontaire de cette situation», ajoute-t-elle. La solution, pour elle, serait la mise sur pied d’une formation commune aux juges et aux psychiatres. Il ressort de l’enquête que les deux groupes sont bien conscients de la nécessité d’améliorer les choses. «Beaucoup de choses ne se font pas parce que nous n’arrivons pas à nous organiser et non pas du fait du jeune concerné», admet un pédopsychiatre.
«Souvent, les jeunes sont prêts à se faire aider mais le juge de la jeunesse, le pédopsychiatre et les services d’aide à la jeunesse n’arrivent pas à se mettre d’accord sur la forme à donner à cette aide», confirme Leen Cappon. «Ce pédopsychiatre [celui cité ci-dessus] plaide pour une culture de la négociation alors que, pour l’instant, les décisions sont plutôt le résultat d’un rapport de forces.»
La thèse de doctorat révèle encore d’autres problèmes. Ainsi, les juges de la jeunesse recourent le plus souvent à des formulations standards pour motiver leurs décisions. Des formulations spécifiquement liées au cas ne sont formulées que dans seulement 30% des cas. «Les juges n’ont pas toujours le temps de tout expliquer. Parfois, ils ne le font qu’oralement. À quoi s’ajoute aussi la frustration liée au manque de places disponibles», explique la doctorante.
Enfin, elle constate encore que le rôle des mineurs et de leurs parents est très réduit tout au long de la procédure. Les juges sont tenus de les écouter mais ils ne tiennent pas toujours compte de ce qu’ils entendent à ce moment-là.
D’après De Morgen et De Standaard