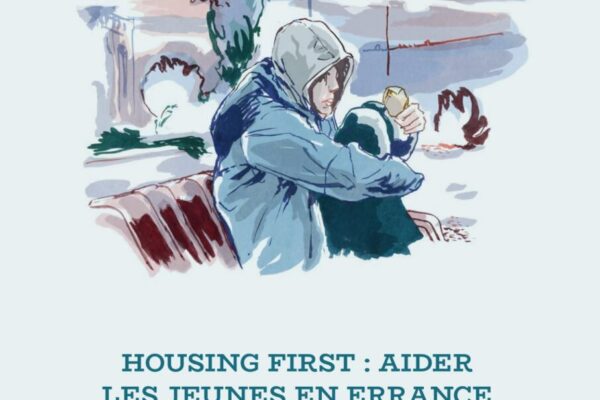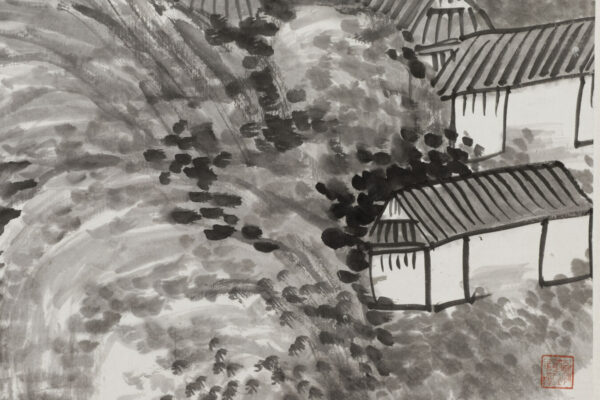Alter Échos: Sur quels fondements reposent la civilisation du cocon?
Vincent Cocquebert: La civilisation du cocon correspond à un mouvement initié à la fin des années 80 et qui ne cesse de s’intensifier depuis. Il s’agit d’une séquence historique où les individus ont abandonné la promesse de la modernité d’une vie intense et se retrouvent davantage dans une «quête de soi», de confort et de bien-être, mués par une dynamique de «tous aux abris». Je la date à partir des années 80, une décennie paroxysmique durant laquelle la promesse d’individualisation consistant à être le guide de sa vie, le grand ordonnateur de son existence tant sur le plan émotionnel, professionnel que familial, a trouvé ses limites chez une partie de la population, souvent les plus précaires, ceux qui avaient le capital culturel le moins fort. Parce que c’est une promesse compliquée à tenir pour l’ensemble de la société, qu’on ne part pas tous avec les mêmes chances et qu’on n’a pas tous les mêmes capacités d’invention, de réinvention, d’adaptation. Mais à la fin des années 80, de cette décennie consacrée à la gloire de la réussite individuelle et pécuniaire, on a vu les classes populaires se tourner vers un réinvestissement du foyer. C’est le début du développement du petit pavillon de banlieue, de la petite cabane au fond du jardin. C’est aussi à ce moment que s’amorce tout le marché du jardinage, de la décoration et qui prendra par la suite de l’ampleur.
AÉ: C’est donc l’ère du cocooning?
VC: Oui, terme d’ailleurs inventé en 1986 par la futurologue Faith Popcorn qui prédisait un retour massif de la société au foyer, se basant sur les chiffres de livraisons de pizzas. En réalité, les années 90 ne lui ont pas donné raison, parce que pour voir un film ou rencontrer des gens il fallait sortir de chez soi. Toute cette domiciliation du travail, des services, de la culture, du bien-être, de nos relations sociales n’était pas encore tout à fait possible. Ce n’est que dans les années 2010, grâce à l’assaut du numérique, à cette possibilité de faire venir entièrement le monde à nous et d’être les grands ordonnateurs de nos petits mondes, qu’on a vu cette pulsion de repli domestique se manifester et s’infuser chez les catégories moins populaires. C’est aujourd’hui un syndrome qui se manifeste à différents niveaux et qui touche à peu près tout le monde.
AÉ: Vous avez commencé votre livre avant le confinement. Qu’est-ce que cette expérience d’assignation à résidence forcée a révélé sur le phénomène que vous aviez commencé à observer?
VC: Cela a un peu servi de «stress test» géant. Le repli domestique que je percevais a pris d’autres formes, biologique, social, psychique. Lorsque tout d’un coup nous étions sommés de nous enfermer avec les nôtres, nos familles, nos communautés miroirs, ce qui est venu confirmer ce que je pressentais, c’est finalement l’aisance avec laquelle nous avons accepté cet enfermement, même si le moteur de la peur a bien évidemment joué. Les sondages par la suite ont révélé que les gens s’en accommodaient plutôt bien. On voyait alors fleurir un discours, du type, «c’est une pause civilisationnelle, ça fait du bien, je suis avec ma famille, je peux enfin me réapproprier le temps, je me rends compte de ce qui est important dans la vie, etc.» Mais le piège de la civilisation du cocon c’est que cette quête permanente de confort et de sécurité a aussi généré beaucoup d’anxiété et de dépression liées à une peur de l’extérieur. Durant cette période, la défiance interpersonnelle a beaucoup augmenté, la peur des étrangers aussi, alors que c’est probablement l’année où les gens en ont le moins vus. Le confinement a donc renforcé cette pulsion de repli autarcique et ce fantasme isolationniste tout en créant une vision complètement distordue de l’extérieur, de l’altérité. Et cela a rendu le monde encore plus menaçant et plus dur qu’il ne l’est en réalité.
«Le piège de la civilisation du cocon c’est que cette quête permanente de confort et de sécurité a aussi généré beaucoup d’anxiété et de dépression liées à une peur de l’extérieur. Durant cette période, la défiance interpersonnelle a beaucoup augmenté, la peur des étrangers aussi, alors que c’est probablement l’année où les gens en ont le moins vus.»
AÉ: Vous évoquez dans votre livre comment cette quête de confort se traduit par le succès du yoga, de la méditation, une obsession pour la vie saine, etc. La civilisation du cocon ne concerne-t-elle pas uniquement les bobos finalement?
VC: C’est pour cela j’ai essayé de restituer historiquement le début de ce mouvement dans les années 80. Parce que cette tendance au repli a d’abord touché les classes populaires, ce qu’on appelait avant les gens casaniers, les couch potatoes. Passer son temps dans le canapé est devenu socialement valorisant quand on a commencé à parler de Netflix and chill, quand le cocooning et son florilège de concepts marketing comme le hygge (mot d’origine danoise et norvégienne faisant référence à un sentiment de bien-être, une humeur joyeuse et une atmosphère intime et chaleureuse, NDLR) sont devenus une sorte de lifestyle. C’était d’un coup socialement plus acceptable de revenir un lundi matin après avoir passé un weekend à avoir rattrapé les deux saisons d’une série extrêmement pointue que tout le monde regarde, plutôt que de dire «j’ai passé le weekend à faire la fête au Macumba et à boire des whisky-coca». Concernant cette dialectique, à savoir si la civilisation du cocon est un problème de riches ou de pauvres, on a aussi constaté que si une partie de la population se définit comme casanière c’est aussi parce que les lieux de socialisations comme les restaurants et les bars sont chers. Il y a tout une partie de la société qui ne veut plus trop jouer le jeu et qui préfère rester chez elle avec la culture du jeu vidéo, du football, de la Fifa, du Winamax ou encore des animaux domestiques, et elle concerne aussi les classes populaires.
AÉ: N’avez-vous pas l’impression que les gens ont quand même envie de sortir de leur cocon depuis le déconfinement?
VC: Pas vraiment. Jérémie Pelletier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès, vient de sortir un livre qui s’appelle La fête est finie? (Eds De L’observatoire, octobre 2021) dans lequel il fait le même constat que moi. Celui d’une société qui, sans vraiment le dire, était déjà préconfinée avant la pandémie. Il démontre aussi dans son travail que l’esprit de la fête, avec la prise de risques qui l’accompagne, celle de rencontrer des gens différents, d’être à l’extérieur, de se demander si la fête sera réussie ou pas, de se mélanger avec tout un corps social, celui de l’altérité… tout cet esprit était déjà mort bien avant le confinement. Le nombre de boîtes de nuit a été divisé par deux en 15 ans avant le confinement, phénomène analysé par des sociologues. La fête est une prise de risques et aujourd’hui les jeunes veulent un risque mesuré. Elle a d’ailleurs aussi été domiciliée, tout comme la danse avec le phénomène des vidéos TikTok. Pareil pour la séduction avec les applications de rencontres. Donc tout ce que permettait la fête, la démonstration des corps, le pouvoir de se mélanger, de se séduire, a été ramené au domicile. Enfin, les chiffres le montrent, le nombre de personnes souffrant de dépression et d’anxiété a drastiquement augmenté. Les gens n’ont pas trop la tête à sortir…
«Cette tendance au repli a d’abord touché les classes populaires, ce qu’on appelait avant les gens casaniers, les couch potatoes.»
AÉ: Qu’est-ce qui vous effraie le plus dans cette civilisation du cocon? Quel en serait le plus grand risque?
VC: On est tous en quête de sécurité, de confort, en quête de gens qui nous ressemblent, pour avoir la chaleur des siens. Mais le plus frappant à mon sens c’est que ce sont des notions cannibales. Le confort et la sécurité, plus on en a, plus on en veut et le curseur ne fait qu’augmenter. Et plus il augmente, plus l’autre, l’extérieur nous paraît de plus en plus rugueux et lointain. Nous avons l’impression de vivre dans un monde de plus en plus violent alors même que, si on en croit les travaux du chercheur Stephen Pinker, on se situe dans la période historique la plus apaisée, du moins par rapport à notre histoire récente. Ce qui m’inquiète dans cette pulsion commune, dans cette difficulté de plus en plus grande à échanger avec l’altérité, à débattre, à avoir des moments où on est OK ne serait-ce que sur le sens des mots qu’on échange, c’est qu’on a créé une civilisation qui «s’archipellise» pour reprendre les mots de Jérôme Fourquet, où chacun est de moins en moins concerné par le destin commun. Et cela m’effraie d’autant plus que je pense qu’on en a un, celui de protéger notre premier safe space qui est l’endroit où on vit, la planète.
«La fête a été domiciliée, tout comme la danse avec le phénomène des vidéos TikTok. Pareil pour la séduction avec les applications de rencontres.»
AÉ: Que faire pour lutter contre cette tentation de repli?
VC: Il s’agit d’abord d’un travail individuel. Même si encore une fois, on ne naît pas tous avec les mêmes capacités, avec les mêmes possibilités. Mais on peut essayer d’apprendre à sortir de soi, réapprendre l’empathie, essayer de volontairement penser contre soi, de parler avec des gens qui ne pensent pas comme nous, de retrouver ce goût des discordes cordiales. Et se rendre compte qu’il y a quelque chose de plus grand et qui nous dépasse. On pourrait retrouver une matrice commune à travers la défense de l’environnement.