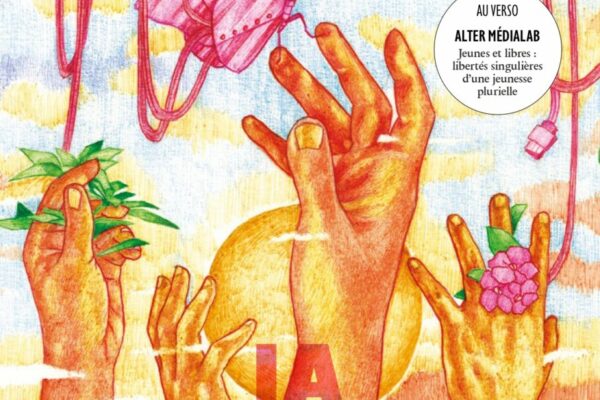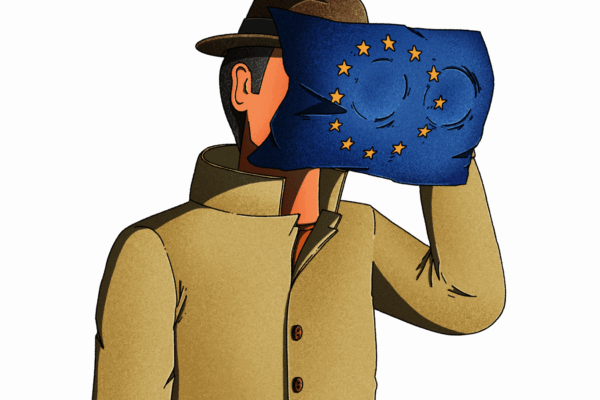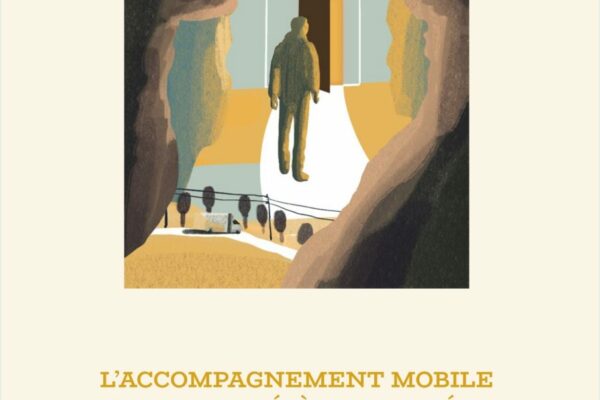Travailleuses du sexe (TDS), prostituées, personnes protituées… Qu’elles aient décidé de les désigner par l’un ou l’autre terme, qu’elles se situent dans le camp des «abolitionnistes» ou pas (relisez notre dossier «Prostitution: jeux de dames, jeux de dupes?», AE n°477, octobre 2019), toutes les structures qui accompagnent aujourd’hui les personnes pratiquant le sexe tarifé s’accordent au moins sur un point: les relations de celles-ci avec les CPAS sont souvent compliquées.
Au détour parfois de non-dits, d’hésitations, d’une forme de pudeur peut-être, on finit par comprendre que ce qui coince, d’après les associations, c’est un – gros – manque de confiance de la part des CPAS vis-à-vis des prostituées/travailleuses du sexe. Soupçonnées de travailler au noir et de demander en plus un soutien via le revenu d’intégration sociale, elles seraient dès lors l’objet d’une méfiance quasi permanente, d’un regard désobligeant lié à leur activité, qui entraveraient l’accès à certains de leurs droits. Au point que certains n’hésitent pas à parler de violences institutionnelles…
Des tricheuses?
Évoquer avec des associations la relation difficile qui lie les CPAS aux TDS/prostituées revient parfois à ouvrir la boîte à souvenirs. À Espace P Liège, on se remémore ainsi cette époque où certains CPAS auraient demandé «des certificats de défichage aux travailleuses du sexe qui souhaitaient obtenir le revenu d’intégration sociale», selon Quentin Deltour, coordinateur de la structure. À une époque où, d’après l’asbl, beaucoup de «TDS» étaient fichées par la police, prouver qu’elles ne l’étaient plus aurait appuyé le fait qu’elles n’exerçaient plus leur activité et donc renforcé leur dossier de demande de RIS. «Une combine tordue», selon le coordinateur, qui n’aurait plus cours depuis quelques années.
Il ne faut cependant pas remonter aussi loin pour réussir une pêche aux témoignages assez féconde. Utsopi, «l’Union des travailleur·se·s du sexe organisé·e·s pour l’indépendance», en a quelques-uns sous le coude. Maria Utsopi, chargée de projet LGBTQI+, pointe le cas de cette travailleuse du sexe qui a fait une demande de RIS et à qui le CPAS aurait demandé de prouver qu’elle n’avait pas travaillé depuis avril 2020. Un «traitement différencié», d’après Maria Utsopi. Autre situation: celle de cette TDS à qui on aurait refusé le revenu d’intégration sociale «parce qu’elle avait de beaux meubles chez elle. On part du principe que les travailleuses du sexe trichent». Et qu’elles essaient de cumuler RIS et revenus au noir…
«Suivant la législation, chaque dossier est examiné selon des critères objectifs et nous estimons que la formation et l’indépendance des assistants sociaux sont telles qu’elles permettent de recevoir les demandes de façon équitable.» Sandrine Xhauflaire, Fédération des CPAS wallons
Du côté d’Espace P Bruxelles, même son de cloche. Fabian Drianne, assistant social, relate l’histoire d’une TDS lituanienne «en ordre de séjour», qui aurait cessé de se prostituer suite à la crise du Covid-19, suivant en cela les mesures sanitaires. «Elle a effectué une demande d’aide auprès d’un CPAS. On lui a demandé son avertissement-extrait de rôle, des extraits de son compte en banque, elle a dû prouver qu’elle cherchait du travail, explique Fabian Drianne. Pour des personnes qui maîtrisent parfois mal le français, qui sont souvent en situation de fracture numérique, cela fait beaucoup. Du coup, elle a renoncé. Il y a beaucoup de personnes qui ont droit au RIS mais qui abandonnent devant la complexité de la démarche.»
Dans le même registre, l’asbl Isala – qui, d’après son site, accompagne les personnes prostituées «dans leurs démarches vers une vie meilleure» – souligne «le poids du système, le manque de clarté au niveau des informations qui sont données autour des CPAS». «Cette situation crée un sentiment de phobie administrative chez des femmes qui sont en général assez fortes mais qui changent d’attitude, deviennent craintives, dès qu’elles poussent la porte d’une institution», constate Rachel Beaufort, une des bénévoles de l’asbl, avant de parler de «violence institutionnelle».
Face à ce tableau qui peut paraître accablant, plusieurs problèmes apparaissent cependant. Un: par respect pour la vie privée des personnes accompagnées, les associations ne souhaitent pas entrer dans le détail des cas évoqués. Impossible donc de vérifier ceux-ci. Deux: dans le cas où une pratique d’un CPAS aurait pu être illégale, les associations interviennent auprès du CPAS mais ne vont souvent pas plus loin. «Si la situation finit par se régler, les filles sont contentes. Elles veulent juste le RIS, pas aller au Conseil d’État», témoigne Quentin Deltour. Trois, les travailleuses du sexe ne mentionnent pas souvent qu’elles sont prostituées. Pour expliquer cette situation, Maria Utsopi évoque «tous ces stéréotypes qui leur collent à la peau. Elles savent qu’elles vont être regardées». Fabian Drianne, lui, parle de «stigmate de la fonction» et évoque le cas de ces travailleuses maghrébines «qui ont peur de se retrouver face à des travailleurs sociaux issus de leur communauté». Ou celui de cette travailleuse bulgare qui aurait évoqué son statut de travailleuse du sexe ayant perdu son boulot suite au Covid. «Le regard de l’assistant social a changé. Le RIS a fini par lui être refusé sous motif ‘qu’elle n’apportait pas la preuve de la perte de son travail suite aux circonstances’», déplore l’assistant social.
Si cette dernière tendance à ne pas se dévoiler est donc compréhensible, elle vient aussi souligner que le problème est peut-être plus général et n’est pas – seulement – lié au statut de prostituée/TDS. Comment en effet évoquer des tracasseries liées à l’activité des TDS/prostituées si celles-ci ne l’évoquent pas avec le CPAS? Interrogée sur le sujet, la Fédération wallonne des CPAS ne dit d’ailleurs pas autre chose lorsque l’on évoque la complexité de ce qui leur est demandé lorsqu’elles font une demande de RIS. «Je comprends les difficultés rencontrées par ces personnes face à ce qui leur est parfois demandé, et je les confirme, explique ainsi Sandrine Xhauflaire, conseillère à la Fédération des CPAS wallons. Mais le problème réside dans le fait que les CPAS sont tenus par des obligations légales. Ce qui est demandé aux travailleuses du sexe, c’est ce qui est demandé à tout le monde, et cela peut aussi être compliqué pour des migrants ou des Belges ayant des problèmes avec la lecture ou l’écriture.»
«Aujourd’hui, on a des personnes qui veulent exercer et qui ne le peuvent pas vraiment, et d’autres qui le font sous la contrainte et qu’il est difficile de protéger.» Pierre Verbeeren, CPAS de Bruxelles-Ville
Quant à un regard jugeant éventuel de certains travailleurs vis-à-vis des TDS/prostituées, la conseillère dément. «Suivant la législation, chaque dossier est examiné selon des critères objectifs et nous estimons que la formation et l’indépendance des assistants sociaux sont telles qu’elle permet de recevoir les demandes de façon équitable. Depuis quelque temps, il y a une tendance à donner une caisse de résonance à quelques cas isolés, on ne mentionne pas tous ceux où cela se passe bien. Et parfois, les associations elles-mêmes ont un regard un peu biaisé sur la situation: elles ne comprennent pas toujours les raisons motivant les refus, ou elles ne savent pas que d’autres formes d’aide ont été proposées, et refusées», ajoute la conseillère.
Nom de code: 96099
Alors, affaire classée? Pas tout à fait. Car, du côté des CPAS, tous ne sont pas aussi rassurants. Pierre Verbeeren est l’un d’eux. Ancien directeur général de Médecins du monde, il est aujourd’hui à la tête du CPAS de la Ville de Bruxelles, «un de ceux qui essaient de faire bouger les lignes», éclaire Fabian Drianne. Son analyse de la situation est un peu plus acérée. «De façon générale, il y a un problème dans les relations entre les CPAS et les personnes pratiquant le sexe tarifé, admet-il. Dans le cadre de l’État social actif, elles sont structurellement en difficulté avec les CPAS. Elles ne sont aujourd’hui pas vraiment considérées comme des travailleuses alors que le rôle des CPAS est de mettre les personnes au travail, de les restaurer dans leur rôle de contribution. On a donc un souci.» Dans ce contexte, la source de revenus des TDS/prostituées est, pour Pierre Verbeeren, un autre problème. «Nous sommes souvent en face de personnes qui ne souhaitent pas montrer leurs sources de revenus alors que nous savons qu’elles en ont. Ce n’est pas facile pour elles – je peux comprendre qu’elles n’aient pas confiance parce qu’il existe un rapport de force structurel entre elles et les CPAS – et ce n’est pas facile pour nous.»
S’il affirme qu’il ne revient pas aux CPAS de se prononcer sur la question, c’est en fait la question de la reconnaissance des TDS/prostituées que Pierre Verbeeren met sur la table. Reconnues a minima, notamment via un code d’activité Nace-Bel «96099» destiné aux «autres services personnels» et donc très fourre-tout, les TDS/travailleuses du sexe n’ont pas de véritable statut. Une situation qui, d’après Maria Utsopi, rejointe en cela par la plupart des intervenants du secteur – à l’exception d’Isala, pour qui le problème est lié au statut de migrantes de la plupart des personnes qu’elle accompagne –, créé un «flou» où «tous les abus sont possibles», que ce soit au niveau des comportements des travailleurs des CPAS et des procédures auxquelles sont soumises les TDS/prostituées. Pierre Verbeeren, lui, regrette également que la réglementation ne soit pas plus claire. «Aujourd’hui, on a des personnes qui veulent exercer et qui ne le peuvent pas vraiment, et d’autres qui le font sous la contrainte et qu’il est difficile de protéger», regrette-t-il.
Face à cet imbroglio, les associations de terrain ont chacune bricolé leur petite tactique. Icar Wallonie, une asbl située à Liège et active dans le soutien et l’accompagnement «de la personne prostituée et de ses proches», a entrepris de dénicher «des personnes-ressources/relais» au sein des structures avec lesquelles elle travaille. Espace P Bruxelles souligne une bonne collaboration avec les CPAS de Bruxelles-Ville et Schaerbeek. Espace P Liège affirme avoir des «contacts privilégiés» et débarque au CPAS «avec un dossier bétonné. Nous avons adapté notre travail aux différents problèmes rencontrés». Mais elles ne sont pas les seules à bricoler. Du côté du CPAS de la Ville de Bruxelles, on s’active aussi à l’heure actuelle. Pierre Verbeeren affirme qu’il existe aujourd’hui «une note d’instruction, non encore validée, où nous explorons la possibilité de ne pas orienter tout de suite les TDS vers l’emploi. Il s’agit de permettre aux travailleurs sociaux d’arrêter le temps et de voir avec elles ce qu’elles veulent faire. Consolider leur activité? Changer d’activité?»
No rules
Si l’initiative du CPAS de la Ville de Bruxelles peut paraître louable, elle ne semble finalement être qu’un avatar de plus du manque de clarté dans la situation actuelle des TDS/prostituées. Face au flou, chaque CPAS, chaque commune, chaque niveau de pouvoir prend les mesures qu’il estime pertinentes. «Si vous êtes travailleuse du sexe, c’est parfois plus ‘facile’ à Bruxelles, parfois à Liège. Tout dépend de l’endroit où vous vous trouvez. Finalement, la plus grande violence institutionnelle, c’est l’absence de règles», souffle Fabian Drianne.
Cette situation semble d’ailleurs impacter d’autres opérateurs que les CPAS. Fin 2020, Icar Wallonie a introduit plusieurs dossiers de demande de droit passerelle – dans le cadre de la crise du Covid-19 – pour des TDS/prostituées qu’elle accompagne. Pour ce faire, elle est passée par Securex, le secrétariat social auquel les travailleuses étaient affiliées en tant qu’indépendantes. «Nous avons rentré les dossiers pour octobre, novembre, décembre 2020, mais aucun paiement n’était effectué, raconte Dominique Silvestre, éducatrice chez Icar Wallonie. Finalement, nous avons eu un contact avec Securex fin décembre et il nous a été dit qu’il fallait réintroduire tous les dossiers. Les affiliées ont dû de plus produire une déclaration sur l’honneur où elles affirmaient qu’elles ne travaillaient plus à cause de la crise.» Une situation que Dominique Silvestre qualifie de «discrimination».
Contacté par Alter Échos, Securex pointe par écrit… le fameux code d’activité Nace-Bel attribué faute de mieux aux TDS/prostituées. «Aucune des entreprises avec ce code NACE 9609 n’a eu l’obligation de fermer suivant les directives ministérielles. Par conséquent, ces entreprises n’ont pas pu bénéficier des mesures d’aide gouvernementales à la suite d’une fermeture obligatoire. Dans les cas où les services personnels sont fournis dans un établissement qui a été obligé de fermer par les directives ministérielles dans le cadre de la crise Corona, nous avons demandé aux personnes concernées de nous fournir un document qui sert comme preuve de la fermeture du lieu en question. Dès la réception de ce document, nous avons effectué sans tarder les paiements»…