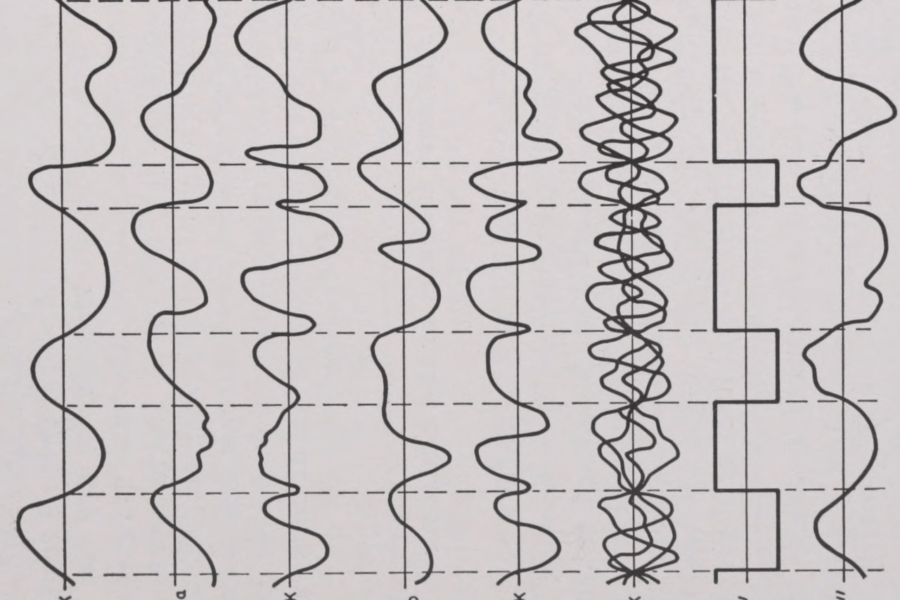Après un séjour en prison, Marc*, Grégoire*, Pedro et Saadia exécutent – ou ont exécuté – la fin de leur peine chez eux, un bracelet électronique à la cheville. Hors des murs de la prison, mais sans être libres pour autant.
Le bracelet électronique colle à la peau de celui qui le porte et s’immisce dans son intimité. Trop serré, il gêne, voire irrite la peau, jusqu’à provoquer des ampoules chez celui qui n’y est pas encore habitué. Trop flottant, il n’est plus détecté par la machine à laquelle il est relié. On le sent quand on se lave, il se coince dans un pantalon trop serré, on le planque en enfilant des chaussettes montantes, il est tellement embarrassant qu’on va jusqu’à se savonner, une chaussette au pied, dans les douches collectives d’une salle de sport. Ou alors on l’assume et on le dévoile, même si on n’en est pas vraiment fier.
S’il permet d’échapper à l’exiguïté d’une cellule, de vivre chez soi et de travailler ou d’avoir une activité bénévole, le bracelet laisse surtout à son propriétaire cette sensation persistante d’être tel un chien tenu en laisse. Car désormais son temps, ses déplacements et ses activités sont contrôlés.
Le temps, ce tyran
Sur le pas de la porte de l’appartement familial, Marc* a la bougeotte. Il a égaré ses clefs et est coincé là, à attendre le retour de sa mère, son frère ou sa sœur pour rentrer chez lui, d’où il ne peut sortir qu’à des moments bien précis. Outre 36 heures de «congé» par week-end, Marc a l’autorisation de quitter son domicile tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, ainsi que le mercredi matin, tout en respectant scrupuleusement les horaires définis, pour assister à une formation en plafonnage en compagnie d’autres gars empêtrés comme lui dans un parcours judiciaire. La formation de la dernière chance, dit-il, comme pour se rappeler lui-même à l’ordre.
Durant ses heures de confinement, même une petite flânerie jusqu’au bas de la cage d’escalier de l’immeuble bruxellois est prohibée, à moins que l’aller-retour soit expéditif, puisque le boîtier relié au bracelet qui ceinture sa cheville et qui est dissimulé sous son jean ne signale une escapade hors du périmètre toléré qu’au bout de cinq à dix minutes. En cas de retard, le boîtier s’enclenche et… le stress monte. Et lorsque Marc n’est pas de retour à 18 heures, son téléphone vibre, une fois sa maman, une fois les agents du Centre de surveillance électronique, pour s’enquérir de son retour au bercail.
Une petite panne de réveil le matin? Pas envie d’aller au sport aujourd’hui? Son téléphone sonne, et il doit s’expliquer.
Tic tac, tic tac. Le stress de l’aiguille qui avance sans se soucier des imprévus, Grégoire* connaît. Il prépare tous ses déplacements car chaque minute compte. S’il est bloqué dans une trop longue queue au supermarché, il pourrait s’échauffer et s’en prendre au caissier, qui n’y est pour rien. Même quand il est chez lui et qu’il ne quitte pas le domicile à l’heure dite, il est contrôlé. Une petite panne de réveil le matin? Pas envie d’aller au sport aujourd’hui? Son téléphone sonne, et il doit s’expliquer. Sans compter toutes les attestations qu’il doit récolter ici et là (travail, salle de sport, service social…) pour justifier tous ses faits et gestes à l’extérieur.
Grégoire était en congé pénitentiaire quand la nouvelle est tombée: il allait être libéré sous bracelet électronique. Encore une dernière nuit à passer sous les barreaux. «La prison, c’est triste, c’est dur. Il faut choisir entre le rôle de la proie et celui de prédateur et donc apprendre à montrer les dents», glisse-t-il. Après trois ans à voir s’égrener le temps, il n’a jamais été aussi joyeux de réintégrer sa cellule pour les douze dernières heures. Soulagé, il allait pouvoir retrouver ses proches. Il était libre. Enfin pas vraiment: il était toujours «entre leurs mains».
À sa sortie, Grégoire s’est d’abord installé chez sa mère en attendant de se dégoter un petit nid avec sa compagne. Dans la maison maternelle, à maintes reprises, le système de surveillance perd sa trace. Pourtant, il est en train de barboter dans son bain ou de ronfloter dans son lit. «Sans doute un problème de pile», soupire-t-il, se rappelant avoir été réveillé à 3 heures du matin par les agents du système de surveillance. Toute une série de «retards» se sont accumulés alors qu’il était à la maison, provoquant une vive inquiétude chez sa maman, qui craignait des conséquences pour son prochain passage au tribunal d’application des peines (TAP).
Il lui est arrivé, à Grégoire, de péter un câble. D’envoyer bouler ce bracelet qui l’asservit. Une fois, il est rentré avec 228 minutes de retard. Après trois ans de prison et à onze mois de la fin de sa peine, il aspire tant à pouvoir se promener en rue sans avoir le regard constamment rivé sur sa montre. Un plaisir auquel il ne peut goûter que le week-end. Prendre une semaine de vacances à l’étranger avec sa copine ou se rendre au mariage d’un proche à Lille, n’y pensons même pas. Les excursions hors des frontières belges sont interdites. Et pour lui qui ambitionne de bosser pour un ami comme indépendant dans le transport routier, il va falloir attendre.
La réinsertion au rythme du travail
Chaque soir, une heure et demie avant l’heure dite, les neurones de Pedro eux aussi s’agitent. Ils bifurquent de son job pour s’agripper à une pensée: le retour. Pourtant, Pedro a réussi à négocier avec la justice des heures de sortie assez larges, de 6 h 30 à 22 heures en semaine, un étirement justifié par son activité indépendante: le lancement, à coups d’heures de travail et de sueur sur son front, de son magazine afro. Ce projet, il l’a mijoté pendant des années depuis le fond de sa cellule. Les SPS (services psychosociaux) des établissements pénitentiaires avaient bien du mal à y croire. Mais aujourd’hui, Pedro est «candidat entrepreneur» dans la couveuse d’entreprises Job Yourself, un statut peu connu de la justice pénitentiaire: «Le seul truc qu’un détenu n’a jamais fait», lui a un jour lâché le juge qui s’occupait de son dossier.
Même s’il jouit d’un nombre de mètres à parcourir bien plus élevé qu’en taule, il éprouve de plus en plus de difficultés à rester inactif.
Chemise blanche, pantalon noir pimpant, dans le bureau moderne qu’il loue au cœur du quartier européen, Pedro échappe aux idées reçues sur les détenus. Vol avec violence, escroquerie et violence conjugale, les faits qui l’ont conduit en prison – Lantin, Leuze puis Forest – sont pourtant carabinés. Sa réinsertion, il ne la conçoit que par le travail. Tant qu’il peut s’y adonner corps et âme, il se reconstruit jour après jour, avec toujours au-dessus de lui cette épée de Damoclès d’un possible retour en prison au moindre faux pas.
Pour le reste, il est devenu un loup solitaire. Sa vie sentimentale, il ne veut plus en entendre parler. Et mis à part sa fille qui vient chez lui de temps à autre, sa vie sociale se réduit à peau de chagrin: ses relations professionnelles et des contacts sporadiques avec ses anciens codétenus. Ces fréquentations sont proscrites, c’est vrai. Mais, se justifie-t-il, c’est tout de même en leur compagnie qu’il s’est langui pendant cinq ans, c’est ensemble qu’ils se sont entassés dans les neuf mètres carrés d’une cellule. Aujourd’hui, se cloîtrer dans sa chambre demeure une routine qui le sécurise. Une bulle protectrice.
À la maison, mais sans le sou
Cloîtrée chez sa mère, Saadia l’est restée pendant six mois et dix jours. Ici, elle ne pouvait pas s’aventurer dans la pelouse du jardin pour savourer un rayon de soleil. Bien mesuré, le périmètre autorisé s’arrêtait précisément à la limite de la terrasse qui jouxte la petite maison en briques rouges de Roux, en banlieue de Charleroi. La maman et la sœur de Saadia ont dû signer un «contrat» afin qu’elle puisse exécuter sa peine dans le domicile maternel. Saadia a bien un appartement, un logement social dont le loyer a été pris en charge par des proches pendant son incarcération. Mais pas question d’y exécuter sa peine: financièrement, c’était impensable.
Saadia a perdu tous ses droits en prison – la mutuelle, le chômage. Comme c’est le cas pour beaucoup, elle perçoit durant la durée de sa peine sous bracelet une allocation hebdomadaire du SPF Justice de 97,38 euros. Pas de quoi s’en sortir. Bien entendu, elle se serre la ceinture: avec ce maigre revenu, elle finance le loyer de son appartement inhabité – 265 euros par mois –, son tabac, ses médicaments, une consultation mensuelle chez le psychologue et l’essence du scooter avec lequel elle se rend deux fois par semaine au refuge pour animaux où elle exerce toujours une activité bénévole. Elle n’a jamais demandé un euro à sa mère, tient-elle à préciser, mais c’est bien cette dernière qui remplit le frigo et lui «donne sa tartine».
Les semaines qui suivent sa sortie, Saadia est mal dans sa peau. Elle entend le bruit des clefs qui tournent dans les serrures, celui des grilles qui claquent. Les cris des filles. Elle parle peu. Que raconter quand on a été privé de contacts pendant tant d’années? La cellule, le préau, les «cas un peu spéciaux» qu’on lorgne du coin de l’œil sans vouloir s’y frotter, les bagarres des filles en manque. Elle angoisse, aussi, à l’idée qu’on lise sur son visage les dernières années de sa vie. Confier qu’on a fait de la prison, ce n’est pas simple. Et, dans le voisinage, beaucoup jugent, alors que, finalement, cela ne regarde personne. Aux uns, elle rapporte qu’elle a fait une «petite bêtise» et qu’elle purge une brève peine sous bracelet. Aux autres, les plus proches, elle dit la vérité.
Après quelque temps, s’installe l’apaisement dans la maison familiale, «la maison d’Allah», comme l’a baptisée sa maman, pourtant fille d’un mineur italien. Aujourd’hui, pour Saadia, la prison est loin derrière. Elle envisage de reprendre des cours de théâtre, de passer un coup de peinture dans son appartement dévasté par des squatteurs au cours de sa longue absence, d’entamer une formation en commis de cuisine et, pourquoi pas, de trouver un job.
La libération, ce graal
La porte de la prison s’est refermée derrière Marc le 16 octobre dernier. Il n’échangerait pour rien au monde sa place à la maison contre un retour en cellule. Pour autant, le bracelet, c’est «chiant». Plus cela se prolonge, plus cela lui monte à la tête. Même s’il jouit d’un nombre de mètres à parcourir bien plus élevé qu’en taule, il éprouve de plus en plus de difficultés à rester inactif. En avril, le tribunal d’application des peines statuera sur la possibilité ou non d’une libération conditionnelle. La libération, la vraie, il l’attend donc avec l’impatience d’un enfant devant son sapin de Noël.
Quand on lui a ôté sa «belle garniture», selon les termes de sa maman, elle a senti ses ailes se déployer.
Au mois de septembre, Grégoire pourrait lui aussi obtenir une conditionnelle. Mais, à quelques mois de son fond de peine, il préfère garder son bracelet pendant une petite année encore plutôt que d’avoir des comptes à rendre à la justice pour cinq ans de plus: un condamné qui exécute la totalité de sa peine est libéré sans conditions. Encore des trucs à respecter? «Non merci!», balance-t-il. Il va mordre sur sa chique et aller au bout. Après, la vie, ce sera reparti.
Pedro n’a aucune idée du temps qui va encore s’écouler pour lui, son bracelet à la cheville. Peu importe. Au moins il peut travailler et, après sa détention, il est encore en pleine «mise à jour»: le monde a bien changé en cinq ans. Ce bracelet est finalement une bonne transition, même s’il ne permet pas de cultiver sa vie sociale. À sa sortie, il avait emménagé avec la mère de son second enfant, avec qui il n’avait jamais habité. Mais «madame voulait sortir, avoir des activités». Leur union avait vite tourné court.
Après plusieurs années de prison et une demi-année sous bracelet, Saadia est aujourd’hui en conditionnelle. Quand on lui a ôté sa «belle garniture», selon les termes de sa maman, elle a senti ses ailes se déployer. Et même si sa libération est assortie de conditions – ne pas consommer d’alcool ou de drogues, ne pas fréquenter d’anciens détenus, avoir une activité… –, elle se sent enfin… libre.
* Les prénoms suivis d’un astérisque ont été modifiés.
La surveillance électronique
La surveillance électronique permet d’exécuter une peine privative de liberté en dehors de la prison. La personne ne séjourne pas en prison mais porte un bracelet électronique connecté à un boîtier installé à domicile et est soumise au respect d’un horaire établi. Le contrôle du respect de cet horaire est assuré par le Centre de surveillance électronique. La surveillance électronique s’applique à différents types de situations:
– pour des personnes condamnées à des peines de prison de moins de trois ans: la peine peut alors être exécutée sous la forme d’une surveillance électronique.
– pour des personnes condamnées à des peines de prison de plus de trois ans: le tribunal d’application des peines (TAP) peut éventuellement octroyer la surveillance électronique.
– dans le cas d’une mise à disposition du TAP sous surveillance électronique: le TAP décide, avant la fin de la période de détention d’une personne, s’il y a lieu de la maintenir en prison jusqu’au terme de sa peine ou si elle peut être mise sous surveillance.
– pour des personnes en détention préventive, c’est-à-dire soupçonnées d’avoir commis une infraction: la personne a alors l’obligation de rester en permanence à l’adresse indiquée et ne peut s’absenter que pour des déplacements autorisés. Contrairement aux autres cas, elle est ici suivie à la trace par un système de géolocalisation.
La surveillance électronique se donne pour objectifs d’éviter à certains justiciables les effets nocifs liés à l’incarcération; de favoriser leur réinsertion sociale; de diminuer le taux de récidive; de lutter contre la surpopulation carcérale, mais aussi de renforcer la confiance du citoyen dans le système pénal en diminuant le sentiment d’impunité qu’engendre la non-exécution des peines.
Source: http://www.maisonsdejustice.be/index.php?id=surveillanceelectronique
Pour en savoir plus, lire à ce sujet: «Surveillance électronique: une alternative au bilan mitigé», Alter Échos n°426, juillet 2016, Cédric Vallet.