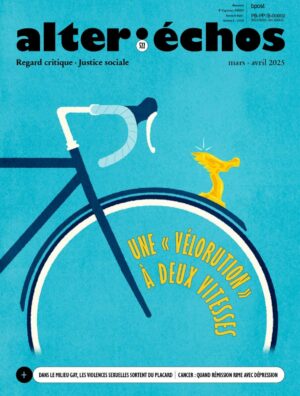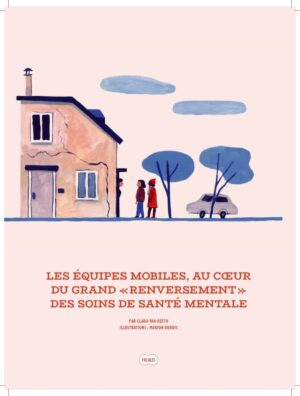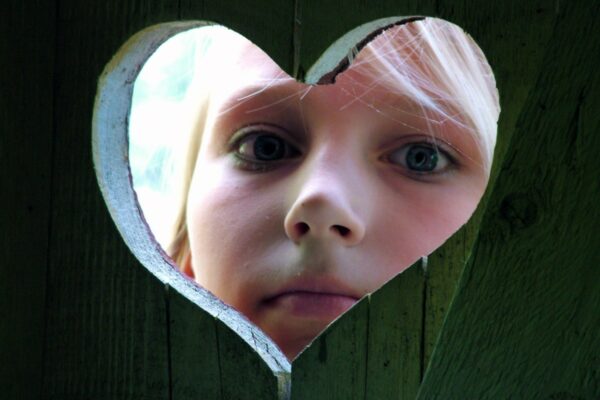Si le monde associatif est devenu un secteur économique de plus en plus important, son histoire prouve que cette évolution n’est pas sans ambiguïté. Au secteur de conjuguer de façon équilibrée «économisation» et «pouvoir de revendication». Explications avec Jean-Louis Genard (ULB) et Jacques Defourny (ULg).
En Belgique, les structures associatives sont les héritières de la piliarisation du pays. Dès ses débuts, l’État a en effet confié aux trois grands mouvements sociaux (catholique, libéral et socialiste) l’organisation de ce qu’on n’appelait pas encore le «vivre-ensemble». «Si le monde associatif est largement financé par les politiques publiques, ce qui n’est pas le cas dans d’autres pays, cela tient à l’histoire de notre pays. Dès le départ, il y eut une délégation de la part de l’État de missions de service public à l’associatif», rappelle Jean-Louis Genard, sociologue spécialiste de l’action publique (ULB). Si cette piliarisation structure encore de nombreux pans importants de la société (mutuelle, syndicat, enseignement…), il y eut par la suite une forte propension à l’institutionnalisation de nouvelles associations dans les années 1970. «De nouveaux acteurs comme des associations pour une autre médecine, de défense de consommateurs ou pour une autre mobilité représentaient des intérêts qui ne trouvaient pas leur place dans les logiques piliarisées. En outre, ils s’inscrivaient dans de nouveaux mouvements sociaux (féministe, écologiste…), défendant des causes ne se laissant pas réduire aux thématiques habituelles sur lesquelles s’était constituée la logique des piliers», ajoute Jean-Louis Genard. Face à une société désormais pluraliste, l’État décida d’encadrer, en complément des trois piliers centraux, ce tissu associatif à travers un financement qui donnait un statut relativement public aux associations. «Il y avait alors cette idée que tous les coins du territoire devaient posséder un certain nombre de services, et ce, en lien avec la communautarisation progressive du pays. Une logique tout à fait défendable, contribuant à créer une myriade de petites associations en tous genres… D’autant qu’il y avait de l’argent pour le faire à l’époque», continue le sociologue.
Une délégation systématique
Avec cet essor, la délégation de missions de service public vers le secteur associatif s’est considérablement accélérée et systématisée. «On peut parler d’un État-réseau, constate encore Jean-Louis Genard. Se libérant de l’obligation de définir le bien public ou l’intérêt général, l’État se fait simplement organisateur du pluralisme. La prison certes, mais aussi les peines alternatives, la médiation… L’école, à coup sûr, mais aussi les écoles de devoirs, les centres PMS, l’alphabétisation, les maisons de jeunes.»
«On peut parler d’un État-réseau. Se libérant de l’obligation de définir le bien public ou l’intérêt général, l’État se fait simplement organisateur du pluralisme.», Jean-Louis Genard, sociologue spécialiste de l’action publique (ULB)
Mais cette délégation institutionnelle n’est pas sans ambiguïté. D’un côté, elle peut être perçue comme le signe du déclin de l’État qui tend de plus en plus à privatiser et à externaliser ses politiques, et de l’autre, comme l’indicateur d’une volonté d’accroître la participation et l’implication citoyenne avec la reconnaissance de moyens propres. «Dès les années 70, la question du rapport au pouvoir se posait déjà: jusqu’à quel degré de compromis les membres d’une association étaient-ils prêts à aller? C’est l’ambivalence de l’institutionnalisation: c’est à la fois la menace de normaliser la structure et la seule possibilité de la viabiliser», explique Jean-Louis Genard.
Le marché de l’associatif
Dès les années 80, ce soutien financier public fut pourtant freiné. L’austérité, déjà… «Ce tissu associatif émergent a vu son essor limité et n’a pu bénéficier, comme les associations liées aux piliers, de subventions structurelles importantes», continue le sociologue. Avec pour conséquence un financement passant de logiques de stabilisation institutionnelle comme lors de la piliarisation vers des logiques d’appels à projets qu’il s’agit de promouvoir et de financer. «Le politique fixant désormais des objectifs d’ordre général, à charge pour les associations de se les approprier et d’y apporter des réponses spécifiques, notamment territorialisées, qui auront à faire leurs preuves et qui seront évaluées. Là aussi, le processus n’est pas sans ambiguïté», admet Jean-Louis Genard. Cette donne gestionnaire, voire managériale aux yeux du sociologue, a énormément changé le fonctionnement du secteur: «Appel à l’autonomie, à l’initiative, à la responsabilité, d’une part, mais précarisation des associations, travail dans le court terme, de l’autre. Au paysage institutionnel mais stabilisé lié aux piliers s’est substitué un quasi-marché de l’associatif, fait d’une multitude de structures en concurrence, pour s’approprier des ressources limitées, obligées de s’adapter constamment aux formulations changeantes de politique.»
5,4% du PIB
Cette nouvelle donne est à mettre en lien avec l’émergence de l’économie sociale. «Progressivement s’est installée la conscience que le secteur associatif est un acteur économique comme les autres», rappelle Jacques Defourny, directeur du Centre d’économie sociale de l’ULg. «Dans l’économie belge, ce secteur a crû les dix dernières années de manière plus forte que le reste de l’économie. Partout dans le monde, y compris en Chine, le poids économique du secteur associatif augmente, preuve s’il en est qu’il rassemble des atouts qui ne sont pas à la portée de la puissance publique», poursuit-il. Parmi ses atouts, Jacques Defourny pointe l’esprit entrepreneurial du secteur: «Bien que les financements publics rythment la vie de la plupart des acteurs du secteur, surtout quand il y a des emplois créés, ce qui détermine encore plus la création d’associations, c’est la gravité des besoins non satisfaits ni par l’État ni par le marché. En cela, les associations ont toujours joué un rôle de défrichage de nouveaux besoins sociaux.»
«Sur les 60.000 associations actives en Belgique, une sur trois est pourvoyeuse d’emplois», Jacques Defourny, directeur du Centre d’économie sociale de l’ULg
Aujourd’hui, comme le rapporte le dernier rapport de la Fondation Roi Baudouin(1), le secteur associatif est indéniablement un acteur important du paysage économique belge, avec une contribution de 5,4% à la richesse nationale (PIB). Ce sont les branches de la santé et de l’action sociale qui dominent l’activité économique du secteur associatif, et ce, dans les trois régions du pays. Dans ces deux branches, le financement public couvrait en 2014 plus de la moitié des ressources totales du secteur associatif tandis que, dans les autres branches, leur financement provenait d’autres sources. En termes absolus, les branches de la santé et de l’action sociale sont les principales bénéficiaires de subventionnements en provenance de l’administration publique.
Bon an, mal an, il se crée 3.000 associations par an en Belgique. «Un chiffre stable depuis les années 90, ajoute Jacques Defourny, même si ce secteur se renouvelle et se transforme sans cesse.» Une des raisons de ce développement: un statut juridique pour les associations parmi les plus flexibles et les plus souples au monde. «Par contre, il est très rare qu’une association se crée rien que pour répondre à un appel à projets. Le secteur vit des sources de financement bien souvent composites, pas totalement publiques, avec du bénévolat et de l’appel aux dons dans les phases émergentes», rappelle Jacques Defourny.
Plus de 10% de l’emploi
Au niveau de l’embauche, le tissu associatif belge occupe 12,3% des emplois salariés disponibles. «La Belgique est d’ailleurs dans le trio de tête international, aux côtés des Pays-Bas et de l’Irlande, avec une part de l’emploi associatif supérieure à 10% par rapport à l’emploi total. Sur les 60.000 associations actives en Belgique, une sur trois est pourvoyeuse d’emplois», poursuit Jacques Defourny. Le précédent rapport de la Fondation Roi Baudouin pointait d’ailleurs l’augmentation ininterrompue de cette proportion sur la période 2000 à 2008 grâce à un taux de croissance de l’emploi systématiquement plus élevé dans le secteur associatif par rapport au reste de l’économie. Cette tendance est confirmée pour la période 2009-2014 où, malgré un marché en demi-teinte, l’emploi dans le secteur associatif a continué à progresser, renforçant ainsi la place d’employeur important du secteur dans l’économie belge. Globalement, le secteur a en effet concouru pour près de 58% à la création d’emplois entre 2009 et 2014. C’est dans les branches de la santé et de l’action sociale que l’emploi est le plus important avec respectivement quelque 145.000 et 181.000 salariés occupés dans le secteur en 2014. Ces deux branches réunies totalisent ainsi près de 70% de l’emploi salarié total du secteur associatif.
«La reconnaissance économique des associations tend à les réguler.», Jacques Defourny, directeur du Centre d’économie sociale de l’ULg
Pour Jacques Defourny, l’un des grands enjeux du secteur associatif est de conjuguer de façon équilibrée «économisation» et «pouvoir de revendication» pour répondre aux besoins sociétaux à venir. «La reconnaissance économique des associations tend à les réguler, soit par plus de contraintes politiques en termes de responsabilisation surtout si les budgets sont plus serrés, soit par des règles de marché en transformant subsides en contrats publics, par exemple, avec une mise en concurrence des associations avec le secteur commercial classique. L’enjeu, c’est de pouvoir les accompagner sans les étouffer, sans qu’il y ait de rupture entre leur vocation sociopolitique et leur démarche entrepreneuriale.» Une source réelle de tension dans le secteur, reconnaît le professeur de l’ULg, «mais elle prouve une chose: dans nos économies, il est possible de produire de façon non capitaliste et non publique».
(1) Le poids économique des Institutions sans but lucratif en Belgique, Fondation Roi Baudouin, édition 2017.
En savoir plus
Alter Échos n° 446, «Sous le joug de la bureaucratisation», Céline Teret, 19 juin 2017