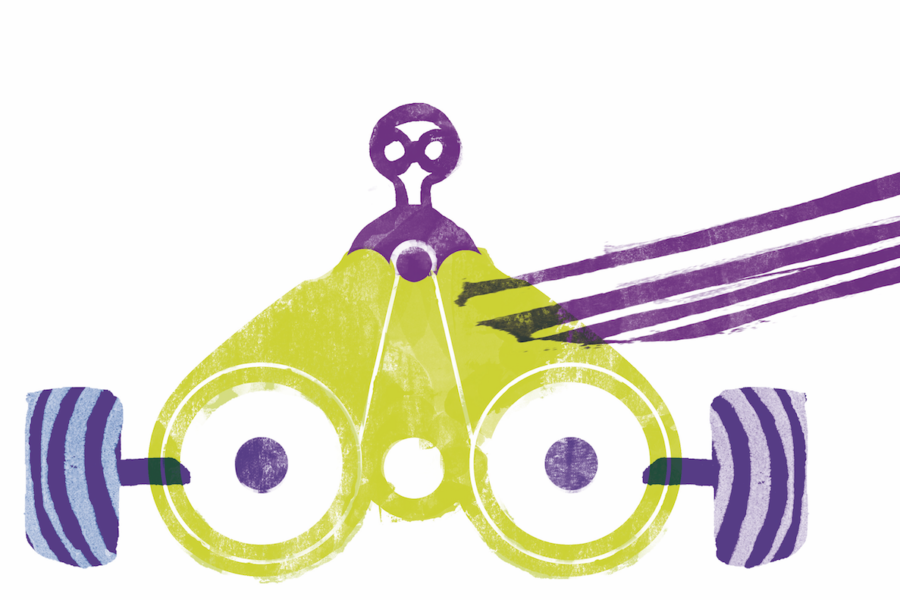Article issu de notre dossier «École de transformation sociale : l’enquête dans l’enquête. L’imagination au pouvoir» à consulter dans son entièreté en cliquant sur ce lien.
L’ETS est un projet co-organisé par le Forum– Bruxelles contre les inégalités, Bruxelles Laïque, le Conseil bruxellois de coordination sociopolitique, la Fédération des services sociaux, HE2B–IESSID et l’Agence Alter. Avec le soutien de la Fondation CERA, la COCOF, la COCOM, la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le travail au noir est partout, autour de nous. C’est la garde-malade, l’élagueur, le livreur, la femme de ménage, le serveur, la plongeuse. C’est un sans-papiers, une mère isolée, un étudiant, une retraitée. C’est un état perpétuel, ou passager.
Le travail au noir ne remplit pas les caisses de la Sécu mais participe au PIB. Il témoigne de nombreux dérèglements en matière de travail, des droits, ou encore des politiques migratoires. Il révèle des abus, mais met aussi en lumière les débrouilles, les solidarités.
Les syndicats sont désarçonnés par ce secteur informel qui échappe à leur cadre habituel. Les pouvoirs publics le traquent ou tentent de le professionnaliser, ou de le formaliser (et souvent, au rabais).
«Il est impossible de comprendre et de réguler les logiques et pratiques d’informalité sans être dans une approche sociétale»; «Il faut se pencher sur les failles plutôt que sur les individus», avons-nous entendu à l’École de transformation sociale.
Pour mieux cerner les contours de cette économie informelle – ou souterraine – et ses nuances, nous avons croisé les regards de ceux et celles qui gravitent autour des travailleurs au noir, qu’ils les accompagnent, les défendent ou les contrôlent.
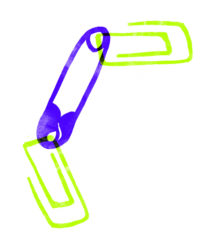 MÊME AU NOIR, LES TRAVAILLEURS ONT DES DROITS
MÊME AU NOIR, LES TRAVAILLEURS ONT DES DROITS
Jan Knockaert, coordinateur de l’asbl Fairwork Belgium
Le travail au noir: un travail non déclaré, caché, informel… Et pourtant pas complètement hors la loi. «Ce qui est fantastique dans notre droit du travail en Belgique, c’est qu’il n’y a pas de différence entre un travailleur formel ou informel, introduit Jan Knockaert. Cela signifie que, pour un travailleur au noir ou sans papiers, il est toujours possible de réclamer des droits via les canaux existants (l’inspection du travail et l’auditorat du travail).»
L’asbl Fairwork Belgium s’appuie sur ce cadre légal pour faire respecter les droits des travailleurs sans titre de séjour et compte de plus en plus de victoires à son actif, dont récemment la condamnation d’un patron à s’acquitter de 30.000 euros d’arriérés de salaire à un travailleur sans papiers.
Y parvenir n’est évidemment pas chose aisée. Pour réclamer des salaires impayés ou une compensation en cas d’accident du travail, encore faut-il prouver l’existence d’une relation professionnelle. À défaut d’un contrat de travail, tout peut servir : «Des messages WhatsApp, vidéos, bons de livraison, témoins… On cherche tous les éléments possibles», explique Jan Knockaert. Pour certifier un lien professionnel, rien ne vaut un contrôle sur le lieu de travail. Le problème, c’est que, «si l’inspection du travail constate la présence d’un travailleur sans papiers, elle est obligée d’appeler la police, et donc l’Office des étrangers». Pour contourner ce problème, Fairwork Belgium a négocié un accord informel avec ce dernier : «Si le travailleur en question a déposé une plainte et est accompagné par nous, alors il sera menotté et emmené au commissariat mais l’Office des étrangers se contentera d’un ordre de quitter le territoire, sans l’emmener en centre fermé.»
Un arrangement précaire mais qui devrait, espère Jan Knockaert, encourager les travailleurs sans papiers à faire davantage valoir leurs droits.
«PARFOIS LA MEILLEURE SOLUTION À UN MOMENT DONNÉ»
Isabelle, assistante sociale au service de médiation de dettes de Bruxelles Laïque
Les travailleurs sociaux du service de médiation de dettes de Bruxelles Laïque sont régulièrement confrontés à la zone grise de l’économie informelle lorsque, pour remonter la pente, des personnes endettées qu’ils accompagnent tirent (une partie de) leurs revenus du travail au noir. Se pose alors une question : faut-il prendre en compte ces revenus dans le cadre de l’élaboration de leur plan de remboursement? Et faut-il en avertir les créanciers?
À Bruxelles Laïque, «cela se décide au cas par cas, explique Isabelle. Pour l’instant, j’accompagne un jeune homme qui, après avoir porté un bracelet électronique, va recommencer à travailler au noir en tant que serveur dans un bar. Vu sa situation d’endettement, il veut pouvoir continuer à percevoir ses allocations de chômage (qui sont déjà très basses) tout en gagnant un peu d’argent sur le côté». Dans ce cas-ci, les revenus au noir du jeune homme, jugés trop fluctuants, n’ont finalement pas été intégrés dans le plan de paiement.
Avant de rejoindre Bruxelles Laïque, Isabelle a travaillé pendant douze ans dans un CPAS. Elle y a rencontré un public «principalement de sans-papiers, pour lequel le travail au noir était la seule solution, un état perpétuel». Aujourd’hui, l’assistante sociale constate que le travail au noir peut aussi être un tremplin temporaire pour les personnes ayant un parcours difficile : «On peut entendre que c’est parfois la meilleure solution à un moment donné pour ces personnes, et on peut les soutenir. Mais ce n’est pas pour autant qu’on le fait à la légère. Il faut aussi essayer de comprendre la mécanique qui les a menées à cette situation, sans quoi notre intervention serait inutile.»
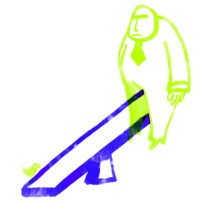 LE DOUTE DANS LES ZONES GRISES
LE DOUTE DANS LES ZONES GRISES
Charles-Éric Clesse, auditeur du travail de l’arrondissement judiciaire du Hainaut
Le travail au noir n’a rien d’une zone grise, selon Charles-Éric Clesse, auditeur du travail de l’arrondissement judiciaire du Hainaut. «C’est une zone noire», puisqu’il désigne «toute situation dans laquelle un travailleur n’est pas déclaré à la sécurité sociale par son employeur. On peut aussi parler d’économie souterraine…» Pour l’économie informelle en revanche, les nuances de gris apparaissent. «Les chauffeurs Uber ou Deliveroo relèvent selon moi de l’économie informelle, relève notre interlocuteur. Ce sont des travailleurs indépendants mal payés, indépendants qui devraient être salariés.» Autre exemple de zone grise : les travailleurs à mi-temps déclarés dont les heures sup’ sont payées au noir, «des cas de figure plus difficiles à démontrer que dans les cas où le travailleur n’est pas du tout déclaré, on a un doute dans beaucoup de situations». Comment y voir clair là-dedans? «Lutter contre ce type d’économie est extrêmement difficile. Il faut soit obtenir des informations, soit des dénonciations», explique Charles-Éric Clesse. Et de conclure noir sur blanc : «Il faut éradiquer le travail au noir. Une mesure serait de réduire les cotisations sociales. Si tout le monde jouait le jeu pendant un an, on verrait les prestations sociales augmenter. Le travail au noir met le système à mal.»
UNE RECHERCHE D’EMPLOI FORMEL QUI FAIT VALOIR L’INFORMEL
Xavier, conseiller emploi d’une mission locale bruxelloise
Même dans le cadre de la recherche d’un emploi «formel», le travail au noir occupe «une grande place», observe Xavier (dont le prénom a été modifié à sa demande). «Entre un tiers et la moitié», à la grosse louche, des personnes qu’il accompagne y ont (eu) recours, estime le conseiller emploi. Lors de leurs premiers échanges à la mission locale, Xavier constate souvent que «ces personnes sont très mutiques : elles me disent qu’elles n’ont aucune expérience. Mais en grattant un peu, et quand je leur explique que je ne suis pas là pour les contrôler ou les dénoncer, la parole s’ouvre. Et je découvre qu’elles ont souvent une expérience professionnelle très riche et variée, mais dans l’économie informelle».
Se pose alors un dilemme: ces expériences parfois nombreuses et multiples dans l’économie informelle ne peuvent pas apparaître sur les CV que la mission locale aide à rédiger, qui seront notamment examinés par Actiris et l’ONEm.
«Mais pour un patron, c’est différent; ces expériences de travail au noir restent attractives, puisque lui, ce qu’il veut, c’est justement de l’expérience.» C’est ce qui a mené cette mission locale à jouer avec les contours de cette zone grise de l’informel, en accompagnant les chercheurs d’emploi dans la rédaction de deux types de CV différents : une version allégée et officielle (pour les offices de l’emploi) et une «informelle», souvent beaucoup plus fournie et détaillée, destinée aux employeurs.
Si une toute petite minorité des personnes qu’accompagne Xavier voit dans le travail au noir une perspective en soi (avec la possibilité d’accommoder ses horaires qu’elle ne trouverait pas dans un emploi «formel»), la plupart y ont plutôt recours en désespoir de cause : «Entre avoir faim et travailler au noir, bien sûr qu’on choisit de travailler, qu’on fait ce qu’on peut pour nourrir sa famille… »
 COMBATTRE LE TRAVAIL NON DÉCLARÉ SANS STIGMATISER LES TRAVAILLEURS/EUSES
COMBATTRE LE TRAVAIL NON DÉCLARÉ SANS STIGMATISER LES TRAVAILLEURS/EUSES
Département politique sociale & bien-être au travail de la FGTB
«Le travail non déclaré est un phénomène complexe qui, effectivement, n’est pas aussi binaire qu’il n’y paraît, confirme la FGTB. Il menace tant l’individu que la société. Il porte atteinte directement aux tra- vailleurs/euses; il instaure une course à la concurrence déloyale qui a un impact tant sur les travailleurs/euses que sur les entreprises. S’ensuit un nivellement par le bas, d’abord informel (dans les faits, sur les lieux de travail) et, potentiellement, institutionnel par la suite (quand la dégradation des droits et des règles est deve- nue la norme).» De plus, «il s’agit bien souvent de l’unique moyen de survivre pour de trop nombreuses personnes». Exemple avec les «grosses» plateformes. Non seulement les travailleurs «ne bénéficient pas de l’ensemble du corpus normatif social auquel elles et ils ont normalement droit, mais, de plus, il s’agit d’un milieu ayant largement recours aux méthodes de travail non déclaré (location de compte(s) à des travailleurs/euses sans papiers par exemple)».
Face à ce phénomène pour le moins ambigu, la position du syndicat est ferme. «Il faut combattre le travail non déclaré organisé et structurel sous toutes ses formes. Et cela sans stigmatiser les travailleurs/ euses, car, si travail au noir il y a, c’est que, derrière, quelqu’un l’organise et c’est bien cette source qu’il faut combattre à tout prix.» Cela passe pour le syndicat, par une série d’actions. Informer les travailleurs/euses, les défendre devant les tribunaux du travail pour réclamer le statut de salarié, porter plainte à l’inspection sociale. Mais aussi alerter les pouvoirs politiques, en exigeant des mesures plus contraignantes, allouer plus de moyens à cette lutte. «Mais il existe de nombreux obstacles à cette lutte, ajoute la FGTB, comme l’isolement de ces travailleurs/euses, la barrière de la langue, la méconnaissance et la complexité des règles applicables, la méfiance envers les autorités et/ou les syndicats, les discours patronaux qu’ils peuvent entendre, la précarité vécue et la volonté d’en sortir ‘coûte que coûte’, les menaces qui pèsent sur eux et leurs familles, l’absence de données fiables quant à l’ampleur du phénomène, le manque de moyens relatifs aux différents services composant l’inspection sociale, le manque de moyens consacrés à la justice, etc.»
En savoir plus
«Prostitution: drôle de drame», Alter Échos n° 494, juin 2021, Pierre Jassogne.
«Travailleurs sans papiers: droit social hors de portée?», Alter Échos n° 440, mars 2017, Marinette Mormont.
«Le marché des exploités», Alter Échos n° 455, novembre 2017, Olivier Bailly.
«Travail saisonnier: le prix de l’exploitation», Alter Échos n° 393, novembre 2014, Cédric Vallet.