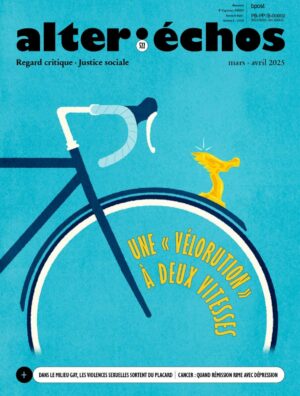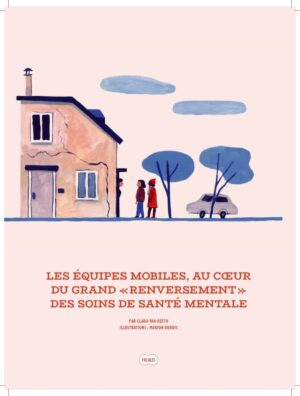«Où le travail finit, la pauvreté commence.» Ces mots peuvent être attribués à Caton l’Ancien, homme politique et écrivain romain, né en 234 av. J.-C. Mais aujourd’hui, on le sait, mettre tout le monde au travail d’un claquement de doigts relève de la gageure. Pourtant, depuis de nombreuses années, «les politiques de lutte contre la pauvreté en Belgique s’inscrivent pleinement dans la philosophie de l’État social actif et en particulier dans le paradigme de l’activation, observe l’économiste François Ghesquière, de l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS). Il s’agit donc davantage de pousser les plus pauvres vers l’emploi pour qu’ils ne dépendent plus de la sécurité sociale ou de l’assistance sociale plutôt que de redistribuer les richesses pour réduire les inégalités».
L’emploi protecteur…
Pour faire le point sur cette question, revenons aux bases: oui, l’emploi permet de limiter le risque de pauvreté monétaire. En 2019, avant la crise Covid, seuls 2% des salariés à temps plein, 7% des salariés à temps partiel et 12% des indépendants se trouvaient sous le seuil de pauvreté monétaire. C’était 39% pour les chômeurs, 17% pour les étudiants et les pensionnés, 24% pour ceux en incapacité de travailler ou encore 57% pour les autres situations sans emploi (les personnes qui recourent au CPAS, mais aussi celles qui n’y ont pas recours). Les rai...
La suite de cet article est réservé à nos abonnés
Abonnez-vous et accédez à l'intégralité de nos contenus et archives en ligne
Déjà abonné ?
«Où le travail finit, la pauvreté commence.» Ces mots peuvent être attribués à Caton l’Ancien, homme politique et écrivain romain, né en 234 av. J.-C. Mais aujourd’hui, on le sait, mettre tout le monde au travail d’un claquement de doigts relève de la gageure. Pourtant, depuis de nombreuses années, «les politiques de lutte contre la pauvreté en Belgique s’inscrivent pleinement dans la philosophie de l’État social actif et en particulier dans le paradigme de l’activation, observe l’économiste François Ghesquière, de l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS). Il s’agit donc davantage de pousser les plus pauvres vers l’emploi pour qu’ils ne dépendent plus de la sécurité sociale ou de l’assistance sociale plutôt que de redistribuer les richesses pour réduire les inégalités».
L’emploi protecteur…
Pour faire le point sur cette question, revenons aux bases: oui, l’emploi permet de limiter le risque de pauvreté monétaire. En 2019, avant la crise Covid, seuls 2% des salariés à temps plein, 7% des salariés à temps partiel et 12% des indépendants se trouvaient sous le seuil de pauvreté monétaire. C’était 39% pour les chômeurs, 17% pour les étudiants et les pensionnés, 24% pour ceux en incapacité de travailler ou encore 57% pour les autres situations sans emploi (les personnes qui recourent au CPAS, mais aussi celles qui n’y ont pas recours). Les rai...
La suite de cet article est réservé à nos abonnés
Abonnez-vous et accédez à l'intégralité de nos contenus et archives en ligne
Déjà abonné ?
En savoir plus
«Où le travail finit, la pauvreté commence.» Ces mots peuvent être attribués à Caton l’Ancien, homme politique et écrivain romain, né en 234 av. J.-C. Mais aujourd’hui, on le sait, mettre tout le monde au travail d’un claquement de doigts relève de la gageure. Pourtant, depuis de nombreuses années, «les politiques de lutte contre la pauvreté en Belgique s’inscrivent pleinement dans la philosophie de l’État social actif et en particulier dans le paradigme de l’activation, observe l’économiste François Ghesquière, de l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS). Il s’agit donc davantage de pousser les plus pauvres vers l’emploi pour qu’ils ne dépendent plus de la sécurité sociale ou de l’assistance sociale plutôt que de redistribuer les richesses pour réduire les inégalités».
L’emploi protecteur…
Pour faire le point sur cette question, revenons aux bases: oui, l’emploi permet de limiter le risque de pauvreté monétaire. En 2019, avant la crise Covid, seuls 2% des salariés à temps plein, 7% des salariés à temps partiel et 12% des indépendants se trouvaient sous le seuil de pauvreté monétaire. C’était 39% pour les chômeurs, 17% pour les étudiants et les pensionnés, 24% pour ceux en incapacité de travailler ou encore 57% pour les autres situations sans emploi (les personnes qui recourent au CPAS, mais aussi celles qui n’y ont pas recours). Les rai...