Deuxième volet de notre série Mécanique de la violence
«Elle marque vite.» Ce constat de malchance, Jean-Louis Simoens, coordinateur de la ligne d’écoute violences conjugales du Collectif contre les violences familiales et l’exclusion (CVFE) de Liège, l’a entendu jusqu’à la nausée. Combien sont-ils à déplorer que leur femme «fasse des bleus» alors qu’ils l’ont à peine «secouée»? Combien sont-ils à considérer être «mal tombés» avec cette victime à la peau trop fine, aux hématomes intempestifs? «Les traces sont insupportables à l’auteur qui ne peut pas intégrer l’idée qu’il agit de la violence sur sa partenaire: cela fragilise son estime de lui, qui est sans doute déjà très faible. Comme il ne peut pas l’admettre, il va transformer la réalité des faits et responsabiliser la victime elle-même», raconte Jean-Louis Simoens. Ce renversement des responsabilités, constamment à l’œuvre dans les violences entre partenaires intimes, fait partie des mécanismes les plus retors: il paralyse non seulement la pensée de la victime, mais aussi celle de l’entourage et parfois même celle des professionnels. Il met au défi l’esprit critique, fait douter de ses propres perceptions, provoque une effraction dont il est difficile de revenir. Douter à perdre la raison, même quand la violence a la couleur bleue.
L’exception à la règle
Tant d’auteurs de violences s’employant à retourner le réel comme un gant inciteraient à se réfugier derrière une règle immuable: l’homme agresse; la femme subit. Mais il nous faut douter encore, et raisonnablement: si la grande majorité des violences sont agies par des hommes à l’encontre des femmes, il est admis par de nombreux acteurs de terrain qu’il existe des cas inverses, aussi minoritaires, aussi inconfortables soient-ils. «Le patriarcat agit à travers nous, hommes ou femmes, de manière permanente. C’est la règle du jeu, mais il y a des exceptions, résume Jean-Louis Simoens. Notre ligne d’écoute est issue d’une association qui prend en charge les femmes victimes; donc, au début, quand un homme victime nous appelait, nous avions tendance à mettre en doute sa parole. Ce n’est plus le cas maintenant. Nous sommes attentifs à l’accueillir.» Fabienne Glowacz, professeure de psychologie et psychologue clinicienne à l’ULiège, met en garde contre les dangers d’une approche comparative. «À chaque fois qu’on va vouloir parler des violences vis-à-vis des hommes, on va avoir tendance à la comparer à la violence vis-à-vis des femmes, ce qui peut aboutir à une logique appauvrie et dangereuse. Elle risque de mettre à mal les avancées majeures de la lutte contre les violences conjugales initiées par les féministes, le cadrage, la reconnaissance et toutes les avancées encore à faire.» La crainte de faire le jeu des mouvements masculinistes participe probablement au peu de visibilité que les chercheurs ont aujourd’hui sur ces situations. «Des études commencent à paraître sur ce sujet, mais nous sommes au début. Ce qu’on peut dire, c’est qu’on est dans des proportions bien moindres que dans le champ des violences faites aux femmes. Quant au type de violence, il peut s’agir de violences psychologiques qui vont prendre la forme de dénigrement, de menaces avec, comme pour les femmes, le message sous-jacent du ‘tu ne vaux rien’ ou ‘tu n’es pas’, l’atteinte à l’identité, qu’elle soit masculine, professionnelle, parentale», détaille Fabienne Glowacz. Les violences physiques agies par des femmes prendront souvent la forme de griffures, de morsures, de gifles, avec des configurations allant des violences situationnelles (conflit qui dégénère en violence) à l’emprise, ici encore sans frontière sociale et sans limite d’âge.
«À chaque fois qu’on va vouloir parler des violences vis-à-vis des hommes, on va avoir tendance à la comparer à la violence vis-à-vis des femmes, ce qui peut aboutir à une logique appauvrie et dangereuse.» Fabienne Glowacz, professeure de psychologie et psychologue clinicienne à l’ULiège
Au milieu des nombreuses femmes qu’elle reçoit, Sarah, assistante sociale au Service d’assistance policière aux victimes (SAPV) de Fléron (Liège), a vu arriver l’autre jour un homme de 83 ans: enfermé et violenté par sa femme également octogénaire, il ne devait son salut qu’à l’initiative de sa fille de reprendre contact avec lui et qui l’accompagnait ce jour-là au commissariat. Sarah estime que «l’ego, le déni, la honte» sont autant de freins qui empêchent les hommes de parler, qu’ils soient en couple hétéro ou homosexuel. «Il existe une difficulté à chercher de l’aide, car cela va vraiment à l’encontre des stéréotypes et des attentes que l’on peut avoir vis-à-vis de la masculinité», estime Fabienne Glowacz. La prise de conscience se fera souvent à la faveur – comme pour les femmes d’ailleurs, mais dans des proportions probablement plus importantes encore – d’une plainte de santé physique ou mentale qui amènera à consulter un professionnel. «On vient parce qu’on n’est pas bien, poursuit Fabienne Glowacz. Mais ensuite, au cours du travail psychologique, le couple apparaît et la possibilité de dégager les dynamiques qui relèvent de la violence, loin de l’image stéréotypée de la violence extrême: le non-respect de l’autre, l’entrave à sa liberté, sa dévalorisation, sa disqualification.» Le dessillement est toujours graduel, douloureux, marqué par des reculs et des ambivalences. «Sortir d’une relation violente est un long processus.»
Solidarité masculine
Considérer ces exceptions n’est pas le premier pas vers le relativisme, mais la permission de penser séparément le système et les individus. «Le patriarcat est un fléau, estime Jean-Louis Simoens. Mais il faut que les hommes intègrent que le patriarcat, ce n’est pas eux! Ils sont construits sur ce patriarcat, mais ils n’ont pas la responsabilité de toute l’histoire de l’humanité, seulement des actes qu’ils posent maintenant. Ce qui dysfonctionne, c’est le système, et pas les hommes parce qu’ils sont des hommes. Il faut inviter les hommes à réfléchir là-dessus et à prendre leur destinée en main.» Karim fait partie de ceux qui ont répondu à l’appel. Formé à la pratique philosophique et actif dans l’éducation permanente, il anime un groupe de parole pour les hommes autour des questions de masculinité dans le cadre de «Quartier libre», une initiative mise en place par le CVFE dans le quartier Saint-Léonard (Liège) pour sensibiliser aux violences conjugales. Né à Gennevilliers, en banlieue parisienne, Karim a commencé à s’intéresser au féminisme lorsqu’il s’est mis en couple, et plus encore à la naissance de sa fille. «Quand j’ai compris que les femmes rentraient le soir avec leurs clefs dans la main au cas où elles devraient se défendre, ou en faisant semblant de parler au téléphone, je suis tombé de haut. Ma fille a 5 ans, je me dis que j’ai huit ans pour que les choses changent», raconte-t-il. Ancien rugbyman, le quarantenaire confie qu’une des plus grandes difficultés dans ce cheminement est le renoncement à une forme de «solidarité masculine». Prochainement invité à participer à un week-end de retrouvailles avec ses ex-coéquipiers, Karim hésite. Les échanges de photos homophobes, de vidéos pornos et de blagues sexistes sur le groupe WhatsApp de la bande le mettent de plus en plus mal à l’aise. «Le rugby a été très important pour moi. J’en fais depuis que j’ai 15 ans, cela m’a permis de m’intégrer, de me sentir valorisé. Mais là…» Le dilemme patriarco-amical se pose d’ailleurs tous les jours, comme avec cet ami proche devenu masculiniste après que sa femme l’a quitté. «Je pourrais dire que j’étais plus tranquille avant, quand je vivais innocent de ces questions, mais ce ne serait pas vrai, estime Karim. Je pense que j’ai un rapport plus authentique aux autres, hommes et femmes, depuis que je me suis dégagé de cette identité d’homme qui doit faire le coq.»
«Le patriarcat est un fléau. Mais il faut que les hommes intègrent que le patriarcat, ce n’est pas eux!» Jean-Louis Simoens, CVFE
La haine de l’amour
Si la plupart des violences entre partenaires intimes respectent l’injuste règle du jeu, elles peuvent aussi la transgresser et la dynamiter, parfois jusqu’à la rendre totalement illisible. «Nous avons des conjoints qui viennent porter plainte l’un contre l’autre à tour de rôle et souvent à plusieurs reprises», raconte Sarah, qui se répartit alors les plaignants avec Marie-Ange, sa collègue du SAPV. «Dans la plupart des cas, on arrive quand même à voir rapidement qui est la victime», estime-t-elle. Mais, parfois, la situation est plus trouble. Entre celui qui veut sauver sa peau et celui qui veut la peau de l’autre, la frontière devient floue. La domination à sens unique laisse place à une parfaite réciprocité dans l’emprise: c’est ce que les psychiatres suisses Maurice Hurni et Giovanna Stoll ont décrit de manière édifiante dans La haine de l’amour (L’Harmattan, 1996) où ils témoignent du fonctionnement de ces couples fermement unis par un lien perverti: celui d’un pacte tacite contre la tendresse dont les enfants et l’entourage feront les frais. Anciennes victimes de parents eux-mêmes abusifs (abus sexuels ou narcissiques), ces conjoints se choisissent dans le but implicite de perpétuer, sous les apparences de la plus parfaite normalité, le cycle tragique de la violence. Gare à qui voudra s’en extraire. Geneviève le sait bien, elle qui fut la troisième fille non désirée d’une mère malheureuse et cruelle, qui lui a toujours conseillé de «mordre sur sa chique» et de ne pas «détruire la famille» en quittant son mari, comme si la destruction massive n’était pas entamée depuis plusieurs générations. Alcoolisme, morts violentes, adultères sous le tapis, humiliations systématiques, annihilations des subjectivités: Geneviève a compris depuis sa thérapie que la violence est souvent une funeste «tradition familiale». Désormais grand-mère – la trottinette au milieu du salon en témoigne –, elle pleure encore d’avoir laissé se prolonger son second mariage terrible sous les yeux de sa fille et de son fils. «Je m’accroche au noyau infracassable de moi-même», dit-elle. D’autres parlent de la part indemne, cette part en nous jamais damnée – qui n’a pas de genre et échappe à l’enfer.
Mécanique de la violence Un dossier réalisé avec le soutien du Fonds pour le journalisme Longtemps invisibilisées et minimisées, les violences entre partenaires intimes répondent à des logiques complexes, hétérogènes, mais néanmoins repérables et analysables. Alter Échos propose une exploration en trois volets des mécanismes qui enferment dans la violence, mais aussi de ceux qui permettent d’en sortir. Démonter la machine, comprendre les rouages, espérer des jours meilleurs.
En mai: Un début insidieux
En juin: Le patriarcat comme règle du jeu
En juillet: Renaître




















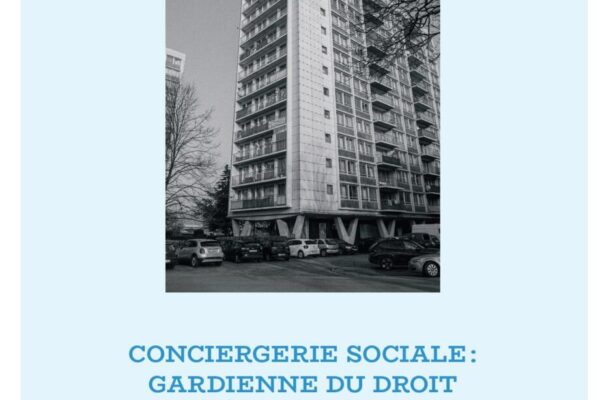
L’ex-mari d’Aline, lui, n’a jamais douté. Puisqu’elle se plaignait d’être battue à mort, il lui a conseillé d’aller se pendre. Elle ne l’a pas fait et s’est retrouvée un revolver sur la tempe. «Rien ne l’arrête», raconte cette mère de deux ados chez qui la police a installé verrous et caméras: «On n’est rien et eux ont tous les droits. C’est ça le patriarcat.» Comme celui d’Aline, l’ex-mari de Geneviève venait d’une famille où les hommes étaient rois et la mère au service, à beurrer les tartines des quatre fils jusqu’à leur cinquantaine révolue. Un modèle de vie construit autour de la figure du «patriarche accumulateur» et glorieusement exhibé à travers les biens matériels, la reconnaissance sociale. «Jusqu’à ce que je le quitte, ma vie c’était ‘avoir’. Maintenant, ma vie c’est ‘être’», résume cette survivante, partie il y a cinq ans avec deux sacs-poubelle de vêtements et un album photo.