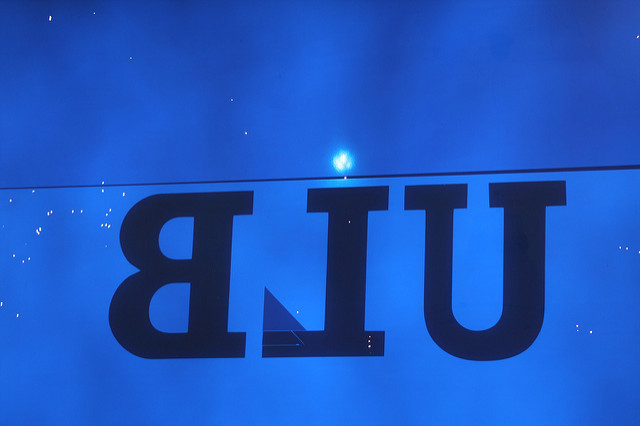Les universités et les hautes écoles font de plus en plus appel à des services privés pour gérer leurs services, que ce soit la restauration, le nettoyage ou même le logement. La formation n’est pas épargnée par cette privatisation. Tour d’horizon des menaces qui pèsent sur le paysage de l’enseignement supérieur.
Article publié dans Alter Échos n°427, 15 juillet 2016 (découvrir le dossier complet « privatisation »)
Il y a dix ans encore, les étudiants de l’ULB pouvaient prendre leur repas de midi au dénommé Campouce. Étudiants et personnel engagés par l’université faisaient tourner cette cantine. Aujourd’hui, sa gestion est aux mains de l’entreprise de restauration Sodexo. Le nettoyage est également assuré par une entreprise privée. Martin Casier, adjoint au vice-recteur aux affaires étudiantes, à la politique sociale et aux relations institutionnelles, justifie l’externalisation de ces services par l’argument économique – «ça coûte moins cher à l’université» – et celui de la gestion. «C’est très compliqué pour l’ULB d’organiser, de contrôler et de gérer un service de nettoyage ou de restauration», explique-t-il.
Économique pour l’université, rentable à coup sûr pour les entreprises, mais, explique Brieuc Wathelet, président de la Fédération des étudiants francophones, «cela implique inévitablement une augmentation des coûts pour l’étudiant», pour un sandwich… Ou pour un logement. Ce service est aussi touché par la privatisation depuis plusieurs années sur les différents campus universitaires.
En 2012, plusieurs collectifs d’étudiants de l’ULB avaient protesté contre la décision du conseil d’administration de l’université d’attribuer le marché de la rénovation de l’une de ses résidences universitaires à un promoteur immobilier pour un bail emphytéotique d’une durée de 27 ans. En deux mots, un système d’emphytéose fonctionne comme un prêt hypothécaire: l’ULB confie la restauration ou la construction d’un immeuble à une entreprise privée, en échange d’une somme d’argent qu’elle lui rembourse chaque année. «L’ULB est incapable aujourd’hui d’assurer sur fonds propres les frais de rénovation des kots étudiants. L’emphytéose était préférable à l’emprunt bancaire sur le plan économique», explique Martin Casier. Il réfute le terme de «privatisation», justifiant que «la gestion du logement reste interne à l’ULB. L’université garde la main sur l’attribution des logements, sur les loyers, sur l’ensemble de la maintenance technique des résidences avec son personnel propre». Quant au loyer, il s’est aligné sur celui des résidences universitaires plus neuves. «Nous travaillons sur la mise en place d’une ligne budgétaire dans son enveloppe sociale dont l’objectif sera de compenser cette différence», indique-t-il, «on est un service public, faire du profit n’est donc vraiment pas notre but». Pour la FEF qui préconise de longue date la construction de logements publics pour les étudiants, donner les clefs au privé conduit inéluctablement à une augmentation des prix pour les étudiants. «Les partenariats public-privé sont dangereux. Qu’en est-il du loyer? Qu’en est-il des conditions de bail», interroge Brieuc Wathelet.
12.000 euros de minerval
Autre domaine où les étudiants doivent mettre la main au portefeuille: le minerval. Il est gelé pour les étudiants belges et de l’Union européenne à 835 euros depuis 2011. Mais les étudiants étrangers hors UE qui s’inscrivent dans les universités ou hautes écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pourraient devoir s’acquitter d’un minerval de 12.000 euros dès 2017, soit 15 fois le minerval classique. Jusqu’alors, les établissements étaient autorisés à réclamer jusqu’à cinq fois le minerval en vigueur, soit un maximum de 4.175euros pour une année d’études. Cette possibilité de multiplier le minerval jusqu’à 15 fois, demandée par les recteurs, est rendue possible par le nouveau Décret Refinancement, adopté fin mai 2016. Échappe à l’augmentation la liste des pays dits «Least Developped Countries» qui compte notamment l’Afghanistan ou la Somalie. En revanche, l’université pourrait appliquer la mesure pour les étudiants issus d’autres «pays en voie de développement», qui devaient jusqu’à présent s’acquitter d’un montant avoisinant les 2.000 euros.
«Les étudiants et étudiantes concernés, dont beaucoup proviennent de régions pauvres du monde doivent payer de manière injustifiée la vénalité des autorités», dénonce Hugo Périlleux Sanchez, du Collectif du Libre Business. Créé par plusieurs étudiants pour dénoncer la marchandisation de l’université, le collectif a mené une campagne d’affichage sur tout le campus en signe de protestation contre cette mesure. «Quand on augmente le minerval et que les étudiants doivent payer des sommes astronomiques pour payer leurs études, c’est de la privatisation, et on voit ce mouvement dans toute l’offre de l’enseignement supérieur», s’inquiète de son côté Brieuc Wathelet, soulignant que «le plus grave est que Marcourt précise cette disposition dans un décret de refinancement des études supérieures. Ce qui veut dire qu’il considère que le financement des universités doit passer par la poche des étudiants…» Le ministre de l’Enseignement supérieur s’en défend, expliquant qu’il est fermement opposé à l’idée de marchandisation, prenant pour preuve le refinancement de 107 millions d’euros récemment dégagés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans le contexte d’un enseignement supérieur définancé depuis 20 ans (puisqu’il a vu une augmentation constate du nombre d’étudiants dans un système d’enveloppe fermée), cette mesure est selon lui «proportionnée au regard des enjeux de financement qui influencent la qualité de l’enseignement pour la centaine de milliers d’étudiants belges et européens qui continuent à bénéficier d’un minerval à 835 euros». Pour la FEF, l’argument du manque d’argent ne passe pas. «Un financement public à 100% est possible. C’est une question de priorités politiques», affirme Brieuc Wathelet.
Quand le marché dicte la formation
L’enseignement à proprement parler est-il épargné par la privatisation? «De plus en plus, on voit fleurir des institutions universitaires étrangères privées qui offrent des diplômes non reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles», observe Brieuc Wathelet. Il cite l’exemple de l’Université de Manchester qui ouvre avec l’EPHEC, haute école économique et technique bruxelloise, un «Master Degree en business management» de 60 crédits. Coût: 6.930 livres pour les Belges (environ 8.300 euros), le double pour les internationaux. «Une institution subsidiée par les pouvoirs publics va donc, dans ses locaux, avec son personnel administratif, accueillir une formation non reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, s’indigne le président de la FEF, cette dernière ne détient pas d’outils juridiques pour l’instant pour empêcher ça, ce qui veut dire que, dans une dizaine d’années, la valeur du diplôme pourrait être commandée par la valeur que lui donne le marché du travail…», s’indigne le président de la FEF. Jean-Claude Marcourt a demandé début juillet à l’établissement d’avertir les étudiants que la formation ne serait pas reconnue, comme l’avait pourtant communiqué la haute école. «Il a aussi été demandé officiellement au commissaire du gouvernement de s’assurer qu’aucune subvention publique n’y soit consacrée. Un rapport complet concernant plusieurs questions portant sur l’intervention du personnel de la haute école ainsi que sur le financement de la publicité a également été exigé», nous assure-t-on au cabinet Marcourt.
Flagrante dans le cas de cette formation, l’arrivée du privé dans l’enseignement supérieur se fait parfois plus subtile. On peut par exemple s’interroger sur l’existence de chaires universitaires financées par des entreprises: Chaire Danone, Chaire BNP,… Certaines ne portent pas directement le nom d’une marque mais sont créées par des fondations composées des actionnaires de grandes entreprises de Belgique. Si les universités assurent que la liberté et l’indépendance académiques sont garanties, la FEF redoute «que ces chaires ne remplacent peu à peu les cours classiques». Aussi, ajoute Brieuc Wathelet, «comment ne pas craindre que les mécènes de ces chaires ne visent en fait qu’à créer le futur personnel de leurs entreprises plutôt que des étudiants critiques et émancipés?» Le collectif de l’Université du Libre Business adopte ce même questionnement à l’égard du bâtiment de Solvay, qui n’aurait pas pu voir le jour sans de nombreux mécènes (comme Dexia, Belgacom ou des financeurs privés). «Comment être sûr que ces entreprises ne veulent pas quelque chose en retour?», se demande Hugo Périlleux Sanchez.
Si l’on en croit nos deux interlocuteurs, nous ne sommes pas encore dans un système où l’offre de formation est privatisée mais on observe une perte de terrain des pouvoirs publics et une libéralisation croissante de l’enseignement. Avec comme risque que le savoir dispensé vise davantage à l’obtention d’un emploi qu’à l’acquisition d’une posture critique. Selon Hugo Périlleux Sanchez, la nomination récente de Pierre Gurdjian, ancien consultant pour le cabinet international McKinsey & Company, au poste de président du CA ne fait que confirmer ce glissement. «L’Université du Libre Examen se transforme petit à petit en Université du Libre Business. Pour atteindre ses objectifs de compétitivité et de rentabilité, elle abandonne son indépendance et son esprit critique», estime-t-il. Et de pointer la responsabilité des «rankings»: «Les universités veulent être au top de ces classements. Or, ils mettent en compétition les institutions d’enseignement supérieur, sur la base de critères d’excellence principalement liés au nombre de publications en anglais des chercheurs et chercheuses, principalement des revues de sciences économiques ou sciences dures ou encore aux prix décernés, mais pas sur la qualité et de l’accessibilité de l’enseignement.» Il en résulte selon lui une mise en valeur des filières rentables aux yeux du marché comme l’ingénierie au détriment des facultés de sciences humaines.
Contre cette «Excellence» au sens managérial, des professeurs de l’ULB, exclusivement de sciences humaines, ont créé un groupe de soutien, de réflexion et de résistance baptisé les Désexcellents. «Nous avons lancé ce groupe en 2011 face à un constat: on est amenés à produire plus en moins de temps pour répondre aux injonctions et aux indicateurs d’excellence. Avec comme conséquence une baisse de la qualité et une dévalorisation des savoirs critiques», expliquent Chloé Deligne et Olivier Gosselain, historienne et anthropologue «désexcellents».
Ils utilisent avec des pincettes les termes de «marchandisation» ou de «privatisation». «Il y a une série de mesures mises en place à l’université pour la faire fonctionner comme une boîte privée, mais l’université reste un service public», explique Olivier Gosselain. Et de citer à titre d’exemple le fait qu’il puisse toujours, à ce jour, donner des cours d’anthropologie dans le bâtiment Solvay. Tous deux préfèrent évoquer le terme de «sectorisation». L’enseignement, service public, s’organise de plus en plus comme un «secteur marchand». «Il doit se trouver de nouvelles règles: offre de produits pour assurer la compétitivité, nouvelles compétences et apparitions de nouveaux acteurs marchands comme des managers ou des consultants qui vont développer une offre en éducation», explique Chloé Deligne. Dans la pratique, cela passe par la mise en concurrence des chercheurs, la production effrénée au détriment de la qualité, la disparition progressive de la recherche fondamentale au profit de la recherche appliquée («qui doit donner des résultats»), la mise en place de cours qui visent à l’employabilité des étudiants… Autant d’éléments qui amènent Olivier Gosselain à considérer que «l’université devient une machine de reproduction de l’ordre social plutôt que de transformation».
En savoir plus
«Allocations d’insertion : il faudra étudier vite», Alter Echos n°399, mars 2015, Julien Winkel
«TEC : à mi-chemin de la privatisation?», Alter Echos N°427, juillet 2016, Martine Vandemeulebroucke
«PPP : «Bruxelles recherche terrains désespérément»», Alter Echos N°427, juillet 2016, François Corbeau
«Marchandisation de l’accueil des demandeurs d’asile: stop ou encore?», Alter Echos N°427, juillet 2016, Marinette Mormont