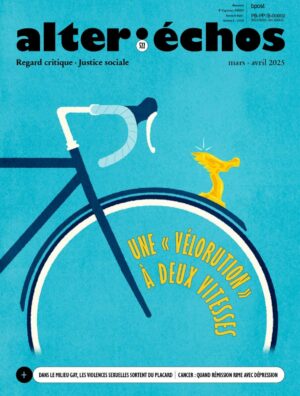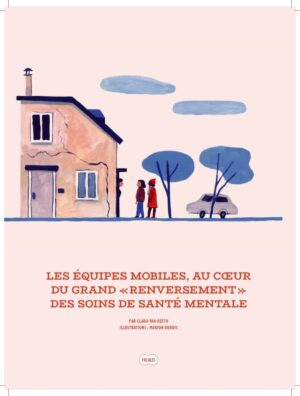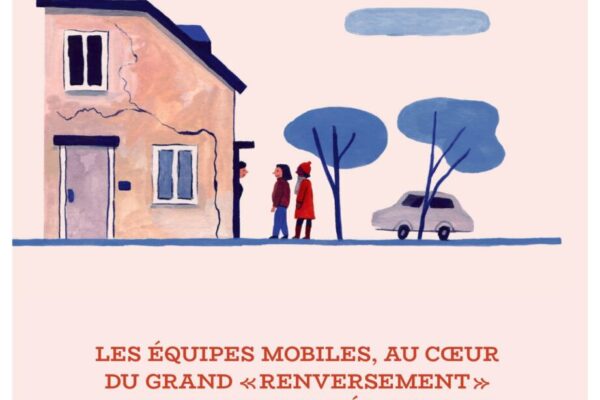Cheffe du service des urgences au CHC, en région liégeoise, la Dre Michèle Yerna est constamment sur la brèche. Vieillissement de la population, difficultés socioéconomiques, système médical peu adapté à la prise en charge non programmée: les urgences ne désemplissent jamais. En 2022, un Belge sur cinq s’y était rendu au moins une fois, un chiffre qui n’a cessé d’augmenter au cours des dix dernières années[1]. Parallèlement, les médecins urgentistes se font toujours plus rares, au point de menacer la pérennité de certains services. «Le CHC a quatre implantations: Hermalle, Heusy, Waremme et MontLégia. L’année dernière, faute de main-d’œuvre médicale qualifiée, on a dû réorganiser le service d’urgences de la clinique d’Heusy qui ne pouvait plus répondre aux normes strictes d’un service spécialisé», explique la Dre Michèle Yerna.
Triples zéros
Pour Michèle Yerna, pas de doute: la médecine hospitalière ne fait plus rêver les jeunes médecins. «Travailler dans un hôpital rapporte moins d’argent que d’exercer dans un cabinet privé. La fonction hospitalière a aussi parfois quelque chose d’ingrat, de peu valorisé. Il faut faire des tours de salle, des gardes…» Le constat est d’autant plus vrai pour les spécialités à haute pénibilité comme les urgences, qui cumulent les horaires difficiles, les contraintes physiques, un niveau élevé de risques et de stress. «Initialement, les autorités belges avaient instauré un cadastre des spécialités dites en pénurie pour lesquelles on ne limitait pas le nombre de formations, explique la Dre Michèle Yerna. La médecine d’urgence, la pédiatrie, la pédopsychiatrie ou encore la gériatrie en faisaient partie. Mais ensuite, les autorités fédérales ont estimé qu’il y avait assez de médecins formés, malgré les alertes des associations de médecins urgentistes et des doyens d’université.» La cause de ce «mauvais calcul»? Si, sur le papier, le nombre de médecins urgentistes formés en Belgique paraît suffisant, dans les faits, beaucoup se détournent rapidement de l’activité clinique pour poursuivre leur carrière dans l’enseignement, la recherche ou le management d’hôpital. Ceux qui restent ne veulent plus faire les horaires d’autrefois. «Les médecins urgentistes que j’engage mettent tous en avant l’équilibre avec la vie personnelle. Ici, on a pour habitude de considérer qu’un temps plein, c’est 50 heures semaine. Mais aujourd’hui, la plupart des jeunes médecins veulent plutôt un temps plein de 40 heures ou un mi-temps», poursuit la cheffe de service. Or la pénurie engendre la pénurie: «Les gens n’ont pas envie de venir travailler là où il y a de gros besoins, car ils ont peur d’être surexploités.»
«Initialement, les autorités belges avaient instauré un cadastre des spécialités dites en pénurie pour lesquelles on ne limitait pas le nombre de formations. La médecine d’urgence, la pédiatrie, la pédopsychiatrie ou encore la gériatrie en faisaient partie. Mais ensuite, les autorités fédérales ont estimé qu’il y avait assez de médecins formés, malgré les alertes des associations de médecins urgentistes et des doyens d’université.»
Michèle Yerna, cheffe du service des urgences au CHC de Liège
Le recours aux recrues étrangères est donc devenu «indispensable». «Aujourd’hui, le système ne peut absolument pas s’en passer», résume la Dre Michèle Yerna. Les situations de ces professionnels sont par ailleurs très hétérogènes. D’un côté, on retrouve des médecins qui étaient déjà médecins urgentistes dans leur pays et qui souhaitent obtenir une équivalence en Belgique pour cette spécialité grâce à des stages de formation complémentaire: dans le service de la Dre Michèle Yerna, quatre médecins roumains et un médecin portugais sont actuellement dans ce cas. «C’est la situation idéale, explique-t-elle, car ces médecins sont vraiment ‘dans les clous.’» De l’autre, des médecins «triples zéros», c’est-à-dire des médecins qui ont obtenu une équivalence pour leur diplôme de médecine de base et qui travaillent aux urgences de manière transitoire, en attendant de faire reconnaître leur spécialisation ou de décrocher un plan de stage dans leur domaine. Ils héritent donc dans un premier temps d’un code Inami dépourvu des trois derniers chiffres indiquant une spécialité – d’où leur désignation peu flatteuse de «triples zéros». Cette nomenclature limite drastiquement le type d’actes qui peuvent être posés sous leur responsabilité, et donc leur rémunération. Souvent cantonnés à assurer la surveillance hospitalière, ces médecins permettent pourtant la survie d’équipes en sous-effectif chronique. «Les triples zéros sont encadrés comme des assistants de première année, c’est-à-dire comme des médecins qui commencent leur spécialisation. On ne peut pas leur donner les mêmes prérogatives qu’à des médecins spécialistes, raconte la Dre Michèle Yerna. Il y a des médecins qui viennent d’un peu partout, que ce soit d’Afrique du Nord, d’Europe de l’Est, d’Amérique du Sud… Ils arrivent en Belgique parce qu’ils connaissent la bonne réputation de son système de santé, mais leur vocation n’est pas nécessairement la médecine d’urgence. Et pour nous, c’est parfois plus difficile d’évaluer leur véritable expérience clinique. Parfois, on est enchanté, mais il y a toujours une incertitude.»
Société privée de recrutement
Pour combler le manque de personnel médical qualifié, les institutions de soins peuvent aussi faire appel à des sociétés privées de recrutement. «Nous avons une politique de recrutement très volontariste, confirme la Dre Michèle Yerna. C’est-à-dire que nous avons une offre d’emploi ouverte en permanence, mais aussi des partenariats avec des sociétés comme Moving People.» Société belge spécialiste de l’expatriation pour les professions médicales, Moving People propose un service «all-inclusive» mettant en relation des établissements de santé avec des candidats européens répondant au profil recherché. «Logiciel performant» de matching et «satisfaction garantie»: tels sont les crédos de l’entreprise. «Nous avons développé un système informatique qui assure un standard de qualité quels que soient le pays d’origine, d’expatriation ou le type d’établissement de santé: hôpital, clinique, maison médicale, cabinet privé, polyclinique, cabinet dentaire, etc.», explique Moving People sur son site. Mais encore: «Pour tous nos recrutements, nous nous engageons contractuellement à présenter un praticien répondant au profil recherché dans un délai déterminé en amont et à garantir 12 mois de prestations au minimum.» L’agence qui existe depuis 2005 met par ailleurs en avant la pertinence de ses «pays de sourcing», choisis pour «la qualité de la formation du personnel médical» et «la proximité culturelle et linguistique». Entendez notamment la Roumanie, un pays francophile qui a longtemps formé deux fois plus de médecins que nécessaire par rapport à ses besoins, mais aussi le Portugal ou encore la Grèce, où les perspectives de carrière demeurent dans certaines régions très limitées.
Selon les chiffres de l’OCDE (Organisation de coopération et développement économique), le nombre de médecins étrangers travaillant en Belgique a doublé en 11 ans.
Médecin dans le service de gériatrie de la clinique CHC MontLégia, la Dre Kyriaki Panagiotopoulou est arrivée en Belgique il y a six ans avec son mari et ses deux enfants. Une migration qu’elle ne qualifie pas d’économique: à Athènes, cette médecin que l’on complimente chaque jour pour son joli français, avait un bon travail. Mais à l’aube de sa quarantaine, elle a rencontré des recruteurs de Moving People lors d’un salon de l’emploi. Elle leur a laissé son CV; ils l’ont rappelée une heure plus tard. «Je suis diplômée de médecine interne de l’université d’Athènes et j’ai aussi fait deux ans de spécialité en gériatrie à l’université de Reims, en France, une spécialité qui n’existe pas en Grèce. Je me suis dit que c’était l’occasion d’exercer la spécialité qui m’intéressait vraiment.» Alors qu’elle s’inquiète de ne pas maîtriser assez la langue pour tenter l’aventure de l’expatriation, Moving People propose à la Dre Kyriaki Panagiotopoulou de lui payer d’abord un an et demi de cours de français, ce qui achèvera de la convaincre. «Je suis contente des conditions de travail en Belgique, raconte-t-elle, si ce n’est qu’aujourd’hui je travaille dans un service de gériatrie, mais avec un numéro Inami d’interniste, à un barème qui est moins valorisé.» La Dre Kyriaki Panagiotopoulou a donc fait une demande d’équivalence auprès de la Commission d’agrément – il en existe une pour chaque spécialité médicale. Prochainement, on devrait donc lui indiquer si – et à quelles conditions – elle peut faire reconnaître son titre de gériatre. «Pour moi, cette reconnaissance est importante, à la fois d’un point de vue financier, mais aussi parce que je crois sincèrement que je suis surqualifiée: non seulement je suis formée, mais je travaille dans un service spécialisé depuis six ans… S’ils me disent que je dois refaire une seule année dans un hôpital universitaire, pourquoi pas. Mais si je dois refaire deux ou trois ans, je n’accepterai pas. Dans ce cas-là, je n’exclus pas de retourner en Grèce.»
Numerus clausus
Selon les chiffres de l’OCDE (Organisation de coopération et développement économique)[2], le nombre de médecins étrangers travaillant en Belgique a doublé en 11 ans. Ils sont aujourd’hui environ 10.000 dans notre pays, soit environ 14% de l’ensemble des médecins alors qu’au début des années 2000, seuls quatre médecins belges sur 100 étaient formés à l’étranger. Si les médecins venus de France et des Pays-Bas occupent les deux premières places avec respectivement 1.620 et 1.590 médecins travaillant en Belgique, la Roumanie se situe juste derrière avec 1.558 médecins, suivis par des médecins venus d’autres pays d’Europe de l’Est, du Sud, mais aussi du continent africain. Pour l’OCDE, le phénomène fait partie de l’internationalisation des carrières médicales et ne peut être complètement évité «mais les pays ne doivent pas devenir dépendants de la migration pour répondre à leurs besoins». L’organisation souligne par ailleurs que ce phénomène «risque d’aggraver les pénuries dans les pays d’origine».
«Nous avons des personnes qui arrivent ici et qui nous disent ‘j’étais chirurgien dans mon pays’ ou ‘j’ai travaillé quatre ans dans un centre de médecine générale en Roumanie’. Néanmoins, les standards ne sont pas les mêmes et même si nous voyons cette diversité comme une richesse, les commissions et les universités sont sur la même longueur d’onde: nous accordons très peu de dispense.»
Dr Didier Giet, président du Département de médecine générale de l’ULiège et président du Conseil de médecine générale
Bien sûr, ce phénomène de migration internationale des professionnels de la santé – médecins, mais aussi infirmiers – ne concerne pas seulement la Belgique. Néanmoins, il a été particulièrement exacerbé dans notre pays par les effets du numerus clausus qui, depuis une vingtaine d’années, fixe un quota maximum d’étudiants en médecine. «On considère que pour 10 millions d’habitants, il faut former environ 1.000 nouveaux médecins par an, résume le Dr Elie Cogan, professeur émérite de l’ULB et président du Conseil supérieur des médecins spécialistes et médecins généralistes. Quand il y a vingt ans, on a serré la vis à 700 nouveaux médecins par an – soit 300 de moins que nécessaire –, on avait déjà des indices que l’on se trouvait en pénurie…» À l’époque, l’hypothèse des autorités – et d’une partie de la profession – était que l’offre créait la demande: pour réduire les dépenses de santé – mais aussi pour que les médecins ne «bradent» pas leurs prestations dans un contexte de suroffre –, il fallait réduire le nombre de praticiens et donc l’accès aux études de médecine.
«Bidon», vilipende aujourd’hui le Dr Gilbert Bejjani, vice-président de l’Absym – le plus grand syndicat de médecins du pays – et président de l’Absym Bruxelles. «Il faut exploser le numerus clausus: la Belgique est largement en deçà de sa capacité à former des médecins. On ne peut pas à la fois empêcher des jeunes de se former en Belgique et aggraver structurellement la pénurie sans rien faire pour contrôler le volume de soins», tempête-t-il, s’insurgeant que les équivalences de diplômes de médecine de base soient distribuées «de façon quasi automatique», y compris pour les diplômes obtenus en dehors de l’espace économique européen. Jusqu’à la dernière réforme de l’État, en 2012-2014, l’équivalence de diplômes de base de médecine pour les médecins hors UE était en effet rarement accordée: il leur fallait généralement refaire une partie ou l’entièreté du cursus. Mais depuis que cette équivalence est à solliciter non plus au niveau fédéral, mais auprès de l’une des Communautés, la procédure a été largement facilitée, en particulier du côté flamand. Une fois obtenue l’attestation d’équivalence, il ne reste plus au médecin qu’à introduire une demande d’autorisation d’exercice de la profession auprès du ministre de la Santé publique: il reçoit alors par arrêté royal l’autorisation de pratiquer l’art médical en Belgique.

Qualité des soins
Pour le président du Conseil supérieur des médecins spécialistes et médecins généralistes Elie Cogan, il s’agit là d’une procédure «scandaleusement légère»: «À notre sens, il y a un gros problème de protection de la population», avance-t-il. Pour le Dr Gilbert Bejjani, «il y a des cas avérés de mauvais médecins». Inquiets pour la «qualité des soins», ces deux interlocuteurs citent le contre-exemple des Pays-Bas, où l’obtention de l’équivalence du diplôme de médecine de base fait l’objet d’une procédure particulièrement stricte de contrôle et d’évaluation. «La procédure coûte à l’État environ 7.000 euros par médecin, détaille le Dr Elie Cogan qui a eu l’occasion d’échanger avec ses homologues néerlandais. Mais ils sont ensuite assurés d’avoir affaire à un médecin de qualité. Or s’ils avaient dû le former eux-mêmes, ça leur serait probablement revenu 10 fois plus cher. Ce n’est donc pas si exorbitant.»
En Belgique, une fois obtenue l’équivalence pour leur diplôme de base, les médecins étrangers doivent encore faire reconnaître leur spécialité auprès de la commission d’agrément correspondante ou accomplir leurs années de spécialisation dans le pays. S’ils ne le font pas, ils resteront «triples zéros», ce qui les cantonne à la surveillance hospitalière ou les destine à une carrière dans la santé publique ou la médecine du travail. Cette année, à côté des 65 assistants diplômés de son université, le Dr Didier Giet, président du Département de médecine générale de l’ULiège et président du Conseil de médecine générale, accueille ainsi 15 assistants ayant obtenu leur diplôme de médecine de base à l’étranger. «Depuis une bonne quinzaine d’années, je reçois un nombre de demandes très important d’assistants étrangers qui veulent faire leur spécialisation de médecine générale en Belgique, raconte-t-il. Il y a clairement une impression d’appel d’air liée au numerus clausus. Mais de 2019 à 2023, comme nous avions à gérer énormément de candidats du fait de la double cohorte (résultat du raccourcissement de la formation initiale en médecine de sept à six ans, NDLR), j’ai fermé le robinet d’accueil. Aujourd’hui, j’ai rouvert la porte. Nous n’avons pas de quotas: si les conditions leur conviennent, ils peuvent venir. Bien sûr, il y a des moments où je me dis que les pays d’où viennent ces médecins auraient bien besoin d’eux, mais en même temps, leur statut médical sera bien mieux rémunéré ici. Qui suis-je pour juger?» A contrario des inquiétudes de l’Absym ou du Conseil supérieur des médecins spécialistes et médecins généralistes, le Dr Didier Giet dit constater peu de carences au niveau de la formation de base de ces assistants étrangers. Pour lui, les filtres sont efficients et surtout, «beaucoup de choses s’apprennent sur le tas…»: «Ç’aurait été de ma responsabilité d’universitaire de ne pas poursuivre la démarche si certains candidats me paraissaient ne pas mériter le titre de médecin», rassure-t-il. En revanche, la sévérité des commissions d’agrément concernant les spécialités lui paraît justifiée: «Nous avons des personnes qui arrivent ici et qui nous disent ‘j’étais chirurgien dans mon pays’ ou ‘j’ai travaillé 4 ans dans un centre de médecine générale en Roumanie’. Néanmoins, les standards ne sont pas les mêmes et même si nous voyons cette diversité comme une richesse, les commissions et les universités sont sur la même longueur d’onde: nous accordons très peu de dispenses.»
Une logique libérale
Les médecins étrangers qui prétendent à une équivalence de leur diplôme de base doivent aussi maîtriser une des trois langues nationales. Mais pour le vice-président de l’Absym Gilbert Bejjani, cette exigence ne garantit rien: «Un médecin peut savoir l’allemand et s’installer ensuite à Gand», ironise-t-il, même si on imagine que peu de médecins souhaitent se placer dans cette situation inconfortable. À plusieurs reprises, la N-VA a plaidé de son côté pour une obligation de bilinguisme pour les médecins étrangers installés en région bruxelloise. «Cynique», avaient alors répondu Les Engagés[3], quand on sait que la pénurie a été organisée par le numerus clausus et que la survie du système de santé belge repose sur cette main-d’œuvre.
«Il est normal que les postes dans les pays riches soient attractifs pour les médecins étrangers et nous ne sommes certainement pas pour la fermeture des frontières, commente de son côté Fanny Dubois, secrétaire générale de la Fédération des maisons médicales. Mais il ne faudrait pas que ces médecins soient cantonnés à une forme de relégation sociale comme on l’observe déjà depuis longtemps dans le corps infirmier ou parmi les aides-soignantes, où le sale boulot est laissé aux étrangères…» En ce sens, la situation des médecins étrangers révèle les failles d’un système de santé pris dans les rets d’une logique très libérale, centrée sur l’offre et la demande. Des médecins belges quittent l’hôpital pour avoir un meilleur confort de vie et gagner plus – moyennant des suppléments d’honoraires parfois importants en tant que spécialistes en ambulatoire – tandis que des médecins étrangers font «tenir l’hôpital», tout en étant soupçonnés d’être moins compétents, voire de ne pas être capables de communiquer correctement avec leurs patients. «À mon sens, cette situation est tout à fait scandaleuse, poursuit Fanny Dubois, dans le sens où l’État belge ne participe pas du tout au financement des études de ces médecins qui viennent de pays moins riches, mais s’attend quand même qu’ils viennent combler les trous d’un système en pénurie…»
«Vous pouvez élargir tant que vous voulez, si vous formez 3.000 nouveaux médecins par an et qu’ils vont tous s’installer avenue Winston Churchill, ça ne résoudra pas la pénurie.»
Dr Elie Cogan, professeur émérite de l’ULB et président du Conseil supérieur des médecins spécialistes et médecins généralistes
La solution réside-t-elle dans la suppression du numerus clausus, éternel serpent de mer de la politique belge? L’arrêté royal du 29 mai 2023 portant modification de l’arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l’offre médicale[4] a déjà permis à la Fédération Wallonie-Bruxelles de passer de 505 numéros Inami pour les étudiants qui seront diplômés en 2027 à 744 pour ceux qui le seront en 2028, et à 929 pour les diplômés de 2029. «Cela me semble suffisant, estime le Dr Elie Cogan. Car le vrai problème n’est pas là: vous pouvez élargir tant que vous voulez, si vous formez 3.000 nouveaux médecins par an et qu’ils vont tous s’installer avenue Winston Churchill, ça ne résoudra pas la pénurie.» Certes, en Wallonie, le dispositif Impulseo, géré par l’AVIQ, permet d’octroyer des primes à l’installation des jeunes médecins généralistes dans les zones en pénurie, ainsi qu’une intervention dans les coûts salariaux ou dans les frais de recours à des services de télésecrétariat. «Le budget total des primes et subsides relatif à l’année 2023 est de près de 11,5 millions d’euros», rappelait en février dernier Christie Morreale, alors ministre socialiste de la Santé en Wallonie[5]. Mais il n’existe actuellement pas de tel dispositif incitatif pour la répartition territoriale des autres spécialités médicales ni d’obligation pour les spécialistes à pourvoir les postes hospitaliers. Un cas emblématique est celui de la pédiatrie: alors que les hôpitaux manquent cruellement de pédiatres, ceux-ci sont très nombreux à ouvrir des cabinets privés et à assurer des prises en charge qui pourraient rentrer dans les attributions des généralistes. «On pourrait tout à fait trouver un système équilibré qui permettrait d’imposer certaines contraintes aux médecins comme de travailler un certain temps à l’hôpital, avance Elie Cogan. C’est une question de courage politique. Il faudrait aussi des contraintes d’installation géographique pour pallier le vide dans certaines régions. Sinon, le risque est que ce soient des médecins moins bien formés qui finissent systématiquement par s’y installer.» Moins bien formés? Ou moins bien considérés et plus isolés? «La médecine, ce n’est pas seulement des standards. C’est aussi la multidisciplinarité et le croisement des savoirs, rappelle Fanny Dubois. La médecine est avant tout un art.» Un art à deux vitesses? La question se pose aujourd’hui aussi bien côté soignants que soignés.
[1] Chiffres de l’Agence InterMutualiste.
https://aim-ima.be/Recours-aux-services-d-urgence-en?lang=fr
[2] OCDE (2023), Panorama de la santé 2023: Les indicateurs de l’OCDE, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/5108d4c7-fr.
[3] https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/2023/08/25/imposer-le-bilinguisme-aux-medecins-a-bruxelles-aggraverait-la-penurie-LQX47ZJJSZEUHENDOZXRHLXCRQ/
[4] https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2023/05/31_1.pdf#Page41.
[5] https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&iddoc=127064