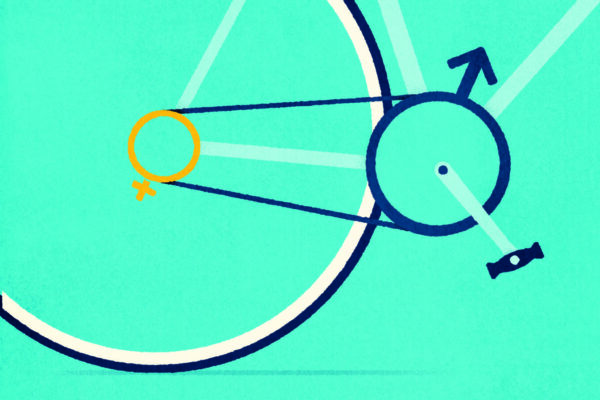«Il y a très peu de prise de conscience sur la notion de genre, que ce soit dans la formation des assistants sociaux ou au niveau du fonctionnement des écoles», résume d’emblée Louise Warin, récemment retraitée et longtemps enseignante à l’HELMO-Esas (École supérieure d’action sociale) de Liège. Pendant quinze ans, elle y a assuré un cours à option pour les futurs assistants sociaux de troisième (et dernière) année sobrement intitulé «Genre et travail social» et suivi par une cinquantaine d’étudiants sur les quelque 250 que compte la section. Un cours conçu à son initiative propre et qui est resté… optionnel. «J’ai introduit ce cours au moment où la direction de l’école était assurée par une femme qui partageait mes préoccupations. La demande de rendre ce cours obligatoire a été faite plusieurs fois, soutenue par les évaluations des étudiants, mais les directions masculines qui ont suivi s’y sont toujours opposées», détaille Louise Warin.
Depuis 2014, les universités de Belgique francophone sont tenues par décret de compter en leur sein une personne de contact «Genre» assurant des missions d’information, de sensibilisation et de mise en réseau. Jusqu’à ce jour, les hautes écoles ne possèdent en revanche aucune balise de ce type. «Le pouvoir reste aussi très masculin dans les universités, mais il y a au moins ce cadre légal qui est un allié pour les femmes qui voudraient par exemple pointer des discriminations dans l’institution», commente Louise Warin. Depuis trois ans, un groupe de travail «Genre et hautes écoles» existe néanmoins au sein de l’ARES (Académie de recherche et d’enseignement supérieur), et la mise sur pied d’une commission permanente «Genre en enseignement supérieur» vient d’être annoncée. Elle rassemblera des représentants des universités, des hautes écoles et des écoles supérieures des arts avec pour objectif de soutenir les établissements dans leur lutte contre les inégalités et les discriminations.
Une option essentielle
L’absence de formation systématique aux questions de genre dans les cursus des assistants sociaux (AS) et des éducateurs semble d’autant plus curieuse qu’on suppose à ces professeurs et étudiants un parti pris en faveur de certaines valeurs progressistes. Mais les cordonniers, c’est bien connu, sont les plus mal chaussés, et, ici pas plus qu’ailleurs, le genre n’est au programme. Pascale Pereaux, directrice du cursus «Animation socioculturelle et sportive» pour les éducateurs spécialisés de l’HELMO-Esas, souligne en revanche l’existence d’autres signaux forts dans l’établissement, comme la pratique de l’écriture inclusive par les trois directeurs de section. «Les étudiants reçoivent des mails de la direction avec des points médians. Nous les utilisons aussi entre nous. Par ailleurs, je remarque que de plus en plus de collègues utilisent le ‘iels’. Pour moi, le travail social est lié à la défense de certaines valeurs. Il me semble qu’on en revient automatiquement à la question du patriarcat», estime-t-elle, tout en insistant sur la possibilité d’une approche inclusive «au sens large»: genre, migration, santé physique et mentale…
«Il y a très peu de prise de conscience sur la notion de genre, que ce soit dans la formation des assistants sociaux ou au niveau du fonctionnement des écoles. » Louise Warin, enseignante à la retraite de l’HELMO-Esas (Liège)
Mais diluée dans tant d’inclusivité, l’approche genrée ne menace-t-elle pas de devenir une grenadine bien pâle? «Deux arguments m’ont toujours été opposés pour que le cours sur le genre ne devienne pas obligatoire, raconte Louise Warin. Premièrement, l’idée que les questions de genre pouvaient traverser tous les cours et que ça suffisait. Deuxièmement, l’idée qu’alors, on pouvait tout aussi bien rendre obligatoire un autre cours à option tel que ‘travail social et récit de vie’ ou ‘travail social et gériatrie’.» Des arguments que l’ex-enseignante juge contradictoires et révélateurs d’une mécompréhension du caractère transversal du concept de genre. «Dédier un cours à cette question, cela soulève les mêmes enjeux que la parité. Est-ce qu’il est justifié de donner un gros coup de pouce? Mon point de vue, c’est qu’à l’heure actuelle, comme nous ne sommes toujours pas dans une société égalitaire même si elle l’est du point de vue du droit, il faut les deux: un cours dédié et une approche transversale.»
Car Louise Warin en a vu, des étudiants et surtout des étudiantes (elles représentent 80% des futurs AS) bouches bées de découvrir qu’en Belgique, l’égalité totale entre époux date de 1976 – avant quoi une femme passait sans transition de l’autorité paternelle à l’autorité maritale – et la loi réprimant le viol entre époux de 1986. Une ligne du temps limpide, méconnue et pourtant suffisante à changer définitivement de regard sur son histoire familiale et sa propre construction. «En général, les étudiants ne sont pas du tout conscients que les femmes subissent des discriminations, raconte-t-elle. La majorité vit encore en famille et est donc relativement protégée de ces questionnements qui apparaissent souvent plus tard.» Sans expérience du marché de l’emploi et de la vie conjugale, les étudiants, une fois dessillés, peuvent toutefois rapidement exercer leur réflexivité. En premier lieu: pourquoi tant de filles dans la classe et plus généralement dans les métiers du «care»? «Aborder cette question par le biais de la dimension historique leur permet de prendre conscience qu’on est dans un système. Cette prise de conscience se fait toujours d’abord pour eux-mêmes en tant qu’homme ou femme, plutôt que par rapport aux enjeux professionnels.»
Classe ou genre, pourquoi choisir?
Depuis le départ à la retraite de Louise Warin, Patrick Govers, enseignant de longue date intéressé par ces questions, assure désormais le cours. En dépit de l’estime qu’elle porte à son successeur, Louise Warin regrette qu’une femme n’ait pas été désignée pour prendre la relève. «Pour moi, c’est encore le signe que l’institution ne considère pas le genre comme un enjeu prioritaire. Sans même parler du fait que nous sommes ainsi socialisés que les filles ont tendance à moins prendre la parole dès qu’il y a un homme dans la pièce. Et puis j’abordais aussi la question de l’excision, du clitoris… Ce n’est peut-être pas aussi aisé pour un homme.»
Souvent chambré par ses collègues pour son féminisme – un homme féministe demeure une curiosité dont on se demande souvent s’il n’a pas quelque tare à cacher –, Patrick Govers est habitué à se mouvoir dans ces paradoxes. «Ça reste compliqué, y compris vis-à-vis de certains collègues que j’apprécie beaucoup mais qui considèrent que la lutte des classes reste largement prioritaire par rapport à la question du genre. Mais on n’est plus dans les années septante! Cela me rappelle ces réunions de communistes où les femmes faisaient le service à table», raconte celui qui se reconnaît dans une approche intersectionnelle, où les prismes d’analyse s’additionnent et se croisent plutôt que de s’exclure. Thomas Lemaigre, conférencier à l’Institut d’enseignement supérieur social de l’information et de la documentation (IESSID) de la Haute École Bruxelles-Brabant, estime lui aussi que l’approche de genre est entièrement compatible avec les autres approches issues des sciences sociales. «Quand je donnais cours sur les publics dans le cadre du master d’ingénierie en action sociale à l’HELha (Haute École Louvain en Hainaut), j’abordais la sociologie de la pauvreté. Mais la question du genre traversait tous les chapitres du cours, notamment à travers la notion du seuil de pauvreté ‘en temps’, une notion que les ‘time studies’ ont introduite et qui montre, à partir de la tenue d’un journal quotidien, que les femmes sont plus pauvres en temps que les hommes, y compris dans les tranches de revenus moyennes et supérieures. Cela permet de complexifier la question», détaille-t-il.
«Aborder cette question par le biais de la dimension historique leur permet de prendre conscience qu’on est dans un système. Cette prise de conscience se fait toujours d’abord pour eux-mêmes en tant qu’homme ou femme, plutôt que par rapport aux enjeux professionnels.» Louise Warin, enseignante à la retraite de l’HELMO-Esas (Liège)
Au contact de ce public déjà inséré dans la vie professionnelle – le master d’ingénierie en action sociale de l’HELHa s’adresse à des travailleuses de la santé ou du social souhaitant prétendre à des postes de cadre ou de direction –, l’enseignant a par ailleurs observé la prépondérance de discours tendant à surresponsabiliser les bénéficiaires. «Une mère célibataire, il y a quand même souvent l’idée sous-jacente que c’est un peu sa faute si elle est en difficulté… Alors que, bon, ce n’est pas parce qu’on se sépare qu’on doit payer toute sa vie.» Ce type de jugement même implicite est d’autant plus capital à détecter qu’il semble s’exercer plus volontiers de femme à femme. «Dans le lien avec les bénéficiaires, on observe que les assistantes sociales ont tendance à se montrer plus autoritaires avec les femmes», confirme Patrick Govers. D’où l’importance de pouvoir porter un regard réflexif sur sa pratique, au risque de materner en toute innocence les bénéficiaires masculins et de secouer un peu trop les femmes. Impossible, de fait, de contourner les règles d’un jeu si on ne les connaît pas.
«Il y a un tas de situations dans lesquelles la dimension de genre va intervenir dans le travail des AS, rappelle Louise Warin. Je pense par exemple aux consultations de l’ONE: on considère encore que la présence du père n’est pas importante lors de la visite à domicile, ce qui renforce la division sexuée des rôles parentaux et responsabilise davantage les femmes en cas de problème. Je pense aussi aux femmes victimes de violence, à la question des enfants transgenres dans les centres PMS… Le fait qu’un AS soit sensibilisé à ces questions peut vraiment changer la donne pour le bénéficiaire.» Qu’il soit homme, femme ou au-delà de ces identités. «Quand j’ai commencé le cours, la question du genre était envisagée de manière strictement binaire. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas», ajoute encore Louise Warin.