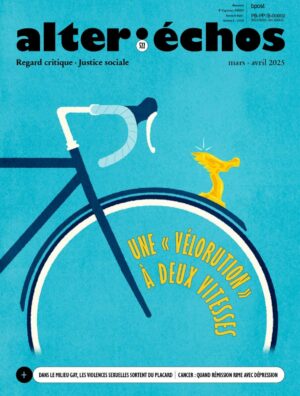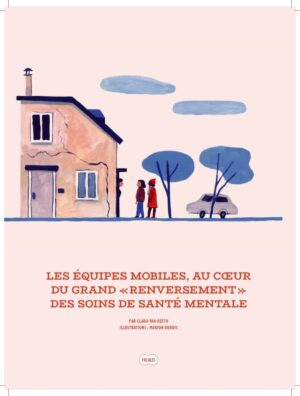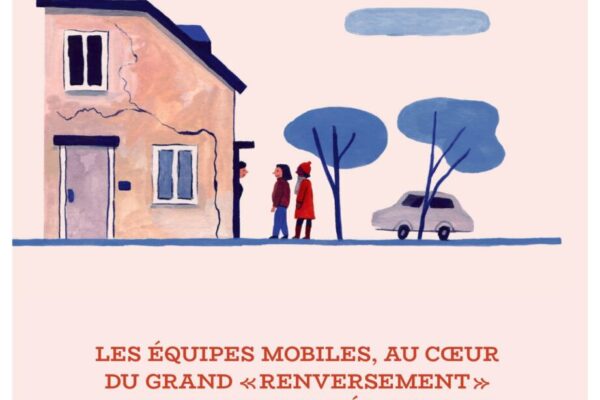Dans cette salle d’attente, compliqué de savoir lequel de nous deux se sent le plus mal à l’aise. Assis de part et d’autre d’un sapin de Noël, nos regards se sont brièvement croisés avant que l’autre homme, un trentenaire soigneusement ébouriffé, ne replonge dans son téléphone. Une main sur la tempe en guise de rideau. Il a dû deviner que je n’étais pas un client de cette «Clinique du cheveu». Il faut dire que ma récente tentative de cheveux longs me confère davantage l’allure de Hugues Aufray que de Pierre Garnier: un style que personne ne financerait volontairement. Dix étranges minutes à deux et puis Jean-Claude Schuler, le chef d’établissement, nous invite dans son salon. Le client, devant le miroir du fond avec sa collègue. Moi, dans son bureau, pour discuter du commerce de la perruque.
Avant cette visite, j’avais déjà passé plusieurs coups de fil pour tenter de cerner l’ampleur de ce marché et son évolution. Du côté de Febelhair, la fédération des coiffeurs belges, on n’avait aucune idée du nombre de perruques vendues en Belgique ni même des points de vente. Les fournisseurs, eux, n’ont pas décroché ou ont refusé de partager leurs données. «C’est un petit marché», m’avait tout de même sommairement confié Pascal Dechamps, cofondateur de l’entreprise Elite Coiff, experte en solutions capillaires. «Aujourd’hui, celui des perruques santé stagne, mais celui des compléments capillaires pour hommes est en développement. Celui pour femmes pourrait suivre.»
Du côté de Febelhair, la fédération des coiffeurs belges, on n’avait aucune idée du nombre de perruques vendues en Belgique ni même des points de vente. Les fournisseurs, eux, n’ont pas décroché ou ont refusé de partager leurs données.
Dans son institut schaerbeekois, Jean-Claude tire un constat similaire. C’est la prothèse capillaire qui répond à la principale demande de sa clientèle. Contrairement à une perruque traditionnelle, cette coiffe se fixe directement sur la tête à l’aide d’adhésifs spécifiques ou de résine capillaire. Conçue sur mesure, grâce à un moulage de crâne, elle reste fixée au chevet de son propriétaire jour et nuit. «Les prothèses représentent 90% de mon activité, estime le patron. On prélève les empreintes, on les colle et on les entretient tous les mois.» Les profils de ses clients sont variés: des hommes dégarnis, évidemment, mais aussi des femmes atteintes d’alopécie androgénétique ou des personnes présentant des séquelles d’une erreur médicale. De plus en plus, l’institut accueille des jeunes non éligibles à une greffe capillaire (parce que la calvitie est trop avancée ou pas encore stabilisée) ou déçus par le résultat, souhaitant camoufler les cicatrices laissées par l’intervention. «Les prothèses concernent autant les femmes que les hommes, mais ces derniers posent de plus en plus jeunes et ont bien moins de complexes qu’à l’époque où on leur collait des moquettes, observe le coiffeur. Aujourd’hui, les prothèses sont implantées à la main et ont un rendu beaucoup plus naturel.»
Les profils de ses clients sont variés: des hommes dégarnis, évidemment, mais aussi des femmes atteintes d’alopécie androgénétique ou des personnes présentant des séquelles d’une erreur médicale.
Selon lui, les réseaux sociaux et les influenceurs ont contribué à faire évoluer le regard de la société sur les compléments capillaires. Pour exemple, citons le compte «Toupeequeen» d’Emily Alexis. Autoproclamée «Toupet artiste», cette Californienne partage en vidéo les «transformations» de ses clients à ses 305.000 abonnés sur Instagram, 584.000 sur TikTok. «Les prothèses ont souvent une vocation plus esthétique que les perruques médicales, mais leur impact est également social, poursuit Jean-Claude. Beaucoup me confient qu’ils retrouvent une certaine confiance en eux après la pose. Certains osent de nouveau croiser le regard de leur patron ou de leur conjoint. Il y a aussi les célibataires qui ont à nouveau l’audace d’aborder quelqu’un.»
À l’arrière du salon, je retrouve Émile, le jeune homme de la salle d’attente. Le sommet de tête badigeonné de résine, il m’explique sans la moindre gêne (mes propres préjugés m’ont visiblement trompé) qu’il a choisi de porter une prothèse pour son bien-être personnel. «Ce n’a pas été facile de passer le cap. Je me demandais si c’était vraiment indétectable, si les gens allaient poser des questions et, si oui, lesquelles. Mais je n’en ai pas eu tant que ça…» Encore trois ou quatre ans et puis il remettra son crâne à nu, me dit-il. Ce qui, du même coup, renflouera son portefeuille. En moyenne, pour l’acquisition d’une prothèse, il faut compter 400 euros. «Avec l’empreinte et les entretiens mensuels, cela me revient tout de même à 2.000, voire 2.500 euros par an.»
Perruques de énième main
Dans cette clinique, viennent aussi de nombreuses femmes qui subissent une alopécie momentanée à cause de chimiothérapies. Elles cherchent alors plutôt des perruques dites de «santé». «Ce sont des bonnets plus confortables que les prothèses, confectionnés avec des produits non allergènes pour limiter les risques de réactions sur les cuirs chevelus fragilisés par les traitements», explique Jean-Claude qui, d’abord coiffeur, s’est reconverti en prothésiste capillaire après la maladie de son épouse.
Malgré sa portée médicale, l’accessoire conserve un coût non négligeable: de 180 à 3.500 euros, en fonction de la qualité et la longueur du cheveu. Si l’assurance obligatoire intervient à hauteur de 180 euros en Belgique, une (belle) perruque reste un luxe que beaucoup ne peuvent s’offrir. Selon l’association française RoseUp, 15% des femmes en traitement abandonnent l’idée de s’en acheter une pour raison financière.
Malgré sa portée médicale, l’accessoire conserve un coût non négligeable: de 180 à 3.500 euros, en fonction de la qualité et la longueur du cheveu. Si l’assurance obligatoire intervient à hauteur de 180 euros en Belgique, une (belle) perruque reste un luxe que beaucoup ne peuvent s’offrir.
Face à ce constat, des associations de lutte contre le cancer organisent la solidarité. En parallèle du don de mèches (les associations vendent les cheveux à des perruquiers pour financer des perruques pour les personnes malades), se multiplient les dons de perruques. À Bruxelles, l’association de patientes «Vivre comme avant» les collecte et les reconditionne en collaboration avec l’Institut scolaire Bischoffsheim. Juste après la récré, les professeures Sophie Gizzi et Karen Lavoie accueillent énergiquement les élèves de l’option Coiffure dans leur atelier: «Allez, un qui lave, l’autre qui rince!» Les deux mains dans les bacs à shampoing, cinq jeunes retournent méticuleusement les postiches. «C’est cool. C’est un atelier qui permet à des gens de se sentir mieux dans leur peau et de valoriser en même temps notre futur métier», se réjouit Adna, qui se dit touchée par sa rencontre avec l’association. «On peut tous avoir un problème qui nous amène à vouloir porter une perruque, complète Boubacar. Vraiment, quand tu le comprends, ça n’a pas de sens de s’en moquer.»