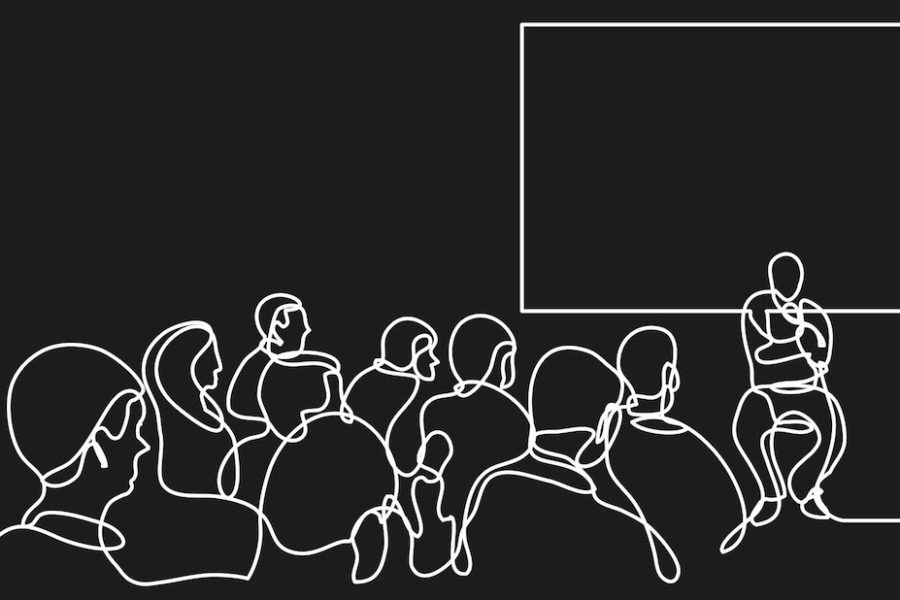Comment réagir face à un jeune qui manifeste son envie de partir en Syrie? ou devant un homme qui refuse de serrer la main aux femmes? Tel est le genre de questions auxquelles sont aujourd’hui confrontés les travailleurs sociaux. Pour les aider à y répondre, Corinne Torrekens, directrice de la spin-off de l’ULB DiverCity, et Myriem Amrani, coordinatrice de l’asbl Dakira, organisent chacune des formations. Nous les avons rencontrées.
Alter Échos: Myriem Amrani et Corinne Torrekens, vos organismes ont chacun été mandatés par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour proposer des formations sur le thème de la radicalisation violente. Pourriez-vous nous en dire plus?
Myriem Amrani: Les formations de Dakira s’adressent tant au grand public qu’à des groupes d’agents des services publics et de travailleurs sociaux, ou encore à des jeunes de 12-25 ans. Nous proposons quatre modules: «Islam, islamisme, djihadisme», «Islam en Europe», «Femmes, féminismes, islam» et «Posture professionnelle des travailleurs sociaux face au radicalisme».
Corinne Torrekens: Pour sa part, DiverCity forme essentiellement des travailleurs sociaux sur la radicalisation violente, et ce à la demande des services publics. Il peut s’agir de gardiens de la paix, de médiateurs, d’éducateurs ou d’animateurs socioculturels, d’assistants sociaux, de directeurs d’écoles, etc. La formation dure une journée et cible donc, à chaque fois, un groupe de travailleurs particuliers.
«Le fait de porter un voile austère ou le refus de serrer la main aux personnes de l’autre sexe constituent-ils autant d’indices de radicalisation?», Corinne Torrekens
AÉ: En quoi consistent ces formations? À fournir des outils pour détecter les signes de radicalisation?
CT: Disposer d’une boîte à outils pour détecter les radicaux, d’une solution «clé sur porte» pour faire face à la radicalisation, c’est effectivement le souhait principal de la majorité de nos participants. Mais les choses ne sont pas si simples. Parce qu’avant d’en arriver là, il y a d’abord toute une série de notions à définir, de concepts à clarifier. Qu’est-ce que l’islam? Qu’est-ce qui est écrit dans le Coran? Ça veut dire quoi, être musulman? etc.
AÉ: Les musulmans ne doivent donc pas apprendre grand-chose durant vos formations…
CT: Détrompez-vous. Nombre de musulmans, même pratiquants, ne connaissent pas forcément bien leur religion. Par exemple, lors d’une formation organisée pour des gardiens de la paix en Région bruxelloise, un participant fut très surpris de m’entendre parler des chiites[1] et s’exclama: «C’est donc ça, les chiites! Moi, je pensais que c’était juste de mauvais musulmans.» Un exemple qui montre, au passage, l’influence d’une certaine forme d’orthodoxie sunnite sur une partie des musulmans… Outre cet enseignement ou, pour certains, ce rappel des bases de l’islam, nous examinons aussi ce qui peut être considéré ou non comme du ressort de la radicalisation. Par exemple, le fait de porter un voile austère ou le refus de serrer la main aux personnes de l’autre sexe constituent-ils autant d’indices de radicalisation? En fait, l’essentiel des questions porte sur lien présumé entre un positionnement religieux orthodoxe et la radicalisation violente.
AÉ: Myriem Amrani, le voile ou le refus de serrer la main sont identifiés d’emblée comme signes de radicalisation, c’est aussi ce que vous constatez lors de vos formations?
MA: Oui, ce sont vraiment deux points de fixation très forts. Or, il est important de comprendre que, plus que des marqueurs religieux, il s’agit, avant tout, de marqueurs d’appartenance à un groupe structurellement discriminé depuis des décennies, un phénomène qui a favorisé une certaine forme de repli. Depuis les émeutes de jeunes dans les années 90, on n’est pas parvenu à atteindre la pleine égalité citoyenne, les mêmes chances pour tous d’accéder à un emploi ou à un logement décent. Aujourd’hui, la réponse à cette situation peut se résumer ainsi: «À défaut d’être égaux, soyons différents.» Cette différence passe par la mise en avant de marqueurs religieux. Et plus on critique ces marqueurs, plus ils deviennent ostentatoires. J’ajouterais que, outre l’envie de comprendre, il y a aussi un réel besoin chez les participants de pouvoir s’exprimer sans être forcément taxé de racisme parce qu’on est très critique envers l’islam ou sans se voir reprocher de jouer les victimes lorsqu’on évoque la question des discriminations. Certains Belges de souche avouent se sentir «envahis» par l’Islam, les musulmans. De leur côté, les Belges de culture musulmane ont souvent l’impression qu’on les assimile aux terroristes de l’«État islamique». Dans un premier temps, les formations que nous organisons font donc office de catharsis.
CT: Lorsque j’ai affaire à un public très «belgo-belge», comme c’est le cas dans certains endroits reculés de Wallonie, les réactions vont même au-delà. Pour certains, les radicaux sont partout. Ils en voient matin, midi et soir. Alors, bien sûr, quand ils découvrent les chiffres relatifs au radicalisme en Belgique, ils tombent à la renverse. Logique puisque, à leurs yeux, une femme voilée ou un barbu d’origine étrangère est assimilé à une personne radicalisée. C’est aussi avec ce type de public que j’assiste parfois à une véritable libération de la parole raciste et islamophobe. À tous les coups, le fait d’associer le terme «belge» avec «musulman» ou «d’origine maghrébine» provoque regards en coin et grommellements. À Bruxelles par contre, où je forme des groupes beaucoup plus diversifiés sur le plan ethnoculturel, les discours interpellants – pour ne pas dire plus – sont surtout de nature complotiste. Par exemple, le 11-Septembre a été organisé par les Américains, Daech est une création d’Israël et j’en passe. Dans les deux cas, c’est inquiétant, surtout lorsqu’il s’agit de professionnels chargés d’encadrer des mineurs.
AÉ: Pas évident de déconstruire ce genre d’idées en une, deux ou trois journées de formation. Quelle réponse apportez-vous à de tels propos?
MA: Le plus important, c’est d’amener le travailleur social à faire la part des choses entre la façon dont il vit son identité, ce qu’il pense sur tel ou tel sujet et la mission professionnelle qui lui a été confiée. Le danger, c’est de tout emmêler. Évidemment, si le travailleur sent que, en tant qu’individu, il est véritablement en contradiction avec l’institution qu’il représente, il doit en tirer les conséquences qui s’imposent. Cependant, il existe des cas où la question du religieux ou des valeurs masque, en réalité, un problème classique de relations humaines. Je vous donne un exemple, réel. Un coordinateur d’une maison de jeunes avait autorisé certains travailleurs à prier durant leurs heures de travail. Problème, il s’agissait d’une association laïque subsidiée par les pouvoirs publics. Cas typique de pression du religieux qui finit par envahir l’espace professionnel? Absolument pas. À aucun moment, les travailleurs musulmans n’avaient fait de la «pause-prière» une revendication professionnelle forte. Par contre, cette question avait effectivement été utilisée par le coordinateur, qui n’était lui-même pas musulman, pour faciliter les rapports avec son équipe. Elle servait en quelque sorte de monnaie d’échange, par exemple sur la question des horaires des permanences. On est là face à un cas problématique de gestion des ressources humaines, masqué par une question religieuse.
«Dès qu’il y a de la mixité, on voit les clichés s’effriter en direct.», Corinne Torrekens
AÉ: Peur de l’islam chez les uns, sentiment d’être rejetés par l’ensemble de la société chez les autres… Ça doit être compliqué de vous retrouver face à un public mixte, non?
CT: Au contraire. Rien de pire qu’un public totalement homogène. Si une personne entend ses collègues exprimer à haute voix des a priori qu’elle-même cultive déjà, cela ne va pas l’aider à s’en distancier. C’est beaucoup plus facile avec un public mixte, composé de travailleurs musulmans et non musulmans. On peut s’appuyer sur les parcours personnels des uns et des autres pour déconstruire certaines idées préconçues. Ça force à adopter une position de décentration et de réflexivité.
MA: Dès qu’il y a de la mixité, on voit les clichés s’effriter en direct. Je me souviens d’un travailleur de Bruxelles-Laïque qui avait débattu avec des animateurs de Molenbeek lors d’une formation donnée peu après les attentats de Paris. Pour lui, ce fut un réel soulagement d’entendre que ces travailleurs de confession musulmane, dont certains portaient d’ailleurs la barbe, étaient aussi révoltés que lui face aux atrocités commises par les djihadistes. Surtout, il a pu témoigner du sentiment de menace qu’il ressentait en tant qu’athée convaincu… Et se rendre compte que ses confrères musulmans étaient tout à fait capables de respecter ses certitudes quant à la non-existence d’un Dieu.
AÉ: On l’aura compris, il n’existe pas de solution «clé sur porte» contre la radicalisation. Mais, sans déflorer le contenu de vos formations respectives, pouvez-vous donner quelques conseils aux travailleurs susceptibles de devoir un jour affronter ce phénomène?
MA: Le meilleur conseil à donner à un travailleur social? Faites votre boulot sans vous laisser déborder par des questions de valeurs. N’entrez pas sur ce terrain-là car, sinon, c’est la porte ouverte à la surenchère avec votre public. Ne vous arrêtez pas à la longueur du voile ou de la barbe de la personne que vous avez en face de vous. Ce n’est pas contre vous, et votre identité n’est pas en jeu. Ce qui compte, c’est l’autorité que vous représentez, les valeurs de l’institution pour laquelle vous travaillez.
CT: Face à un éventuel cas de radicalisation, il convient d’abord d’identifier le nœud du problème, puis de réfléchir à la personne qui, au sein du réseau auquel on appartient, peut s’avérer une aide utile. Par exemple, si on a affaire à un ado qui se pose des questions sur le texte coranique, on peut essayer d’identifier un imam capable de l’accompagner dans sa démarche spirituelle. Si le jeune est bouleversé par le sort des Rohingyas, il serait bon de l’aiguiller vers une association dans laquelle il pourrait s’investir de manière constructive. Il y a, par contre, une chose à ne surtout pas faire avec un gamin qui, par exemple, crie qu’il veut se barrer en Irak, c’est de le renvoyer de l’école ou de l’écarter de toute structure sociale. Dans ce cas, on risque de le perdre. Et peut-être définitivement.
[1] Les chiites représentent environ 15 % des musulmans à travers le monde. À la différence des sunnites, ils ne reconnaissent qu’Ali, le quatrième calife comme successeur légitime du Prophète.
En savoir plus
Lire de dossier «Lutte contre le radicalisme : la sécurité au prix du social», décembre 2017