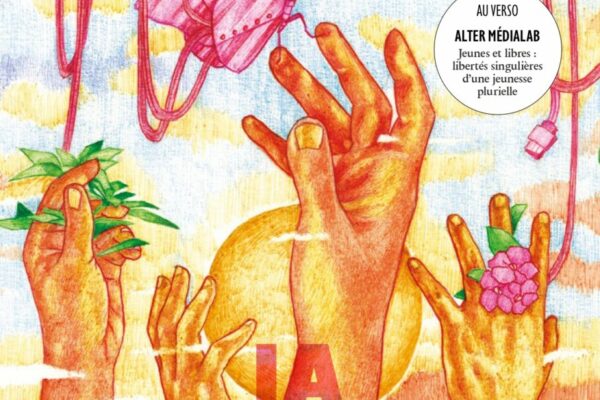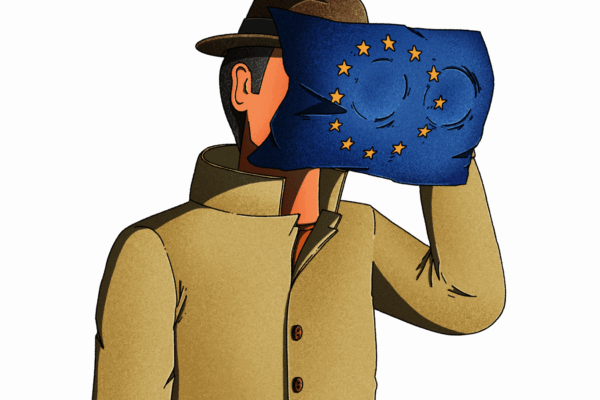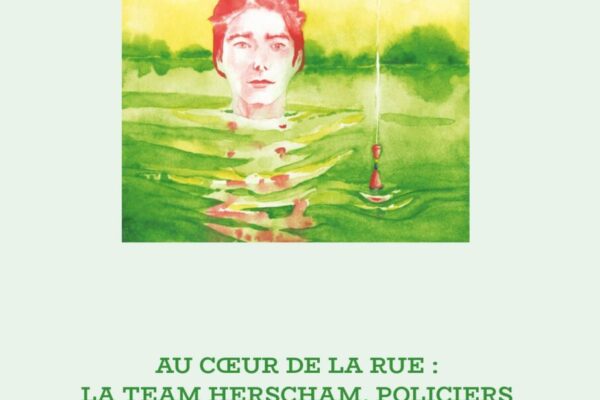Ouvrez les yeux et observez… ces «assis-debout» ou bancs segmentés en places individuelles fleurir dans nos gares et stations de métro. Ces grillages surgir au détour d’une rue. Et ces caméras discrètes épier nos pas. Pour Mickaël Labbé, philosophe spécialiste de l’architecture et auteur de Reprendre place: contre l’architecture du mépris (Payot, 2019), ce sont autant de signaux de mépris envoyés par la ville, de gestes hostiles – et parfois sournois – envers toutes celles et tous ceux qui la peuplent.
 Alter Échos: La ville se dessine contre ses habitants. C’est l’idée que vous déployez dans ce livre. À quand remonte cette hostilité et quels en sont ses contours actuels?
Alter Échos: La ville se dessine contre ses habitants. C’est l’idée que vous déployez dans ce livre. À quand remonte cette hostilité et quels en sont ses contours actuels?
Mickaël Labbé: Il n’est pas évident de dater les phénomènes de mépris dans la ville car la grande ville, née de l’industrialisation, a toujours été un lieu ambivalent, à la fois une source de promesses et un lieu de violence, d’exclusion et d’aliénation. Je m’intéresse dans le livre au tournant néolibéral de la ville, début des années 80 jusqu’à un certain nombre de phénomènes dans les années 2010 qu’on pourrait associer à la métropolisation. C’est un tournant neuf dans notre temps: la ville est devenue obsédée par son image. Les villes-produits mènent entre elles une concurrence territoriale intense. Dès lors que tout se joue à l’image, les villes ne peuvent plus recourir aux formes de violence et d’exclusion classiques (la ségrégation économique, les injustices juridiques ou statutaires délibérées, qui bien sûr n’ont pas disparu) mais mettent en œuvre une violence «soft»: celle-ci ne présente pas de manifestations extérieures usuelles de la violence, mais agit sur le mépris ou sur la non-reconnaissance. Le cas du mobilier anti-SDF est à cet égard tout à fait clair. L’installation d’un banc se passe de l’intervention de la police, du vote d’une loi injuste. C’est une simple pièce de mobilier urbain qui agit assez frontalement au mépris, c’est-à-dire au sentiment d’identité, de formation de soi et au rapport aux autres de certains types d’usagers. Aucun recours n’est en plus possible contre un banc. C’est une forme de réduction à l’impuissance extrêmement humiliante.
AÉ: Cette architecture du mépris se manifeste de multiples façons…
ML: Elle prend des formes diverses, du mobilier anti-SDF jusqu’à des projets d’aménagement parfois assez pharaoniques, comme le projet Europacity (projet de mégacomplexe commercial dans le Val-d’Oise contesté et abandonné, NDLR). On observe de façon étrange dans ce type de projets – sortes de Disneyland géant, de lieux standardisés et uniformisés – des effets de mépris ou d’assignations à résidence identitaire, qui touchent aussi les usagers les plus privilégiés. Le visiteur potentiel est réduit à son portefeuille. J’évoque aussi la tourismophobie. Avec l’affluence massive des touristes dans leur ville, les habitants sentent qu’ils sont traités comme quantité méprisable, que leur quartier ne leur appartient plus vraiment dès lors qu’on le considère comme un produit touristique.
L’installation d’un banc se passe de l’intervention de la police, du vote d’une loi injuste. C’est une simple pièce de mobilier urbain qui agit assez frontalement au mépris.
AÉ: Vous évoquez également les Business Improvement Districts (BID), quartiers complètement privatisés…
ML: Il y a un effet crescendo dans cette logique de marchandisation de la ville. Dans le cas des BID, en expansion partout dans le monde, on en arrive à une privatisation de morceaux de ville entièrement dédiés, comme leur nom l’indique, au business. Ces BID naissent de la collaboration entre les municipalités et les acteurs du secteur privé. Ces formes de partenariat public-privé se développent de plus en plus.
AÉ: Cette architecture du mépris touche tout le monde, dites-vous.
ML: L’idée me tient à cœur parce qu’on pourrait se dire que le mobilier anti-SDF, sur lequel j’insiste tant, est anecdotique ou limité. Même si la première violence s’exerce d’abord sur le public visé, il y a des effets sur nous tous, à deux niveaux. Qu’on soit âgé, enceinte, en surpoids, enfant ou que simplement on soit fatigué ou chargé, ne plus trouver de banc, avoir des assis-debout ou des appuis ischiatiques, rendent la ville moins conviviale et accueillante pour nous tous. Le deuxième effet, le plus désastreux, est que la mise en place d’un mobilier anti-SDF, contrairement à ce qu’on nous fait croire, n’est pas une question technique ou esthétique. Cela véhicule un modèle social implicite d’hostilité et de méfiance où l’on crée et produit de l’antagonisme au sein du corps social. On crée un «eux» assimilé à une catégorie d’indésirables, aux comportements dégradants alors qu’il s’agit de personnes vulnérables victimes de mécanismes sociaux. De la même manière, dans les villes de surtourisme, on produit de l’antagonisme, c’est eux ou nous. Alors que, sans nier la conflictualité, il est possible de cohabiter pacifiquement.
AÉ: Il semble difficile de désigner précisément les responsables de cette architecture du mépris. Mais la question n’est-elle pas surtout «comment ne pas en être complices»?
ML: L’un des points de départ du livre est d’avoir été moi-même pris dans des contradictions. J’ai réalisé que j’étais piégé par des effets de système, qui m’incitent à des comportements que pourtant je désapprouve de tout mon cœur. Il est en effet complexe de désigner des coupables. Prenons l’exemple des bancs. Il y a évidemment des designers et des personnes qui ont commandé ça au départ, mais je pense qu’il s’installe aussi une forme de routine, on se dit «ce produit est la norme, c’est un type de solution» et ça conduit des gens bien intentionnés à reproduire cela. Ce sont des solutions anonymes, impersonnelles, déresponsabilisantes.
AÉ: Vous ouvrez votre ouvrage avec l’exemple de la rénovation de la place d’Austerlitz, à Strasbourg. On est passé d’une place bruyante, pas spécialement fonctionnelle, à un espace que vous décrivez vous-même comme convivial, mais aussi très méprisant. Comment gérer cette ambivalence?
ML: Cette place était un peu sordide. Il y a eu indéniablement une amélioration mais je me demande en quoi elle a dû se payer d’un certain prix, d’une violence et d’une exclusion sourde et en catamini de différents types de population. Sans regretter l’état antérieur, j’observe les effets négatifs aujourd’hui produits par cette «revitalisation». Cette place est standardisée. Les petits bars n’ont mécaniquement pas pu tenir le coup. Sur cette place, je ne croise que des gens comme moi. On ne cohabite plus avec des gens différents. Les villes créent de plus en plus d’îlots où l’on est «isolés ensemble», comme le disait Guy Debord. C’est l’entre-soi qui règne.
AÉ: «La ville n’est plus un lieu où construire un nous», écrivez-vous. Mais l’indifférence ou l’anonymat que la ville rend possibles sont aussi gage de liberté… Comment articuler le «nous» et le «je»?
ML: J’évoque en effet beaucoup le «nous» et la nécessité d’un «où» pour construire un «nous». Articuler le «nous» et le «je» est nécessaire et permet de réfléchir à ce qui fait la spécificité du mode d’habitation en ville. Ce qui fait la particularité d’être en ville – et la différence avec la campagne ou la petite ville – est cette ambivalence: dans la foule de la ville, je peux avoir la capacité d’isolement, d’esseulement. Cette foule offre la possibilité de se libérer d’assignations identitaires, d’héritages familiaux, etc., de se réinventer. Et c’est là que réside la force démocratique du «nous» urbain. Ce n’est pas parce qu’on veut être ensemble qu’on est nécessairement dans une forme de privation de liberté sous l’influence du groupe. On peut avoir des interactions quotidiennes riches et intéressantes avec des gens qu’on n’est pas obligé d’aimer ou d’inviter chez soi. Il y a formation d’un nous, par protection du «je» et affirmation de l’individualité.
AÉ: On voit des mobilisations pour un «droit à la ville». Avec succès?
ML: On voit des gens se mobiliser, dans les villes (notamment les très actifs Design For Everyone à Bruxelles, NDLR), mais aussi les mouvements sociaux comme les ZAD ou les gilets jaunes. Le droit à la ville prend deux formes efficaces aujourd’hui. Une forme négative premièrement. Quand des citoyens se mobilisent et résistent face aux municipalités, face aux gros projets de promoteurs vécus comme une agression, ou en alertant contre le mobilier excluant. Il y a aussi un droit à la ville positif, qui peut surgir de façon très microscopique: une friche, un potager, le détournement de fonction d’un lieu. Ce sont des actions ponctuelles qui nous font reprendre conscience qu’on a notre place en ville, que les lieux sont les nôtres.
AÉ: Dans cette mobilisation pour un «droit à la ville», vous en appelez à la prudence sur les mots très à la mode de «participation» ou de «consultation»…
ML: Dès lors qu’on essaye de militer pour un droit à la ville, la question du langage est essentielle. Les mots d’ordre qui ont pu être les plus critiques deviennent des instruments marketing de la même manière que des espaces qui se veulent alternatifs sont récupérés et deviennent inoffensifs. C’est très bien de faire vivre un lieu en friche – comme le cas des occupations temporaires – mais ça peut servir les intérêts des promoteurs qui s’en servent après comme signifiant alternatif. On voit aussi, dans les campagnes des municipales, le mot «droit à la ville» refleurir partout, mais que met-on derrière ce terme, quel contenu donne-t-on à la notion de participation, de consultation, de coconstruction dans la bouche des aménageurs et des pouvoirs publics? Tout le monde est pour, mais ce sont des simulacres qui font perdre toute substance à l’idée même d’un véritable «droit à la ville».
Pour réinventer un «nous» il faut trouver un «où». Où et à partir d’où se réinventer ?
AÉ: Vous évoquez les zone à défendre (ZAD), leurs indéniables apports pour «reprendre place», mais leurs limites, aussi.
ML: J’ai beaucoup d’admiration pour les personnes à l’origine des ZAD. Ils m’ont remis sous les yeux l’articulation entre le «nous» et le «où». Mais, et c’est mon point critique, je remarque dans tous ces mouvements que pour réinventer un «nous» il faut trouver un «où». Où et à partir d’où se réinventer? Ces mouvements choisissent des lieux hors ville ou parfois difficilement habitables. Évidemment, cela s’explique, dans le cas de la ZAD, par l’urgence de se défendre. Mais on observe aussi une pensée anti-ville. Je considère, moi, que le droit à la ville ou le droit aux villages ne sont pas contradictoires. Inutile d’opposer la ville à une pseudo-nature. De plus, on est à un moment où plus de la moitié de l’humanité habite en ville. On ne pourra pas tous partir à la campagne. Je me dis qu’on peut réimporter les acquis de leurs réflexions en ville, là où l’on est.
AÉ: Quels outils des occupations des ronds-points par les gilets jaunes peut-on réimporter?
ML: L’investissement des ronds-points est une invention spatiopolitique absolument géniale. Ils ont fait de ce non-lieu une forme d’agora, sachant que ça ne deviendra pas, à l’inverse d’une ZAD, un lieu d’habitation. Ils ont aussi mis en lumière le fait que les centres-villes riches et visités par les touristes ne sont pas les espaces de tout le monde, qu’il y a différents types d’espaces et que le droit à la ville doit tenir compte aussi des espaces périurbains.
En savoir plus
Egalement dans ce numéro :
Dossier Un pas vers un toit : De la rue au logement. Pour franchir ce pas – ou plutôt ce large fossé –, des dispositifs temporaires s’attellent à fournir un toit à des personnes qui en sont dépourvues et à les aider à se remettre en selle.
Et dans nos archives :
«Le mobilier urbain, objet de cohésion ou de dissuasion», Alter Échos n°450.
«Une ville à mille temps», Alter Échos n°475.