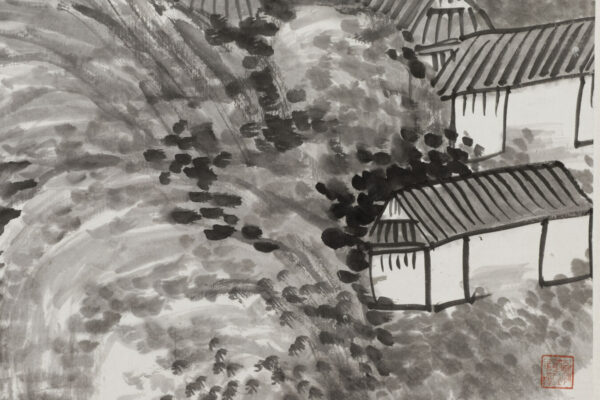Joseph Stiglitz est devenu, au fil des années, l’un des grands théoriciens de l’inégalité. Le prix Nobel d’économie a rassemblé dans son dernier ouvrage une collection d’articles qu’il a rédigés entre 2006 et 2014. On y trouve notamment l’un des textes qui ont inspiré le mouvement «Occupy Wall Street»: celui paru dans «Vanity Fair» en 2011, consacré aux Américains les plus riches, le fameux «Du 1%, par le 1% pour le 1%». En résulte un tableau sans concession d’un monde de plus en plus inégalitaire, qu’il s’agisse de la fiscalité, du logement, de la santé, ou de l’éducation. Mais à chaque article ou essai compilé dans cet ouvrage, l’économiste apporte ses solutions, les mettant à disposition des citoyens.
A.E.: Qui sont les «1%» que vous évoquez?
J.S.: La plupart des ultra-riches sont des héritiers. Comme la famille Walton, qui a hérité de l’empire Walmart. Aux États-Unis, huit personnes au total regroupent autant de richesses que 44% des citoyens américains de base. Dans ce cercle restreint, on retrouve aussi de nombreux CEO. Aux États-Unis, la rémunération des patrons est passée de 20 à 300 fois le salaire moyen de leurs employés. Et ce n’est pas une productivité en hausse qui aurait justifié cela: les patrons de banques, qui sont les mieux rémunérés, ont une productivité négative sur les dernières années! Voilà le problème central, s’agissant des inégalités, sur lequel on devrait se concentrer. Enfin, à côté des financiers, on retrouve aussi des «monopolistes». Aujourd’hui, cette oligarchie est consciente des risques de laisser croître exagérément l’inégalité. Elle a peur de tomber de son perchoir. Mais, de manière plus cynique, ses membres comprennent que la croissance économique durable, dont dépend leur prospérité, est impossible quand les citoyens ont des revenus stagnants.
A.E.: Les États-Unis connaissent pourtant une croissance supérieure… Comment se fait-il qu’elle ne profite pas à tous?
J.S.: La vérité, c’est que la productivité a augmenté ces trente dernières années aux États-Unis, mais que les salaires n’ont pas du tout suivi cette hausse. C’est totalement inhabituel. D’ordinaire, les salaires suivent la productivité… Résultat: la prospérité n’est plus redistribuée. De 2009 à 2012, 91% de la hausse des revenus sont allés dans la poche de 1% des Américains. 99% des gens n’ont pas vu la couleur de cette croissance. Le revenu médian est aujourd’hui inférieur à son niveau d’il y a vingt-cinq ans. En bas de l’échelle, les salaires sont à peu près identiques à leur niveau d’il y a cinquante ans!
A.E.: La théorie du ruissellement, qui voudrait que l’enrichissement des riches finisse par profiter à tous, est donc erronée?
J.S.: Elle est non seulement erronée, mais dangereuse, car elle menace à la fois la croissance mondiale et la démocratie. La première parce que le seul moteur durable de la croissance ne peut être que la consommation et que celle-ci est pénalisée par la baisse du pouvoir d’achat; la seconde, parce que les droits concrets des citoyens sont directement tributaires de leurs ressources.
A. E.: Vous avancez l’argument que la démocratie contemporaine est plus proche d’un système «un dollar, une voix» que «d’une personne, une voix». Les patrons qui financent les campagnes électorales n’ont-ils pas une influence prépondérante?
J.S.: C’est vrai, mais le problème est plus vaste. Pour les dernières élections aux États-Unis, chacun des candidats a dépensé plus d’un milliard de dollars pour sa campagne. La Cour suprême, quant à elle, permet aux corporations de financer les campagnes présidentielles sans aucune limite. Résultat: il y a deux cercles vicieux. Le premier, c’est que davantage d’inégalité économique conduit à encore plus d’inégalité politique. Et le tout renforce encore plus les inégalités économiques. Le deuxième effet, c’est qu’au plus les gens sont déçus par le système politique, au moins ils vont voter. Et au moins ils votent, au plus ils facilitent le terrain aux ultra-riches pour qu’ils puissent exercer leur influence. Ces deux cercles vicieux minent durablement l’efficacité de la démocratie.
A.E.: Les Européens, aussi, votent peu… Quel regard dressez-vous sur l’UE?
J.S.: J’aime beaucoup l’idée d’une Europe unie, mais vous avez introduit la monnaie unique beaucoup trop tôt. L’euro était censé rapprocher les peuples, créer de la cohésion et mieux répartir la prospérité. Selon moi, il a produit exactement le contraire. Au risque de détruire non seulement l’économie européenne, mais aussi la démocratie. L’euro est en fait un projet avorté. C’était un projet politique qui devait embrasser l’économie. Mais l’Europe a échoué à créer une union bancaire, des obligations européennes communes à tous les pays membres… Il y a donc un conflit entre, d’une part, la rigidité de l’euro, et d’autre part, l’incapacité des institutions à faire travailler l’Eurozone de concert. Or, pour que l’Europe soit puissante, il ne faut pas qu’elle ait une monnaie forte, il faut qu’elle investisse dans l’humain et l’avenir.
A.E.: N’est-ce pas ce que font les pays européens?
J.S.: En Europe, l’idée dominante est qu’il faut diminuer les impôts tout en réduisant les déficits. Cela implique qu’on baisse aussi les investissements dans l’avenir, dans l’éducation, dans les infrastructures, dans la technologie. Mon espoir, c’était qu’en 2010, au moment de l’éclatement de la crise grecque, il y aurait un sursaut de solidarité suffisamment fort pour fédérer les pays et finaliser le projet européen. En contrepartie, il y a d’abord eu un déni à reconnaître les problèmes. Ensuite, l’Allemagne a fini par imposer sa vision de l’austérité… Aujourd’hui, elle s’avère non seulement contre-productive, mais encore plus appauvrissante, faible et inégale. Votre ersatz de capitalisme socialise les pertes et privatise les profits.
A.E.: Vous soulignez le rôle de la finance dans la montée des inégalités. Quel est-il?
J.S.: Il y a 30 ans, Reagan a dérégulé le secteur financier, ce qui a été une erreur majeure. Depuis, on a diminué les impôts, on a été plus favorable au capital, on a durci les règles pour les syndicats… Le secteur financier est passé de 2,5% à 8% du PIB aux États-Unis. Sans apporter aucune amélioration à l’économie. Et aujourd’hui, dans beaucoup d’autres pays, les revenus issus de la spéculation sont beaucoup moins taxés que les salaires. Ces revenus – dividendes, stock-options… – sont l’apanage des plus riches, qui bénéficient donc d’une fiscalité allégée. D’où un système fiscal régressif: on est d’autant moins taxé que l’on est riche. Il faut en sortir.
A.E.: Jusqu’où peuvent aller les inégalités? N’y a-t-il pas une limite?
J.S.: En principe, toute société qui fonctionne génère de l’inégalité. Si, dans une société, tout le monde est au même niveau, il n’y a pas de motivation. Mais le niveau actuel de l’inégalité n’est pas le résultat des lois inexorables de l’économie. Il dépend des politiques que nous suivons, et de la politique… Et non d’une mondialisation échappant aux États, comme on l’entend. Si on laisse faire, on peut parvenir à une situation semblable à celle des pays sous-développés, où les inégalités deviennent si élevées que les riches sont contraints de vivre dans des résidences fermées, surveillées, doivent envoyer leurs enfants aux États-Unis, car, sans cela, ils risquent d’être kidnappés… On n’en est pas encore là. Mais si le mouvement actuel continue, le risque existe d’aboutir à une telle situation. Ce n’est qu’en réformant notre démocratie – en faisant en sorte que notre système de gouvernement rende des comptes à l’ensemble du peuple et reflète mieux les intérêts de tous – que nous parviendrons à résorber la grande fracture et à rétablir la prospérité partagée.
En savoir plus
«La grande fracture», Joseph E. Stiglitz, éd. les Liens qui Libèrent, 479 p., 25 €.