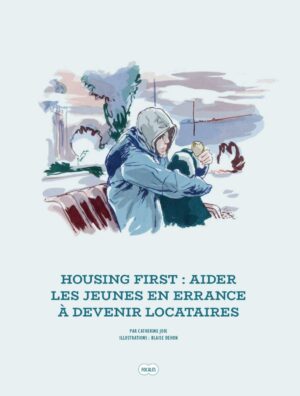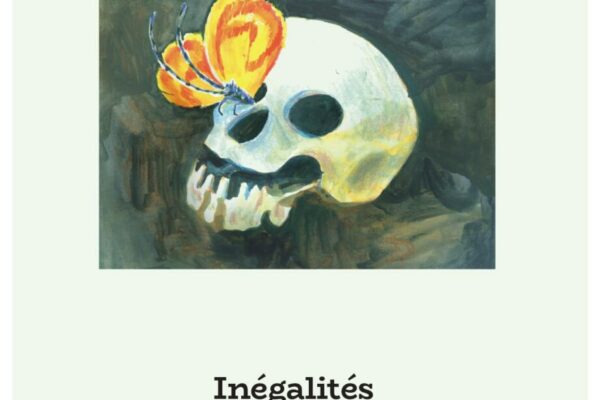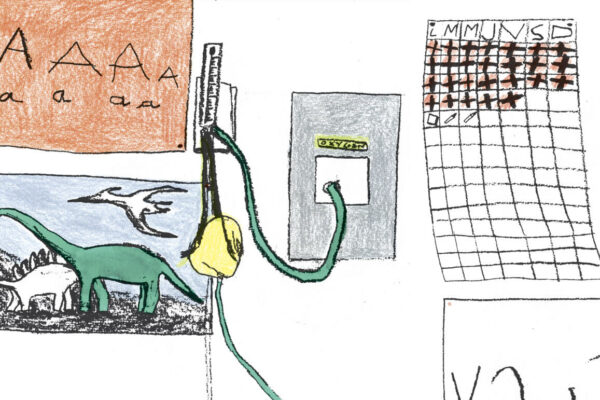Bruxelles, juin 2015.
Ribaucourt. Le lieu de deal est connu de tous: police, travailleurs sociaux, riverains. Un magasin de photocopies qui jouxte l’entrée du métro en fait même son petit négoce, vendant de l’aluminium prédécoupé. Auparavant, les bouteilles d’ammoniaque trônaient en vitrine, mais elles ont dû être enlevées.
Maigre, le regard couleur cendre mais rieur, James s’approche. Il a 54 ans et est polyconsommateur (il consomme, avec une certaine fréquence, plusieurs substances psychoactives). Sa main droite est volumineuse, y subsistent les cicatrices laissées par ses nombreuses injections. Des rides profondes sillonnent son visage malingre, qui se teinte de malice à l’évocation de son petit business dans le quartier: comme beaucoup, il deale un peu par-ci, un peu par-là, pour se faire de l’argent.
«Cela fait 35 ans que je consomme. À l’époque, on se faisait taper dessus par la police. Avec un casier judiciaire, après, c’était impossible de trouver un boulot. Alors on magouille pour survivre. Parce qu’avec 530 euros par mois c’est impossible.»
À quelques centaines de là, le canal gît, immobile, cachant en ses profondeurs secrets et mystères de Bruxelles. Nous sommes à la place Sainctelette, qui surplombe la station fantôme de la ligne 2 du métro de Bruxelles, entre Yser et Ribaucourt.
James habite à X., chez sa mère. «La rue pour moi, c’est fini», explique-t-il. Mais il ne veut pas consommer chez lui. Alors il vient ici. En dessous du pont de Sainctelette. À cet endroit de la ville, le pont qui chevauche le canal est large. Au-dessous, il regorge de petites salles enfouies sous la terre, dans lesquelles les consommateurs de cocaïne et d’héroïne se dissimulent du regard des passants pour fumer, se piquer. Ces lieux ont été fermés les uns après les autres. Mais l’un d’entre eux demeure ouvert.
Une fois fournis en dope, les consommateurs se rendent au Médibus s’il est là. Deux fois par semaine, le bus de Médecins du monde et de l’asbl Dune fait office d’espace de soins ambulant à destination des sans-abri et des toxicomanes. Ces derniers peuvent aussi y dégoter seringues et matériel stériles, avant de venir se camoufler ici, dans le ventre encrassé de la capitale, où ils viennent combler le manque.
Le long du pont, un escalier rejoint le quai: une porte, forcée, est ouverte. Personne à l’intérieur. Il fait noir, l’acidité de l’air prend aux narines. On entend le bruit saccadé des voitures circulant sur le pont sans se douter de la singularité des fragments de vie souterraine qui se déroulent sous la voirie. De gros tuyaux traversent le petit local. Au sol jonchent un amoncellement de détritus, canettes, seringues, excréments. Un cumulus de crasses qui s’accumule au fil du temps et des passages.
James pointe du doigt la berge opposée du canal. «En face, il y en avait qui dormaient. Et là, c’était mon endroit à moi, commente-t-il. Mais tout a été fermé. Et quand Bruxelles-les-bains va démarrer, ils vont fermer ce local-ci aussi.»
Ici les gars passent et repassent. Le lieu verrait défiler entre 200 et 300 personnes à la journée. «Les fumeurs, ils aiment bien s’asseoir et discuter. Les injecteurs, ils se trouvent un endroit. Ils se piquent et puis s’en vont.»
De l’autre côté du pont, quelques marches mènent à la rive. Les mêmes objets agrémentent le décor: seringues usagées, canettes éventrées. Une pipe à crack improvisée avec une petite bouteille en plastique. Des cuillères fabriquées avec des boîtes de soda. Des rebuts de citrons, qui remplacent l’acide ascorbique et permettent d’acidifier l’eau dans laquelle l’héroïne est dissoute. «Ils sont beaucoup trop acides, bourrés de bactéries et de produits chimiques, et tu te fous ça dans le bras…, commente Christopher Collin, coordinateur de l’asbl Dune, active dans la réduction des risques. On dit que les consommateurs ne prennent soin de rien. Mais ce sont les seuls endroits cachés qu’ils trouvent.»
(Entre-temps, le local a été fermé, mais les consommateurs continuent à fréquenter les berges du canal. Pendant ce temps, James a trouvé un appartement à lui.)