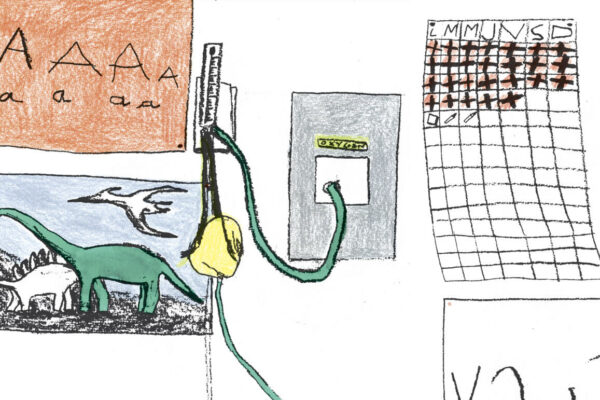Thomas, 28 ans, acquiesce. Le conflit de loyauté, il connaît sur le bout des doigts. Sa mère, qui souffrait aussi d’un trouble psychique, s’est suicidée l’année de ses 17 ans. Après des années difficiles, le jeune homme a repris des études de conseiller conjugal et familial, est devenu père, a commencé à voir un psychologue et finalement décidé de boucler la boucle en devenant stagiaire au sein de l’asbl Étincelle. «La première fois que j’ai parlé à Laure et Carole, c’était à l’enterrement de ma maman», raconte-t-il. Car avant de fonder leur association, les deux jeunes femmes intervenaient auprès de patients résidant en habitations protégées, dont la mère de Thomas. «Pour nous, ça a été un électrochoc, raconte aujourd’hui Laure Hosselet. Bien sûr, on avait souvent croisé Thomas et son petit frère, mais c’est seulement aux funérailles de sa maman qu’on a vraiment échangé avec lui… On s’est demandé comment on avait pu être aveugle à ce point: personne n’accompagnait ces enfants. Ça a été le déclic pour lancer l’association.»
«C’est un défaut du monde de la santé mentale : très peu de ponts existent entre le monde de l’enfance et celui de la psychiatrie adulte. Par conséquent, ces jeunes n’ont pas de lieu où adresser leurs questions alors qu’ils sont dans la colère, la honte, le doute, la culpabilité.» (Laure Hosselet, Etincelle)
Née en 2019, l’asbl propose des entretiens avec ces jeunes, des plus petits jusqu’aux 23-24 ans. Ces échanges peuvent être sollicités par le jeune lui-même, un membre de la famille ou ami ou encore certains professionnels du secteur de l’aide à la jeunesse ou de la psychiatrie. «C’est un défaut du monde de la santé mentale: très peu de ponts existent entre le monde de l’enfance et celui de la psychiatrie adulte, analyse Laure Hosselet. Par conséquent, ces jeunes n’ont pas de lieu où adresser leurs questions alors qu’ils sont dans la colère, la honte, le doute, la culpabilité.» Ces entretiens, qui ont lieu toutes les quatre à six semaines, s’inscrivent dans une démarche d’accompagnement plutôt que dans un processus proprement thérapeutique. «Par la force des choses, il y a un aspect thérapeutique, mais l’objectif d’Étincelle, c’est d’abord de rappeler que c’est le parent qui est malade et que les enfants ont besoin d’un espace pour partager leur peine, leurs questions.»
Avec ses homologues français (Les Funambules), suisse (Le Biceps) et luxembourgeois (Centre Kanel), Étincelle a par ailleurs mis sur pied un site Internet, JEFpsy (Jeune Enfant Fratrie), destiné aux jeunes à partir de 11 ans dont un parent, un frère ou une sœur a un trouble psychique. Le site propose un service de dialogue en ligne avec un psychologue, de même que des forums de discussion entre jeunes par visioconférence. «Au début du premier confinement, on s’est aperçu que certains jeunes étaient difficiles à joindre. Certains n’ont d’ailleurs pas de téléphone. Ce site leur permet de poser leurs questions, de témoigner, de trouver du soutien auprès d’autres jeunes qui vivent des situations similaires», précise Laure Hosselet. JEFpsy propose aussi de nombreuses ressources et informations sur la maladie et les interrogations récurrentes de ces enfants et adolescents telles que «J’ai l’impression que ça ne servira à rien d’en parler, que personne ne pourra comprendre», «Je n’arrive plus à penser à autre chose», «Je me sens différent(e) des autres», «J’ai envie que ça s’arrête, j’ai envie de partir» ou encore «J’ai peur de devenir malade»: «Les maladies psychiques ne sont pas contagieuses, répond JEF, mais l’angoisse et la peur peuvent être contagieuses. Si tu te retrouves coincé(e) dans un ascenseur avec une personne claustrophobe, tu vas probablement te sentir angoissé(e) toi-même, même si d’habitude tu prends l’ascenseur sans problème.»
«Je n’ai jamais dit la vérité quant à ce qui se passait à la maison. Je racontais que mon beau-père était chef cuistot, ce qui était faux. Je ne disais jamais quand ma maman était hospitalisée. Je disais tout et n’importe quoi.» (Thomas)
Autant de pensées qui ont jalonné la jeunesse de Thomas. «J’étais un enfant qui mentait beaucoup, raconte le stagiaire d’Étincelle. Je n’ai jamais dit la vérité quant à ce qui se passait à la maison. Je racontais que mon beau-père était chef cuistot, ce qui était faux. Je ne disais jamais quand ma maman était hospitalisée. Je disais tout et n’importe quoi.» D’habitations protégées en internats, d’un centre pour jeunes à un autre, Thomas finit par ne plus savoir ce qui est vrai. «On veut tellement être normal qu’on est dans le déni. On oublie ce qui se passe. On refoule.» Le chemin pour se retrouver peut être long, comme une enquête à laquelle il n’existe qu’une fin ouverte, mais qu’il faut mener quand même. Thomas s’y est engagé «pour pouvoir être authentique avec les autres». Les raisons pour lesquelles sa mère souffrait tant, il les a approchées petit à petit. Il a compris qu’elle supportait mal les méthodes éducatives de son compagnon envers ses fils. Qu’enfant hypersensible, elle avait manqué d’affection avant d’être violemment rejetée par ses parents pour avoir dit une fois qu’elle aimait les filles. Qu’il y avait quelque part un amour qu’elle voulait rejoindre sans le pouvoir. «Nous sommes souvent les confidents du parent, constate-t-il. Ce n’est pas forcément très sain. Mais ce n’était pas une maman comme les autres. Et contrairement aux autres enfants qui veulent que leur parent reste avec leur partenaire, mon frère et moi comprenions ça. Nous voulions ce qui était bien pour elle.» Rien, à bien y réfléchir, ne fut jamais ordinaire. À 6 ans, Thomas se levait pour donner le biberon à son petit frère quand sa mère était incapable de le faire. Il a dû bien des fois redoubler de force parce qu’elle voulait se jeter par la fenêtre. Bien des fois appelé l’ambulance parce que le sang coulait dans la salle de bain. Bien des fois tremblé et espéré. «Parfois, nous devions entrer dans son mode de pensée, jouer le jeu. Lorsqu’elle était persuadée que le voisin voulait tuer mon frère, nous racontions qu’elle ne devait pas s’en faire, car nous avions fait la paix avec lui.»