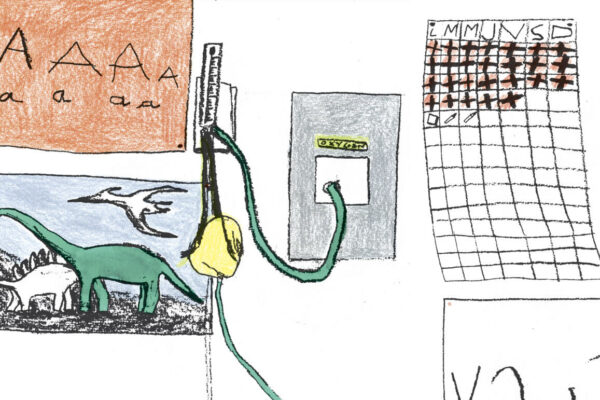L’avenue de Loudun est une nationale comme on en compte des dizaines en Wallonie. Le long de cette bande de bitume rectiligne qui relie la gare de Leuze-en-Hainaut au «vieux Leuze» se dresse, de l’autre côté d’un large portail coulissant, une chapelle au clocher élancé. Elle est le reliquat de l’époque où, en 1905, l’Ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu a élu domicile dans cette petite commune située entre Ath et Tournai pour y ouvrir un hôpital psychiatrique. Géré par les frères, des religieux français, l’hôpital avait tout d’un asile de l’époque, probablement assez proche des représentations hollywoodiennes de la folie qui ont abreuvé notre imaginaire collectif. «Si jamais t’es pas sage, c’est là que tu finiras», à «l’asile de fous»: voilà ce qu’on a longtemps dit dans la région pour désigner l’hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu. Aujourd’hui encore, quand on parle d’aller au «vieux Leuze», les gens du coin savent ce qu’on entend par-là.
De l’époque des frères, il ne reste aujourd’hui plus grand-chose. En 1976, la gestion de l’institut a été reprise par l’Acis, l’Association chrétienne des institutions sociales et de santé. Hormis la chapelle, un seul bâtiment de l’époque a été conservé: l’Écheveau. L’ancienne cafétéria, située à l’entrée de l’hôpital, a été reconvertie en un «bar à médiation culturelle», devenu le quartier-général du service culturel de l’hôpital. L’Écheveau a d’ailleurs donné son nom au projet, qui le porte bien: un entrelacs de dimensions et d’axes de travail au service d’un objectif commun, la culture. Le projet a achevé de métamorphoser l’identité de cet hôpital psychiatrique, désormais à des années lumières de l’«asile de fous» peuplé de patients isolés, médicamentés, immobilisés.
Laurent Bouchain, le coordinateur de l’Écheveau, remonte pour nous le fil de l’histoire. Le metteur en scène et dramaturge de formation, barbe et cheveux blancs coupés courts, raconte comment tout a commencé, dans les années 90, par des ateliers de théâtre, puis d’écriture, puis de vidéo… «C’est comme ça que, progressivement, la culture a commencé à s’inscrire dans l’hôpital. Le temps passant, la direction m’a proposé un emploi à quart-temps pour étudier la faisabilité d’implanter une véritable orientation culturelle au sein de l’hôpital.»
L’énergie de Laurent Bouchain a croisé la volonté du comité de direction de l’époque. Jean-Philippe Verheye, ancien membre du comité de direction et directeur de l’hôpital depuis 2017, se plaît toujours à raconter, à quelques jours de la retraite, comment la culture «a pris de plus en plus de place au sein de l’institution», au point que «si on laissait faire Laurent, on ne serait plus un hôpital psychiatrique mais un centre culturel», lâche-t-il sur le ton de la blague.