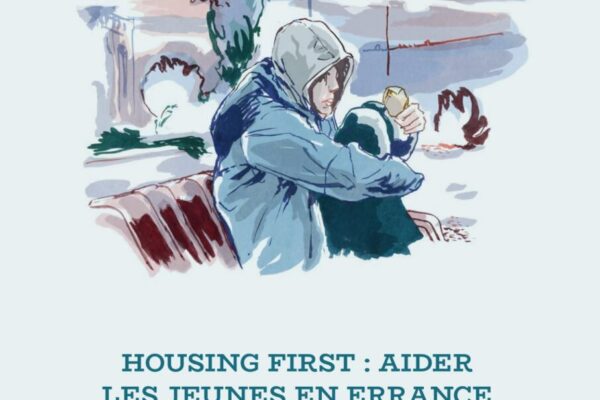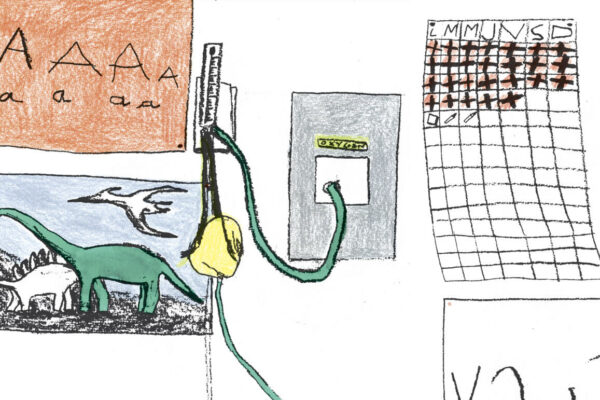L’accompagnement s’opère en profondeur. Pour trouver un logement par exemple, l’équipe épluche les petites annonces, fait appel au «capteur logement» du Relais social, visite les lieux avec la personne accompagnée, rencontre le propriétaire. «On sait que ça le rassure quand un service social veille à ce que le loyer soit payé.» Des filles viennent chaque mois à la permanence pour effectuer leurs virements bancaires, gérer leur administration, pour être sûres d’être bien en ordre. À l’inverse, d’autres débarquent à l’improviste avec des tracas récurrents d’huissiers, de radiation du CPAS, de non-présentation aux autorités… «Elles s’effilochent», illustre poétiquement Martine Di Marino. Derrière ces mots se dessine une sorte de dissociation du corps et de l’esprit qui n’est pas spécifique à la prostitution, mais la conséquence d’une grande précarité économique et mentale, d’une réalité compliquée, d’une existence abîmée.
À quelques pas du bureau, Laetitia Collet salue Fatou*, installée sur les marches d’un immeuble à la porte grande ouverte. Il fait chaud et on parle de la météo, on prend des nouvelles des enfants. Fatou accepte les préservatifs, mais elle ne discutera pas plus longuement. «Il faut saisir l’instant, car on rogne sur leur temps de travail, dit l’assistante sociale. Je peux rester une heure avec elles si elles le veulent, si elles ont besoin de tout déballer… Et quand un client approche ou qu’elles reçoivent un coup de téléphone, je m’éclipse.»
Un peu plus loin, Marguerite* stationne devant une terrasse aux trois quarts déserte. Elle accepte aussi volontiers le matériel qui lui est offert. Plus loquace, elle raconte sa relation avec l’association. «Nous autres, ça fait bien longtemps qu’on se connaît, dit-elle. On va chez elles quand on a des petits problèmes, quand on a envie de boire un thé ou un café. Elles aident dans les papiers, elles nous apportent des préservatifs et des désinfectants. Ça sert toujours et, si ça ne nous sert pas à nous, on en passe à d’autres filles.» La solidarité demeure, mais ce n’est plus comme avant. «Le quartier a beaucoup changé, relève-t-elle, ça devient plus rien… Je suis dans ce quartier depuis passé trente-sept ans, trente-sept ans dans le métier. Il y avait les hôtels, il y avait les bars, il y avait les filles dans la rue, il y avait un peu de toute sorte et maintenant il n’y a plus rien. Les conditions de vie ont changé, largement. On doit faire beaucoup plus attention, dans tous les sens: la sécurité, la santé…» Marguerite a la soixantaine. Il n’y a pas de retraite dans la prostitution, alors elle anticipe l’avenir: «De toute façon ils vont fermer et les filles ne pourront plus venir travailler. Mais moi, je m’en irai si je veux!» Entre les lignes néanmoins, l’envie de raccrocher. «J’ai décidé de me lancer dans la pâtisserie et d’en vendre», dit-elle. Cette envie d’autre chose qui lui trotte en tête, elle en parle depuis longtemps. «Je ne vais pas dire que c’est un fantasme, relativise Laetitia Collet, mais elle sait très bien que ce n’est pas ça qui la fera vivre. Je pense qu’elle a vraiment envie d’arrêter, mais financièrement elle ne peut pas.» Tout tient à cela. «C’est un choix dans un non-choix», résume Martine Di Marino.
«Le quartier a beaucoup changé, ça devient plus rien… Je suis dans ce quartier depuis passé trente-sept ans, trente-sept ans dans le métier. Il y avait les hôtels, il y avait les bars, il y avait les filles dans la rue, il y avait un peu de toutes sortes et maintenant il n’y a plus rien. Les conditions de vie ont changé, largement. On doit faire beaucoup plus attention, dans tous les sens: la sécurité, la santé…» Marguerite
Jusqu’à la fin des années 90, la prostitution se partageait entre le racolage de rue et les très nombreux bars de la Ville-Basse. Le quartier du Triangle – rue Desandrouin, rue du Moulin, rue de la Fenderie – en était le cœur palpitant. «C’était le quartier obligé quand on était de sortie, tout le monde passait par ici», se souvient la coordinatrice d’Entre 2 Wallonie. C’est ici aussi que se trouvent les bureaux de l’association, mais aujourd’hui ne voisinent plus que des façades borgnes, un semblant de placette, des tags. Un chancre urbain, et des femmes qui tapinent. Car les rues de Charleroi ont changé.
En 2002, les bars tombent les uns après les autres sous le coup de la traite des êtres humains (TEH) et ils sont interdits de réouverture. «Il y en avait une vingtaine ici, une maison sur deux. Les propriétaires n’ont pas investi dans leur réaffectation en logements… et d’ailleurs qui voudrait venir s’y installer? Le quartier est abandonné des promoteurs et on attend sa réhabilitation depuis des années. C’est un coupe-gorge», poursuit la coordinatrice. En revanche, la prostitution de rue s’y développe.
Pour améliorer son image et favoriser un redressement économique, Charleroi lance le projet Rive gauche et le projet Phénix en 2007-2008: création d’un centre commercial et remodelage du plan de cette partie de la ville. Les activités du Triangle cadraient peu avec ces visées; elles y seront d’ailleurs interdites en 2010, mais essaimeront dans d’autres artères où elles seront aussi prohibées un an plus tard. Le texte proposera d’éloigner ce commerce à la rue des Rivages, notamment, et imposera un horaire très strict. Les arrestations administratives pleuvent, les associations se mobilisent – en vain –, craignant le développement d’une prostitution clandestine et de ce fait la perte du lien avec les personnes qui en ont le plus besoin. Cette excentration accroît l’insécurité.
Depuis 2014, un nouveau règlement communal stipule que «la seule présence sur la voie publique des personnes se destinant activement à la prostitution est interdite sur l’ensemble du territoire communal». Dans les faits, interdire n’a rien fait disparaître. «Il y a vraiment eu un appel d’air et un mélange impressionnant entre traite des êtres humains et toxicomanie… C’était le Bronx. Ils voulaient que le centre-ville soit propre, mais les trafics en tout genre, les réseaux et les pratiques en privé ont explosé, raconte Martine Di Marino. Plus du tout la prostitution de départ, mais une prostitution d’une grande fragilité, répandue dans toute la ville.» Pour les services d’aide, il est devenu plus compliqué d’établir et de maintenir un contact avec les filles. «Une partie des anciennes sont toujours là, mais elles ont plus d’emmerdes puisqu’il y a plus de contrôles», constate-t-elle. Les hôtels de passe ont été fermés, démolis. Il n’en reste qu’un, le Pink. Plus de vitrines, et guère de chambres, les choses se déroulent dans les voitures et dans des recoins sombres. Quelques filles possèdent heureusement un petit studio, elles y sont quelquefois domiciliées et on ne peut rien leur faire, mais, pour la majorité, le système de la sous-location, et de la sous-sous-location, est la règle.
Un autre constat est l’augmentation des problèmes de santé mentale non traités. «Cumulés avec la toxicomanie, c’est un cercle vicieux, poursuit la coordinatrice. Pour pouvoir être sevré, il faut être soigné et inversement. Avec notre public, on ne va nulle part. On gagne tout au plus un répit de quinze jours dans une institution et puis c’est reparti, on tourne en rond.»