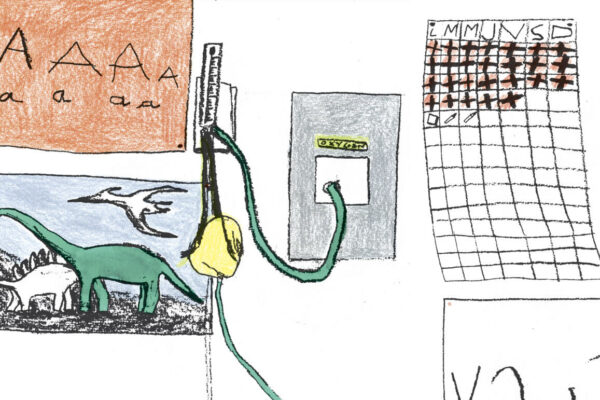Thaïs se niche sur les hauteurs de Liège, rue Pierreuse. Une rue qui porte bien son nom. De gros pavés dans une ruelle étroite et une fameuse dénivelée qui met les poussettes pour enfants et les cœurs fatigués à rude épreuve. Dans ce quartier populaire, on monte, on descend, on remonte. Comme dans la vie.
 Thaïs, c’était une belle courtisane athénienne qui a vécu au IVe siècle avant notre ère. Elle a été la favorite des puissants de l’époque et la compagne notamment d’Alexandre le Grand dans ses invasions asiatiques avant de devenir reine d’Égypte. Thaïs, en langage associatif, c’est l’acronyme de «Temps d’hébergement, d’accueil et d’insertion sociale». Ici, c’est plutôt un voyage en grande précarité dont il est question. Jusqu’en 2006, Thaïs a été un lieu d’hébergement provisoire de personnes prostituées à Liège au sein de l’association «Le Nid». Depuis lors, les prostitué(e)s et les toxicomanes restent un public auquel Thaïs est particulièrement attentif, mais leur prise en charge n’est plus l’objet principal de l’action de l’association liégeoise. Celle-ci s’est élargie à l’hébergement et le suivi de toutes les personnes précarisées, isolés, familles avec enfants et couples.
Thaïs, c’était une belle courtisane athénienne qui a vécu au IVe siècle avant notre ère. Elle a été la favorite des puissants de l’époque et la compagne notamment d’Alexandre le Grand dans ses invasions asiatiques avant de devenir reine d’Égypte. Thaïs, en langage associatif, c’est l’acronyme de «Temps d’hébergement, d’accueil et d’insertion sociale». Ici, c’est plutôt un voyage en grande précarité dont il est question. Jusqu’en 2006, Thaïs a été un lieu d’hébergement provisoire de personnes prostituées à Liège au sein de l’association «Le Nid». Depuis lors, les prostitué(e)s et les toxicomanes restent un public auquel Thaïs est particulièrement attentif, mais leur prise en charge n’est plus l’objet principal de l’action de l’association liégeoise. Celle-ci s’est élargie à l’hébergement et le suivi de toutes les personnes précarisées, isolés, familles avec enfants et couples.
«Le logement, c’est la porte d’entrée de Thaïs», résume Michèle Van De Moortele, directrice de Thaïs. La maison d’accueil, avec ses neuf structures d’hébergement, est la principale activité de l’association, celle qui mobilise le plus de personnel. La particularité de Thaïs est d’être accessible aux couples et aux familles avec enfants, ce qui est plutôt rare dans ce secteur. Mais chez Thaïs, on est pragmatique avant tout: «Les gens vivent en couple, c’est une réalité. Pourquoi les séparer?» Le point commun de toutes les personnes accueillies, c’est leur grande précarité. «Certains sont logés chez des amis, d’autres vivent sous tente, dans leur voiture, explique Caroline Charneux, travailleuse psychosociale. Ils n’ont pas de logement, pas de revenus, des tas de problèmes administratifs.» Ils sont souvent orientés par d’autres associations, les CPAS et, très souvent, par les hôpitaux de la région liégeoise.
Un engagement mutuel
L’urgence sociale n’est pourtant pas le «sésame» pour bénéficier d’un logement chez Thaïs. «Nous n’hébergeons jamais dans l’urgence, explique la directrice. S’il faut une réponse immédiate, nous orientons vers d’autres maisons d’accueil.» Pour entrer chez Thaïs, il faut être «accepté». Le travailleur social qui a rencontré la personne ou la famille en difficulté présente son cas à l’équipe qui décide ou non d’intervenir. Ce n’est qu’après un second entretien avec d’autres travailleurs sociaux que la personne est ou non intégrée dans le projet. Être aidé par Thaïs suppose en effet un engagement mutuel. Avoir un logement n’est pas une fin en soi. Il y a aussi tout l’accompagnement social apporté par les travailleurs sociaux de l’association, auquel la personne doit participer volontairement. Cela implique par exemple la visite régulière des travailleurs de Thaïs au domicile, cela suppose aussi d’accepter les termes du contrat d’hébergement, 18 mois au maximum. «Cela peut heurter, c’est vrai, concède Caroline. Et donc ne pas intéresser ceux qui veulent un toit tout de suite. Mais l’accompagnement individualisé, c’est l’ADN de notre projet.»
Simone (prénom d’emprunt) a vécu ce genre de dilemme. Cette Camerounaise, qui vivait sans papiers dans un squat avec un bébé, avait besoin d’une adresse de référence pour tenter d’obtenir sa régularisation. «Je voulais que Thaïs soit ma ‘boîte aux lettres’, rien de plus. J’avais essayé de trouver un logement à Liège, en vain. Je ne recevais que l’aide médicale urgente du CPAS.» La jeune femme comprend vite qu’elle n’a pas affaire qu’à de simples «distributeurs de lits». Qu’il lui faut développer d’autres objectifs: une chambre d’accord mais aussi pouvoir vivre en Belgique, avec des papiers, avec des perspectives d’emploi. «Je n’avais rien à perdre. J’ai accepté mais, dans ma tête, j’avais anticipé l’échec. Alors, quand ils m’ont appelée fin janvier, je n’en revenais pas. Je me suis retrouvée avec ma fille dans une petite maison. Ils m’ont donné le coup de pouce juridique nécessaire et j’ai été régularisée. Je dois reconnaître qu’ils avaient raison. Trouver un logement ne suffisait pas pour que je m’en sorte.»
L’accompagnement peut prendre bien des formes. Reprendre une formation, obtenir l’aide du CPAS, en finir avec l’alcool ou les médicaments. Ou parfois tout simplement «récupérer» du stress provoqué le fait de vivre au jour le jour. Clémentine Vasseur est entrée chez Thaïs au hasard d’un stage en psychomotricité. Elle a découvert toute l’importance de travailler sur la dynamique familiale de familles déboussolées dans tous les sens du terme. «Ce sont des familles qui ont souvent eu recours à des tas d’institutions pour leurs enfants (ONE, écoles, hôpitaux). Avec elles, je tente de développer le lien d’attachement avec les enfants.» Clémentine fait des massages aux bébés, apprend aux adultes à se relaxer, à jouer avec les enfants. Le but est aussi de permettre aux parents de se «recentrer» sur eux-mêmes. «C’est un outil que nous expérimentons, explique Michèle Van De Moortele. Il renforce l’image positive des parents.»
Un public plus hétérogène
La grande précarité marque les corps, les esprits. Le service ambulatoire de Thaïs travaille avec un public très différent de celui accueilli dans les maisons d’accueil. «On est moins confronté à l’urgence sociale», explique Marc Tridetti, travailleur social. Mais 72 personnes ont tout de même fait appel à ce service en 2016. Le logement reste toujours la première demande mais elle cache presque toujours d’autres problèmes: assuétudes, alcool (près de la moitié des personnes concernées!), prostitution, problèmes administratifs, de comportements. Pour Marc, «il ne suffit pas d’entendre dire ‘j’ai perdu mon logement’. On doit s’interroger avec la personne quand c’est la dixième fois que cela lui arrive». Trouver un logement pour un public précaire n’est pas chose simple et quand la personne a des problèmes d’alcool, de toxicomanie ou vit de la prostitution, c’est mille fois plus compliqué encore. Thaïs travaille avec d’autres partenaires pour gérer ces problèmes d’addiction. Le travail social en ambulatoire prend du temps. Parfois certains décrochent. «Je les relance une fois, deux fois, explique Marc. S’ils ne reviennent pas, c’est leur responsabilité. Il arrive aussi que des personnes viennent nous retrouver, des mois, des années plus tard, dès qu’elles vivent un nouveau gros problème. C’est même fréquent.»
Au cours des cinq dernières années, Thaïs a vu évoluer son public. Moins d’habitants du quartier populaire dans lequel l’association est installée, beaucoup de Liégeois encore mais aussi de plus en plus de personnes d’origine étrangère. Dans le service ambulatoire, c’est très net, constate Marc Tridetti. La directrice confirme: «Ce sont le plus souvent des personnes qui sortent des structures d’accueil de Fedasil. Mais cela peut être aussi des sans-papiers qui n’ont aucun revenu. Cela réoriente nos pratiques. Nous sommes davantage confrontés à des problèmes culturels, de communication, des difficultés administratives importantes. C’est un défi nouveau que nous devons rencontrer.»
Simone, la Camerounaise, fait partie de ce «nouveau» public. Elle a quitté la maison d’accueil de Thaïs après quelques mois et a trouvé une maison à Sclessin. Le squat est loin, et son premier objectif en arrivant en Belgique, aussi. «Avant, je voulais obtenir l’asile, avoir un droit au séjour mais aussi, un jour, rentrer chez moi. Maintenant, j’hésite. J’ai un enfant belge, des papiers, des revenus et bientôt peut-être un emploi. Le Cameroun s’éloigne. Et Liège… Liège, c’est bien comme ville finalement.»






 Quand Coralie tombe enceinte par «accident» de Camille, elle demande à pouvoir entrer en maison maternelle. «J’avais peur d’un refus. On m’avait dit: il y a 17 personnes sur la liste d’attente.» C’est la maison maternelle qui va l’orienter vers Thaïs. Et cette fois encore, Coralie redoute le rejet. «J’ai si souvent demandé de l’aide, en vain. Quand je suis entrée en contact avec Thaïs, quand ils m’ont expliqué leur fonctionnement, j’ai paniqué à l’idée de ne pas être acceptée. Et lorsque j’ai reçu une réponse positive, j’ai pleuré, je me suis effondrée.»
Quand Coralie tombe enceinte par «accident» de Camille, elle demande à pouvoir entrer en maison maternelle. «J’avais peur d’un refus. On m’avait dit: il y a 17 personnes sur la liste d’attente.» C’est la maison maternelle qui va l’orienter vers Thaïs. Et cette fois encore, Coralie redoute le rejet. «J’ai si souvent demandé de l’aide, en vain. Quand je suis entrée en contact avec Thaïs, quand ils m’ont expliqué leur fonctionnement, j’ai paniqué à l’idée de ne pas être acceptée. Et lorsque j’ai reçu une réponse positive, j’ai pleuré, je me suis effondrée.»