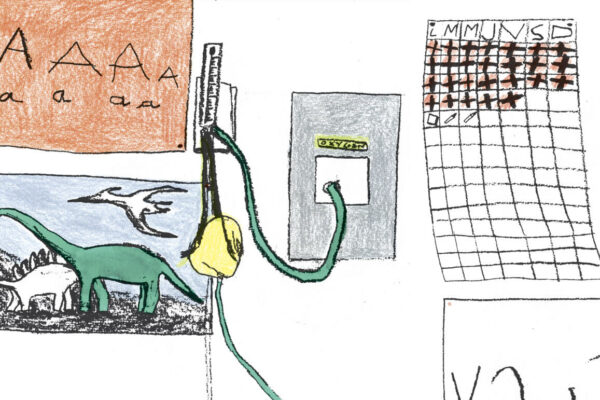Créés dans la foulée de la ratification du traité d’Istanbul, les CPVS de Liège, Gand et Bruxelles ont fêté leur première année d’existence en novembre 2018. Porté par la secrétaire d’État à l’Égalité des chances, Zuhal Demir, le projet devrait, selon tous les indicateurs, connaître des prolongations, avec l’ouverture prochaine d’autres centres, de manière à pouvoir couvrir l’ensemble du territoire. Regrouper en un seul lieu, ouvert 24 h/24 et 7 jours/7, tous les services dont une victime de violences sexuelles peut avoir besoin était un vœu porté depuis longtemps par les associations féministes, mais aussi une recommandation de l’Organisation mondiale de la santé. «L’idée, c’est d’offrir en un seul lieu une prise en charge médicale, policière et judiciaire, avec la possibilité de traiter des aspects rébarbatifs comme la déposition d’une plainte et les prélèvements. L’objectif, c’est de mettre la victime dans un cocon et de lui permettre d’effectuer des démarches complètes et correctes. De cette manière, la probabilité d’arriver à une judiciarisation et à une condamnation des auteurs est aussi plus grande. Or, permettre une plus grande condamnation d’auteurs, c’est aussi permettre un cheminement plus positif pour les victimes. Savoir qu’une suite est possible fait partie du processus de guérison», explique Virginie Baÿ, infirmière responsable du CPVS de Liège.
Des victimes aux profils diversifiés
Moins d’un an après l’ouverture du centre, plus de 200 victimes avaient déjà été accueillies dans ce CPVS, soit le double de l’objectif minimal basé sur le nombre annuel de dossiers ouverts à la police de liège. «On sait que ça ne représente que 10% des agressions qui ont réellement lieu», précise Nathalie Vandeweerd, magistrate au parquet de Liège. Élaboré par l’Université de Gand, le protocole du projet s’inspire en grande partie du modèle britannique: en Grande-Bretagne, cette prise en charge coordonnée est la norme depuis les années 2000.
Premier constat dressé par le CPVS de Liège: les victimes de violences sexuelles présentent des profils extrêmement diversifiés. «Il n’y a pas deux histoires identiques: il existe une variabilité, une diversité de problématiques assez inimaginable… Nous avions nous aussi des stéréotypes: nous pensions que nous aurions beaucoup de jeunes filles habillées sexy agressées dans le cadre de soirées festives qui dérapent. Mais ce n’est pas la majorité. La réalité, c’est que ça peut arriver à n’importe qui, n’importe où, n’importe quand…, explique Virginie Baÿ. La majorité de victimes sont des femmes entre 18 et 50 ans mais nous avons aussi eu une femme de 80 ans… Parfois, certaines personnes arrivent chez nous pour des faits anciens et nous essayons alors de les rediriger vers des services extérieurs d’aide psychologique comme SOS Viol.»
Au-delà de la diversité des profils, le fait de se trouver dans une situation de domination – qu’elle soit économique, sociale, administrative, etc. – constitue cependant un important facteur de risque. Personnes sans domicile fixe, fragilisées socialement, migrantes, ou encore présentant une déficience mentale sont particulièrement exposées. Quant aux hommes, s’ils représentent une infime partie des victimes déclarées, il faut ici encore compter avec une invisibilisation du phénomène. «Peut-être que les hommes se manifestent encore moins. Dans le milieu homosexuel, il est par ailleurs probable qu’ils se tournent davantage vers les associations.» Le CPVS accueille par ailleurs les enfants et adolescents, particulièrement exposés eux aussi à ce type de violences. «Quand un jeune de moins de 18 ans – âge de la majorité légale – se présente, nous sommes dans l’obligation d’avertir les parents. Si beaucoup de jeunes, parfois accompagnés par un ami ou les parents d’un ami, sont très réticents au début, le dialogue permet souvent de les convaincre que ce n’est pas une mauvaise chose», commente Virginie Baÿ.