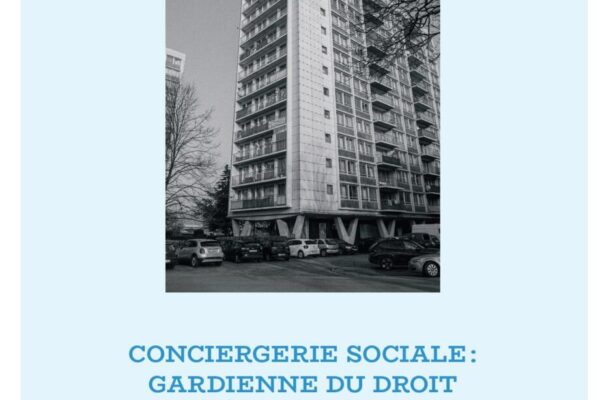Mehdi Mabrouk est sociologue à l’université de Tunis. Il est spécialiste des phénomènes migratoires et a publié en 2008 Voiles et sel1,un ouvrage sur la migration clandestine. Il évoque les « Harragas », ces jeunes clandestins qui quittent la Tunisie par milliers depuis la révolution. Pour lesjeunes, le chômage est toujours là, ainsi qu’une vieille garde politique qui tient le pouvoir.
 Alter Echos : Malgré la révolution, on constate que les jeunes n’ont pas cessé de quitter la Tunisie ou de vouloir la quitter. Comment expliquez-vous cephénomène ?
Alter Echos : Malgré la révolution, on constate que les jeunes n’ont pas cessé de quitter la Tunisie ou de vouloir la quitter. Comment expliquez-vous cephénomène ?
Mehdi Mabrouk : La révolution a été le résultat de deux logiques. Il y a eu les jeunes qui ont dénoncé leur situation socio-économiqueavec le slogan « le travail est un droit, à bas les voleurs ». Cela répondait à une logique sociale et juvénile. La deuxième logiqueétait strictement politique, axée sur les droits et libertés, sur la lutte contre les tortures. Les plus âgés se situaient davantage dans cette dynamique.Après la chute de Ben Ali, ceux qui axaient leur action sur les libertés ont atteint leur but. Ceux qui en bénéficient sont surtout les adultes et les plusâgés, une certaine gérontocratie politique impliquée dans les partis, la presse ou les universités. Quelques jeunes essaient de s’organiser mais ils sont peunombreux. Quant à la situation socio-économique, elle ne s’est pas du tout améliorée. Avant la révolution, il y avait 540 000 chômeurs. Aujourd’hui il yen a 780 000. Entre les Tunisiens expulsés de Libye et les jeunes diplômés qui sortent chaque année des universités, cela fait beaucoup de nouveauxchômeurs.
AE : C’est donc la situation socio-économique qui pousse de nombreux jeunes à rêver d’exil ?
MM : Bien sûr. Regardons le taux de chômage. Sous l’ancien régime, il était officiellement de 14,7 %. Mais on sait qu’il était de 30 % chezles 19-28 ans et même de 60 % chez les diplômés Bac+3 dans les branches scientifiques et littéraires. On a d’ailleurs longtemps évoqué en Tunisie unesorte de « frustration inverse ». Quand on est jeune est diplômé, on a de grandes attentes. Mais en Tunisie, on est sanctionné. C’est assez paradoxal. Ilfaut donc comprendre ceux qui partent. Il y a en effet un continuum de la migration.
AE : Cela change-t-il ? Les jeunes diplômés ne sont-ils pas ceux qui justement se mobilisent le plus, espérant tirer des profits du futurrégime ?
MM : Oui, pas mal d’enquêtes réalisées après le 14 janvier le confirment. Ceux qui s’investissent dans la vie citoyenne sont en effet de jeunesdiplômés qui espèrent que leur situation va changer. Du coup, les jeunes des catégories sociales inférieures se sentent dévalorisés car ils savent bienque la priorité sera justement donnée aux jeunes éduqués.
AE : Les départs clandestins de Tunisie n’ont jamais été aussi nombreux qu’après la révolution…
MM : En février, le nombre de Harragas a explosé car il n’y avait aucun contrôle des frontières. La majorité des jeunes n’a pas beaucoup d’espoir quela révolution change beaucoup de choses dans de brefs délais. Alors, en l’absence de forces de police, ils se sont engouffrés dans cette possibilité. Il y avaitjusqu’à 3 000 départs par jour, ce qui est énorme. Depuis que les forces de sécurité ont repris leurs fonctions, il n’y a plus de grandes vagues dedéparts. Néanmoins, l’émigration est un phénomène social structurel qui ne peut pas être changé par le seul changement de régime. Elledépend de données complexes comme le développement inégalitaire. Un nouveau partenariat entre l’Europe et la Tunisie exigerait selon moi l’instauration d’uneliberté de circulation.
AE : Y a-t-il un profil type du jeune Tunisien qui s’exile ?
MM : On peut se demander pourquoi, dans les mêmes conditions, il y a ceux qui partent et ceux qui restent. L’histoire personnelle et le caractère entrent en ligne decompte. Cela dépend aussi de la capacité de mobilisation de ressources « socio-spatiales ». En gros, il s’agit d’avoir une famille prête à cotiser pour financer le voyage. Ilfaut aussi avoir des compétences pour s’infiltrer dans le monde des Harragas (clandestins) qui nécessite des connivences, des connaissances, des médiateurs. Certains arriventà mobiliser ces ressources, d’autres pas. Il existe une logique de tri.
AE : Pour eux, la révolution n’a rien changé ?
MM : Disons qu’il y a un attachement affectif à la révolution qui varie en fonction des individus. Certains sont très attachés à la construction dela vie démocratique et d’autres non ; il y a plusieurs manières d’être attaché. Des jeunes pensent que la révolution « c’est fait, c’estfini » et qu’il faut passer à autre chose.
AE : Quand les jeunes restent, s’intéressent-ils pour autant à la nouvelle donne démocratique tunisienne ?
MM : On constate un certain désintéressement des jeunes. Les 18-25 ans se sont peu inscrits sur les listes électorales (environ 6 à 8 % d’entre eux).Ceci étant dit, on peut toujours voter, même sans s’être inscrit au préalable. Donc rien n’est perdu. Nous faisons des campagnes pour encourager à voter.Néanmoins, c’est un indice important qui confirme certains sondages sérieux sortis en juin et en août, qui pointent une crise de confiance presque totale chez les jeunes. Il y aune méfiance et une défiance par rapport à ce gouvernement et même, plus largement, par rapport aux partis. A mon avis, c’est dû à cette gérontocratiequi garde le contrôle.
AE : Dans ce contexte de désintéressement, restez-vous optimiste quant à l’avenir de la Tunisie ?
MM : Sur le plan politique, je suis un peu optimiste. La transition exige de l’imagination et des compromis. Il y a des atouts. Notamment la liberté d’expression que je goutteavec plaisir. Il était impossible d’imaginer avant de pouvoir discuter en toute liberté à la terrasse d’un café avec un journaliste comme nous sommes en train de le faire.D’un autre côté, je suis un peu pessimiste, sur les aspects sociaux essentiellement. Je n’ai pas de grand espoir concernant la précarité des jeunes, du moins dans de brefsdélais. La situation du pays est difficile, nous sommes un peu écrasés entre deux géants et nous n’avons pas leurs ressources naturelles. Nous avons un bon capital humaingrâce à Bourguiba, qui avait fait le choix d’investir dans l’enseignement. Mais le contexte international est complexe. Je crains qu’on n’arrive pas à répondre &a
grave; ceproblème des jeunes, qui pourrait empêcher une réussite de la transition démocratique.
AE : Avez-vous en tête de possibles solutions ?
MM : Au plan socio-économique, il n’y a pas de baguette magique. Je crois que l’investissement étranger et national pourrait aider à résoudre nosproblèmes. Mener des réformes de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption pourrait aider à améliorer la situation. Prenons l’exemple du textile, secteur oùla Tunisie était très compétitive notamment grâce aux investissements des Belges. Eh bien, ce secteur a beaucoup souffert de l’image de corruptiongénéralisée dans l’économie. C’est important car la situation est très difficile dans certains quartiers défavorisés où l’on constate que lacriminalité sociale (violences, drogues, meurtres) a été multipliée par trois depuis la révolution. En contribuant à résoudre le chômage, onpourrait éviter un échec de la révolution. Il faut savoir que jusqu’à présent, sur les 80 000 diplômés qui sortaient chaque année del’université, seuls 20 % trouvaient un travail.
Entretien réalisé à Tunis
1. Voiles et Sel, Mehdi Mabrouk. Editions Sahar, 2010.