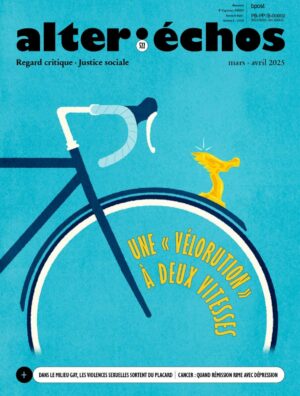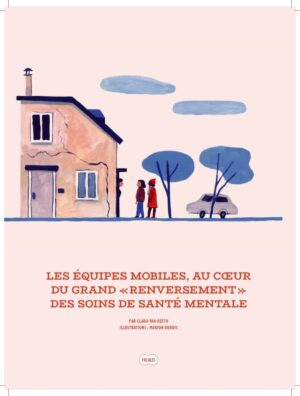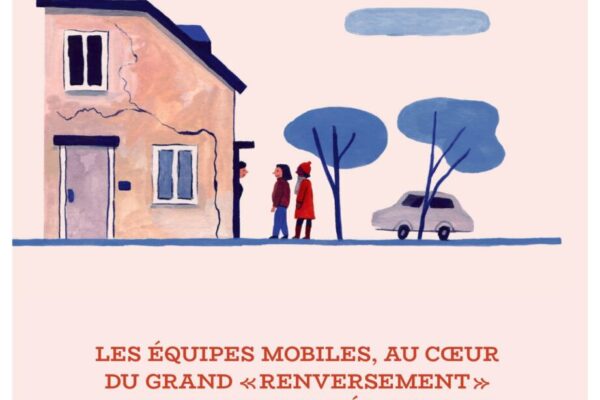En 2014, Namur adopte un règlement communal à la mendicité. La Ville justifie cette décision en se fondant sur des incidents et des plaintes concernant cette pratique. Le règlement prévoit une interdiction générale de la mendicité dans de nombreux quartiers de la ville. En outre, la commune interdit sur l’ensemble du territoire de mendier en compagnie d’un mineur de moins de 16 ans ou en compagnie d’un animal potentiellement dangereux ou susceptible de le devenir.
«En s’attaquant à la mendicité sans distinction, ne risque-t-on pas de déplacer les personnes pratiquant cette activité vers des communes ou des quartiers moins équipés en services et associations qui accompagnent, soignent et aident ces personnes?», réagit à l’époque l’écologiste Philippe Defeyt, président du CPAS de la capitale wallonne et membre de la majorité communale.
Lorsque Namur a annoncé son intention d’interdire l’occupation de certains lieux par les mendiants, les réactions des associations n’ont pas traîné. Luttes Solidarités Travail (LST), une asbl namuroise active depuis les années 70, est notamment montée au créneau en protestant dans une lettre ouverte adressée aux représentants politiques.
«Namur ne veut plus de mendiants dans son centre-ville. Le but: protéger les commerçants, les clients, les touristes de la prétendue agressivité des mendiants. La manche est un moyen de survie, un travail, mais, voilà, il faut faire place nette. Il est difficile pour certains de cacher que la misère est en bas de chez nous. Les riches plus riches et le mendiant plus pauvre. Belle perspective pour l’avenir», pouvait-on lire dans ce courrier.
La Ville justifie cette décision en se fondant sur des incidents et des plaintes concernant cette pratique. Le règlement prévoit une interdiction générale de la mendicité dans de nombreux quartiers de la ville.
«Nous ne pouvions garder le silence à propos de telles situations qui instaurent un ‘cadre légal’ profondément discriminatoire par rapport à des populations qui assument bien souvent une existence extrêmement précaire», se rappelle Luc Lefèbvre chez LST.
LST, avec la Ligue des droits humains (LDH), introduit alors un recours devant le Conseil d’État contre ce règlement anti-mendicité. Les deux associations seront soutenues par Jean-François, une personne en situation de pauvreté.
Quelques mois plus tard, en janvier 2015, victoire: le Conseil d’État suspend la disposition relative à l’interdiction de mendier dans les lieux publics. De même, il suspend les dispositions concernant l’interdiction de mendier avec un mineur de moins de 16 ans et l’interdiction de mendier avec un animal potentiellement dangereux ou susceptible de le devenir.
«Ce qui est gagné par rapport à la ville de Namur l’est aussi pour les autres villes», se réjouit à l’époque LST, car, depuis plusieurs années, de nombreuses villes, d’Anvers à Liège, en passant par Charleroi et Gand, ont pris des mesures répressives par rapport à la mendicité en invoquant, comme Namur, la lutte contre les troubles à l’ordre public et contre le sentiment d’insécurité.
Certaines autres dispositions de ce règlement ne sont, en revanche, pas remises en cause. Celle, par exemple, qui interdit aux «mancheurs» d’entraver la progression des passants. Celle, aussi, qui interdit la mendicité agressive, que cette agressivité soit physique ou verbale. «Tout ce qui est validé par le Conseil d’État constitue une avancée pour les communes, commentait à ce propos Maxime Prévot, le bourgmestre de Namur. Les villes sont dans une démarche exploratoire puisqu’il n’y a pas de cadre précis. Si nous venions à constater une recrudescence de la mendicité, par exemple, nous pourrions toujours réactiver ce règlement, pour une période de trois mois, en l’expurgeant des dispositions suspendues par le Conseil d’État.»
Depuis plusieurs années, de nombreuses villes, d’Anvers à Liège, en passant par Charleroi et Gand, ont pris des mesures répressives par rapport à la mendicité en invoquant, comme Namur, la lutte contre les troubles à l’ordre public et contre le sentiment d’insécurité.
Et Maxime Prévot ne se privera pas. Ainsi, deux ans plus tard, la Ville récidive en juin 2017, en interdisant la mendicité dans le centre-ville, pour une période de trois mois à partir du mois de juillet.
«La mendicité agressive à Namur, ça suffit!», lancera-t-il en 2022, tout en promettant de renforcer les contrôles policiers dans les zones les plus touchées. Un an plus tard, le bourgmestre décide d’interdire la mendicité dans et à proximité des galeries commerçantes durant quatre mois.
«Namur resservira à plusieurs reprises la même recette, faite de répression et discrimination majeure par rapport à un droit fondamental: pouvoir exprimer son indigence sur la place publique», déplore Luc Lefèbvre, aux yeux de qui «la mendicité a une signification sociale importante, consistant à reconnaître sa dépendance à l’égard des autres, fondée sur la solidarité humaine et le respect réciproque.»
Qu’à cela ne tienne, et malgré les règlements pris ces dernières années, Maxime Prévot ira jusqu’à déclarer sur RTL en 2023 qu’en tant que bourgmestre, il est «démuni». Il n’est pas le seul: un certain Bart De Wever évoque un même sentiment à Anvers. Le bourgmestre propose de réinstaurer la loi contre le vagabondage et la mendicité. Cette loi, qui interdit la mendicité et le vagabondage, a été abrogée en 1993.
«Sus à la pauvreté»
C’est à cette date, au moment même où la Belgique devient un État fédéral à part entière, que le législateur abroge les dispositions répressives – datant du XIXe siècle – concernant les mendiants avec la loi du 12 janvier 1993, contenant un «programme d’urgence pour une société plus solidaire».
Les travaux parlementaires relatifs à cette loi révèlent que son but est de créer une société plus solidaire via la «réintégration» des personnes marginalisées au sein de la société: «Pour remédier à la persistance de la pauvreté, il convient de faire franchir à tous les niveaux de pouvoir et de services un pas supplémentaire vers la solidarité afin d’y introduire une véritable éthique de l’intégration.»
Dans Le Soir de l’époque, on titre: DEHAENE: SUS À LA PAUVRETÉ
«La lutte contre la pauvreté passe à la vitesse supérieure (…) Premier objectif: l’abrogation de la loi sur le vagabondage. Le vieux texte de 1891 sera enfin jeté aux oubliettes de l’Histoire et sa mort – annoncée depuis si longtemps – sera accompagnée d’une série de mesures d’aide octroyées par les CPAS.»
La nécessité de cette démarche, conclut Le Soir, paraît «évidente à tous ceux qui savent que le jour où les pauvres participeront vraiment à notre économie, à notre système juridique, à notre instruction, il n’y aura plus de pauvreté».
«Ce changement de paradigme fut une évolution majeure dans le traitement juridique de la mendicité et, pouvait-on penser, la fin de la réponse répressive», se souvient l’avocat Jacques Fierens.
Toutefois, ce sera loin d’être le cas. La tentation répressive à l’égard de la mendicité existe toujours bel et bien.
«Ce changement de paradigme fut une évolution majeure dans le traitement juridique de la mendicité et, pouvait-on penser, la fin de la réponse répressive»
Jacques Fierens, avocat
Rapidement, certaines communes passent à l’acte, en tentant d’interdire purement et simplement la mendicité sur leur territoire, comme la Ville de Bruxelles en juin 1995. Le conseil communal justifie sa décision en invoquant l’augmentation du nombre de mendiants, le caractère organisé de la mendicité, le sentiment d’insécurité et les nuisances dans les zones commerciales fréquentées.
«Face à ce retour du bâton des communes, il y a plusieurs explications, analyse Jacques Fierens. La première est pratico-pratique, et électoraliste, car les premiers à se plaindre des mendiants auprès des autorités, ce sont les commerçants – c’était le cas à Bruxelles dans les années 90, c’est encore plus manifeste à Namur dans les années 2010. L’autre explication est idéologique: il faut se rappeler que la répression de la mendicité est née en même temps que le capitalisme. C’est au moment où le capitalisme a remplacé la féodalité que la répression des mendiants débute, en traitant les pauvres de ‘paresseux’. Ces règlements communaux reposent toujours sur la même logique: le mendiant y est perçu comme une contestation de ce système capitaliste.»
L’arrêté bruxellois fera l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. Ce dernier estimera que cette interdiction générale et permanente sur tout le territoire est disproportionnée. Le Conseil d’État rappelle que la mendicité n’est ni interdite ni punie par la loi.
Certaines communes vont contourner l’interdiction en réglementant la mendicité d’une manière telle qu’elle est rendue impossible ou très difficile, à l’instar de l’arrêté communal de la Ville de Liège de 2001 qui organise une «rotation» de la tolérance des mendiants, dans le temps et l’espace.
«Il est douteux que ces mesures soient efficientes, relève Jacques Fierens qui admet que la révolution juridique introduite en 1993 est un échec complet. En réalité, ces mesures luttent davantage contre la mendicité elle-même, en donnant l’illusion d’une maîtrise, sans rien résoudre à la précarisation de la société.»
305 règlements communaux
En Belgique, 305 des 581 communes ont adopté un règlement communal sur la mendicité ces dernières années. Des textes qui ont été examinés sous l’angle juridique dans un rapport par l’Institut fédéral des droits humains (IFDH) et du Service interfédéral de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale paru en 2023. Avec ce constat interpellant: 253 communes appliquent des interdictions de mendier «qui violent les droits humains».
Le rapport se base sur deux décisions de justice. La première est un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) du 19 janvier 2021. «L’institution y reconnaît pour la première fois que la dignité humaine est violée lorsque des personnes vivant en situation de pauvreté sont empêchées de rechercher, par la mendicité, l’aide d’autres personnes pour subvenir à leurs besoins fondamentaux», explique Laurent Fastrez, juriste à l’IFDH. La seconde, ce sont les trois arrêts du Conseil d’État lors de recours introduits contre les règlements des Villes de Bruxelles, Gand et Namur. «En résumé, si l’on excepte la mendicité agressive, le trouble démontré à l’ordre public, l’entrave à la circulation et la mendicité organisée, infractions déjà couvertes par d’autres textes de loi, les autres formes de sollicitations ne peuvent être interdites», précise-t-il.
Avec ce constat interpellant: 253 communes appliquent des interdictions de mendier «qui violent les droits humains».
Ces dispositions problématiques existent dans toutes les provinces. «Les règlements n’étaient pas nécessairement là où on s’y attendait le plus. Ce n’étaient pas les plus grosses villes qui disposaient d’un tel règlement. Il est frappant de constater que dans la province de Luxembourg et le long de la frontière avec la France, presque toutes les communes ont au moins une disposition problématique», ajoute Laurent Fastrez. «Les communes devraient aligner les règlements de police contenant des dispositions sur la mendicité sur les exigences de la Cour européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence du Conseil d’État», poursuit Michiel Commère, du Service de lutte contre la pauvreté.
L’étude ne permet pas d’identifier dans quelles mesures les communes appliquent proportionnellement leur réglementation en matière de mendicité. Toutefois, les règlements de police prévoient souvent certaines sanctions, principalement des amendes imposées sur la base de la loi sur les sanctions administratives communales (SAC). «Mais il y a une certaine opacité à ce sujet: on sait que des sanctions sont prévues dans les règlements, mais on ne sait pas le nombre de sanctions appliquées», reconnaît Michiel Commère.
Actuellement, la Belgique fait l’objet d’une réclamation devant le Comité européen des droits sociaux. Deux organisations de lutte contre la pauvreté et de promotion des droits sociaux, représentées par Jacques Fierens, ont saisi cette institution européenne pour que soit pleinement reconnu le droit à la mendicité en Belgique. La décision sera connue cette année.
«Cela constituera sans aucun doute une avancée, mais ce n’est peut-être pas cela qui mettra à mal la répression de la mendicité, vu certaines intentions politiques de remettre à plat la loi de 1993», estime Laurent Fastrez. «En cas de victoire, ce sera un outil supplémentaire pour convaincre les bourgmestres de revoir les réglementations problématiques», conclut Michiel Commère.