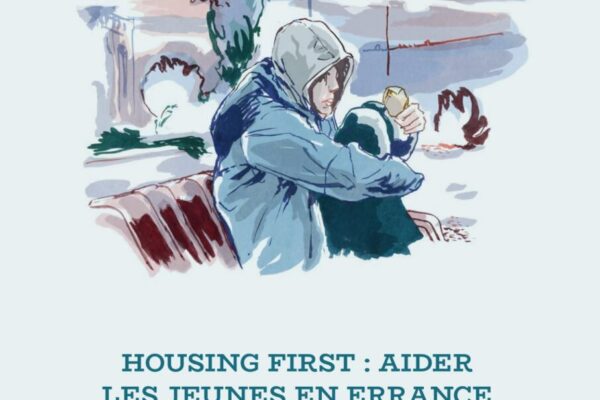La Compagnie Art&tça est un collectif de quatre jeunes acteurs-créateurs qui a décidé de se faire, à travers ses créations, porte-parole des « sans voix », en tenant un propos engagé sur la société actuelle, en racontant des histoires à partir de l’Histoire en train de se faire. Dans “Combat de pauvres”, actuellement en tournée en Wallonie et à Bruxelles, cette jeune compagnie expose les difficultés des populations les plus précarisées, un sujet aussi délicat qu’audacieux à traiter. A travers les témoignages d’experts, de travailleurs sociaux et de victimes de cette paupérisation, leur spectacle analyse sur scène l’impact des choix politiques, sociaux et économiques. Pour en parler, Alter Echos a rencontré l’un des membres d’Art&tça, David Daubresse.
Alter Echos : Votre compagnie est née en 2012 au Conservatoire de Liège. Dès le départ, vous vous êtes spécialisés dans le théâtre documentaire, en partant de témoignages, en menant un véritable travail de terrain pour raconter la société sur scène…
David Daubresse : Le Conservatoire de Liège est une école très politique, à travers des personnalités, comme le metteur en scène Jacques Delcuvellerie, attachées à faire un théâtre qui parle du monde. On a été imprégné par cette formation, mais aussi politisé, en nous invitant à nous questionner, à interroger la société, à sortir de notre zone de confort. A la base, on n’était pas engagé, on s’intéressait peu à la politique. Tout cela a dessiné, précisé cette démarche qui est la nôtre. Lors de cette formation, on a réalisé un projet, intitulé Grève 60, à l’occasion des cinquante ans de l’évènement. On est parti d’une page blanche. Cette aventure a été très forte, assez marquante. Ce fut difficile aussi. Des intervenants, des experts sont intervenus pour commenter et analyser l’événement avec nous, mais ce qui a été déterminant, ce sont les témoignages de personnes qui avaient vécu la grève. Cela nous a mis la puce à l’oreille. C’était passionnant. On a créé de là une fresque historique avec tous les acquis sociaux qui avaient été obtenus depuis la révolution industrielle et qui, dès les années 60, allaient commencer à être remis en cause par les différents pouvoirs. Dans ces années-là, de nouveaux combats sociaux apparaissent, et il y a forcément des échos avec notre époque…
Le sentiment de ne pas être satisfait du monde dans lequel on vit porte ces différents projets.
Alter Echos : A chaque fois, pour chaque spectacle, vous allez à la rencontre de la réalité…
David Daubresse : Cela nous paraît essentiel. On ne supporte pas de ne pas comprendre. Dans un premier temps, il faut comprendre la matière, débroussailler le terrain, avant d’aller interroger des témoins, des experts, des associations. On essaie de donner du sens à son art. Outre le besoin de s’exprimer, il y a un rapport à l’observation un peu différent chez un acteur que chez d’autres personnes. Par exemple, j’ai eu une scolarité difficile. J’en ai fait un spectacle, Entre rêve et poussière, qui évoque l’histoire d’Élise, enfant rêveuse de 9 ans, qui est taciturne et renfermée en classe. Le sentiment de ne pas être satisfait du monde dans lequel on vit porte ces différents projets. Notre démarche est politique parce que mettre des mots sur un malaise, sur un dysfonctionnement de la société, c’est politique. Le théâtre est un moyen pour y parvenir. On nous dit souvent qu’on est un peu seuls dans cette démarche, celle d’un théâtre documentaire, partant du terrain… Beaucoup d’artistes sont plus pudiques, pas forcément outillés non plus, pour évoquer le réel. Que ce soit l’agriculture, la pauvreté ou le risque nucléaire, dernier projet que nous sommes en train de préparer, il faut aborder ces sujets de façon frontale, de façon plus assumée, en utilisant le théâtre comme un lieu citoyen pour parler de la cité. Les théâtres préfèrent souvent des démarches plus spectaculaires, plus détournées pour aborder ces sujets de société.
Alter Echos : Et comment est né Combat de pauvres ?
David Daubresse : On était comme compagnie à un moment où tous nos projets commençaient à prendre fin. C’était il y a trois ans. On se demandait ce qu’on allait faire. Il y avait un enjeu pour continuer à avancer, à créer. Puis, après avoir regardé des documentaires, lu des articles, la pauvreté s’est imposée comme une urgence. Chacun, de notre côté, on sentait que les choses tiraient vers le bas. Même dans notre entourage, on voyait des proches, se retrouver sans situation, sans rien, du jour au lendemain. Les pressions économiques, sociales étaient de plus en plus fortes, tandis que le rapport aux institutions se durcissaient aussi. D’expert en expert, on a avancé petit à petit dans un sujet qu’on connaissait peu en fait. On a interrogé aussi des SDF. Au départ, on s’était focalisé sur le sans-abrisme, mais très vite, à force d’avancer, de connaître la matière, le regard s’est élargi. On ne pouvait pas évoquer le cas des SDF, sans remonter plus haut, sans évoquer en fait la pauvreté invisible… De plus en plus de citoyens vivent sous le seuil de pauvreté. Ils n’en ont pas forcément conscience, ils n’osent pas mettre des mots sur leur situation, admettre qu’ils sont pauvres parce qu’ils ont 1000 euros, qu’ils arrivent vaille que vaille à payer leur loyer, même si c’est au prix d’énormes sacrifices… Derrière ce silence, beaucoup culpabilisent, ont l’impression que c’est de leur faute, et préfèrent ne pas en parler. On a voulu donner la parole à toute cette population confrontée qui est aux portes de la rue.
La pauvreté s’est imposée comme une urgence. Chacun, de notre côté, on sentait que les choses tiraient vers le bas. Même dans notre entourage, on voyait des proches, se retrouver sans situation, sans rien, du jour au lendemain.
Alter Echos : C’est une manière aussi d’engager le spectateur. Une de vos spécificités, c’est qu’il y ait à chaque fois un débat avec le public après la pièce.
David Daubresse : On arrive toujours à créer ces dialogues. Les spectateurs sont forcément pris par les témoignages qu’ils entendent, les situations qu’ils découvrent sur scène. Ils sont forcément concernés. Pour Combat de pauvres, certains ne se rendaient pas compte de l’ampleur du problème. D’autres en sont des témoins directs. Certains estiment aussi qu’on exagère, qu’on noircit le tableau. Il y a autant de réalités que d’individus. Lors des débats sur l’école, des enseignants estimaient que notre présentation n’était pas emblématique du système scolaire, ces derniers n’arrivant pas à remettre en cause vingt, trente ans de pratiques pédagogiques… D’autres disaient le contraire. C’est très intéressant à voir, à vivre. C’était pareil pour Nourrir l’humanité, pièce évoquant le déclin de l’agriculture familiale dans nos campagnes, on a voulu montrer qu’il y avait d’autres manières de faire, qu’on se trompait de pratiques depuis des décennies, qu’il y avait des alternatives qu’on exploitait insuffisamment. C’est compliqué à entendre, à voir pour certains spectateurs, directement confrontés par le sujet, mais tout cela nourrit notre travail, nos réflexions.