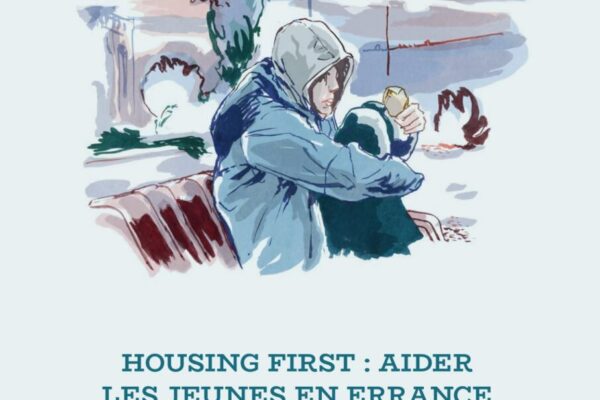Salim Haouach est directeur artistique de l’asbl «Ras El Hanout» et Mohamed Allouchi est comédien et metteur en scène pour la compagnie «Les voyageurs sans bagages». Ensemble, ils travaillent depuis bientôt deux ans sur la pièce Ma Andi Mangoul (du darija, «Je n’ai rien à dire») qui sera jouée pour la première fois au Bozar, le 21 septembre. Dans ce seul en scène questionnant les relations entre la police et les jeunes issus de l’immigration à Bruxelles, les deux hommes mêlent documentaire et fiction avec humour. Partageant des visions similaires du théâtre, ils nous ont parlé de leur manière de travailler, mais aussi de la façon dont leur travail est perçu ou accueilli par la profession.
Alter Échos: La pièce que vous jouez peut être qualifiée de docu-fiction, en quoi est-elle inspirée d’une histoire personnelle?
Salim Haouach: C’est en 2019 qu’est née l’idée du projet. Dans un dîner, mon père balance: «Tu sais que j’ai donné des cours d’arabe et d’histoire à des gendarmes?» Il ne m’en avait jamais parlé et ça a suscité en moi beaucoup de questions. J’en ai discuté avec Mohamed Allouchi qui a très vite été intéressé. Pendant le confinement, on a tenu des ateliers avec mon père une fois par semaine. On lui posait des questions, il nous racontait, on se repassait des archives, surtout télévisées, mais aussi des coupures de journaux, belges et marocains. En parallèle, on a réalisé des ateliers avec des citoyens pour réfléchir ensemble au rôle de la police aujourd’hui. Au cours de notre processus de travail, il y eut la mort de Georges Floyd à Minneapolis et celles d’Adil et d’Ibrahima à Bruxelles. Les ateliers ont été nourris de ces drames-là. À travers la pièce, on souhaite faire dialoguer ces deux matériaux, entre hier et aujourd’hui.
«Le théâtre a cette force politique d’amener le débat d’une autre manière, sur la scène.»
AÉ: Le sujet des violences policières auquel vous vous attaquez est un sujet brûlant dans le débat public aujourd’hui…
Mohamed Allouchi: C’est un sujet qui a été très médiatisé dernièrement. Les gens commencent à se dire que les violences policières existent peut-être. Il y a 20 ans, lorsqu’on en parlait, les gens argumentaient: «S’il lui est arrivé ça, c’est qu’il a sûrement fait quelque chose.»
SH: Moi je trouve qu’il y a encore beaucoup de monde qui pensent comme ça, même des dirigeants politiques. Le président de la République française a quand même dit «Ne parlez pas de répression ou de violences policières, ces mots sont inacceptables dans un État de droit.» C’est en France, mais en Belgique ce n’est pas bien différent. Pieter De Crem (CD&V), ministre de l’Intérieur (2018-2020) a déclaré: «Les plaintes contre la police pour violence ou racisme constituent une contre-stratégie utilisée par des groupes criminels, et je n’accepterai jamais cela.»
MA: Ce sont des accusations lourdes, qui sont prononcées par un ministre. Parfois, on se demande si ces dirigeants sont dans le déni ou s’ils ne sont pas conscients de ce qu’il se passe.
«On vit dans une société où des personnes sont sous-représentées et il faut que les personnes qui ont des positions de privilège se mettent de côté, pour leur laisser la place.»
AÉ: Face à tout cela, le rôle du théâtre est-il politique?
MA: Pour moi oui. Tout acte en société est politique. Une personne qui ramasse une cannette dans la rue, c’est un acte politique. Le théâtre a cette force politique d’amener le débat d’une autre manière, sur la scène.
SH: Tout est politique et ceux qui pensent ne pas en faire, sont ceux qui perpétuent le système. Avec cette pièce-ci, on a un rôle de transmission de ces histoires. On a recueilli les paroles de mon père, celles des participants aux ateliers, celle de Mohamed et la mienne aussi. Pour nous, cette pièce est une manière d’amener à la réflexion, de partager ces expériences pour vraiment se poser des questions fondamentales. On a beau voir l’actualité, lorsqu’on éteint la télévision, la vie continue. «Ma Andi Mangoul», c’est l’occasion de s’arrêter et de se confronter. Se confronter les uns aux autres, mais aussi se confronter à des réalités auxquelles on a parfois envie d’échapper parce que ce sont des débats difficiles et polarisés.
AÉ: Comme vos productions théâtrales sont-elles reçues dans la profession?
SH: Avec Mohamed, on s’est rendu compte de la même chose lorsqu’on allait vers des programmateurs ou des directeurs de théâtre. On sentait que leur vision de notre travail, alors qu’on a des projets qui sont différents, était similaire. Parce que ce sont des projets portés par des personnes identifiées comme arabes, alors on rentre dans une case: celle de la «diversité». C’est déjà arrivé que «Les voyageurs sans bagages» contactent un lieu et qu’on leur répondent: «On a déjà pris une pièce de Ras El Hanout». Pourtant, nos propositions artistiques n’ont rien à voir.
MA: Nous n’avons pas le même style de spectacles mais on assimile notre travail. Je joue dans des comédies de théâtre classique revisitées à vocation pédagogique et Salim est dans plein d’autres sujets. C’est frustrant pour un auteur d’être renvoyé à qui il est et non pas à ce qu’il écrit. Si je prends mon exemple, je n’ai pas étudié le théâtre, mais je l’ai pratiqué. Ma vision du théâtre, c’est: j’ai quelque chose à dire, je monte sur scène et je le dis.
«On a vite compris qu’on avait besoin d’être indépendants et pour l’être, il fallait qu’on ait nos propres lieux.»
AÉ: Pensez-vous que le théâtre en 2021 reste un art élitiste, qui s’adresse à une certaine frange de la population?
SH: Tout le monde est conscient qu’il y a un problème d’ouverture dans le monde du théâtre aujourd’hui. Il y a des ouvertures de façade, mais tant qu’il n’y a pas de remise en question du mode de fonctionnement, des critères de sélection, alors on reproduit ces schémas. Parfois, les personnes censées être les plus ouvertes sont dans la pratique les plus conservatrices et les plus réfractrices au changement. Même lorsqu’on est programmé par un lieu, on constate une différence dans la manière d’être accueilli. C’est pour cela que nous, on a vite compris qu’on avait besoin d’être indépendants et que pour l’être, il fallait qu’on ait nos propres lieux. On ne dépend de personne, si l’on a envie de faire un projet, on va le faire, on s’est toujours débrouillé comme ça.
MA: On sent au sein des lieux de programmation, comme dans tout domaine de connaissances, l’influence des écoles, des relations, etc. La politique culturelle qui est subventionnée a une influence sur les programmations et parfois, l’exercice est maladroit. Des gens de bonne volonté vont dire «Il me faut absolument une personne sans-papiers ou des gens d’origine étrangère pour un projet.» Quelquefois, ce sont presque des commandes. On pourrait comparer ça, historiquement, à de la charité chrétienne, une manière de tendre la main pour autonomiser et permettre l’indépendance d’une certaine population. C’est comme si l’on était une sous-culture ou une sous-classe qu’on devrait éduquer.
AÉ: La situation a-t-elle évolué avec la crise sanitaire?
MA: Avec le Covid, si on souhaitait être programmé quelque part, on a fait face à l’argument du «Ce n’est pas possible, on a beaucoup de reports.» Par contre, si on était déjà programmé, on nous annulait, mais ce n’était pas reporté. On sent vraiment qu’il y a ceux qui sont importants et d’autres moins. Le report, le décalage, on n’y a pas le droit.
SH: Pour moi, c’est le même raisonnement qu’avec la discrimination à l’embauche. En fonction de si l’on est dans une situation de pénurie ou pas, il y a plus ou moins de discriminations. Dans des métiers en pénurie, on prend les candidats qui se présentent, même si l’employeur n’est pas forcément à l’aise avec ça ou qu’il a des préjugés. Dans ces métiers-là, il y a plus de personnes primo-arrivantes ou d’origines étrangères. Lorsque, par contre, il y a un déséquilibre entre l’offre et la demande, et qu’il y a beaucoup de demandeurs d’emploi, alors là, il y a des choix qui sont faits. L’employeur aura tendance à engager quelqu’un qui lui ressemble: un mâle blanc de 40-50 ans sorti de telle école. Depuis la crise sanitaire, c’est la même chose avec les programmations au théâtre, il y a de moins en moins de places et donc la situation est de plus en plus difficile.
«Tout est politique et ceux qui pensent ne pas en faire, sont ceux qui perpétuent le système.»
AÉ: Certains auteurs souhaitent mettre en lumière des thématiques de société sans avoir un accès à ces récits. Ne prennent-ils pas la parole à la place des principaux et principales concernées?
SH: Certaines personnes viennent nous voir en disant qu’ils aimeraient bien travailler avec nos jeunes, comme si l’on était des fournisseurs de jeunes. La raison pour laquelle on touche ces jeunes-là, c’est parce qu’on travaille de manière horizontale, participative et qu’on ne les instrumentalise pas. Notre mentalité c’est: «T’as un projet en tête, fais-le!» Concernant la prise de parole des principaux et principales concernées, je ne m’enferme pas dans cette question, je pense que l’on peut arriver raconter d’autres récits que ceux qu’on a vécus. Mais il est vrai qu’on vit dans une société où certaines personnes sont sous-représentées et il faudrait que les personnes qui ont des positions de privilège se mettent de côté pour leur laisser la place.
Dates de programmation: 21 septembre 12h40 au Bozar; 2 octobre à 20h30 à Tour & Taxis; 8, 9 et 10 octobre à Zinnema; 15, 16 et 17 à l’Épicerie.
En savoir plus
«Forest 1991: les raisons de la colère» (dossier), Alter Échos n° 493, juin 2021.
«Antiracisme: une lutte à fleur de peau» (dossier), Alter Échos n° 486, septembre 2020.
«Police et jeunes: bilan d‘un confinement sous tension», Alter Échos n° 484, mai 2020, Cédric Vallet.
«Violences policières: pire qu’hier, mieux que demain?», Alter Échos n° 486, septembre 2020, Manon Legrand.
«Uneus: cow-boys de proximité», Alter Échos, novembre 2018, Marinette Mormont et Manon Legrand.